L’auteur américain est reconnu pour ses récits de voyage aigus et l’observation acides de ses contemporains. Il écrit aussi des romans et en présente trois à la suite. Grosses nouvelles ou petits romans, peu importe, les Américains bien tranquilles aiment les gros bouquins alors que les Français stressés, qui ont toujours peur de manquer le dernier métro de la mode, préfèrent les formats courts qu’on survole en moins d’une heure.
A 66 ans, Paul Theroux est dans une forme éblouissante. La figure romanesque le libère des précisions de fait et rend ses personnages plus véridiques. Ce sont des Américains moyens qui raisonnent avec le bon sens de rigueur dans les états blancs, riches et protestants. Surprise amusée, jugement souverain, petits compromis avec la morale, chacun se reconnaît plus ou moins dans ces personnages de bourgeois aisés issus de la culture post-68 et ayant réussi en affaires, en études comme en amour. C’est à ce moment qu’une fois bien ferré, le lecteur est conduit au renversement inattendu des choses. Ce qu’il croit n’advient pas, au contraire ; tous les aménagements avec le bien se retournent avec une force décuplée – comme il est dit dans la philosophie indienne. Du roman, l’auteur nous mène au conte moral et sa subtile cruauté n’en est que plus délectable.
Dans La colline des singes, un couple de Bostoniens bon chic, massés d’Âyurveda et assouplis de yoga, contemple avec stupeur des singes au comportement presque humain. Ils en rient avec affectation sans voir que les Indiens, si corrects avec les clients, les observent de la même façon. Il suffit qu’ils dérapent imperceptiblement pour que tout se sache et que l’inflexible correctness héritée de la civilisation brahmanique (accentuée par le can’t britannique) se mue en rejet méprisant de ces ‘barbares’ occidentaux trop visibles. Pourtant, chaque petit geste à la limite apparaît anodin, compromis imperceptible avec la morale qui passerait sans peine aux Etats-Unis ou en France. Mais l’Inde est radicalement autre et nul n’explore sa culture profonde comme on va chez Disney. Il ne suffit pas de singer le yoga et de se soumettre à l’Âyurveda, ni de manger épicé et de porter du shatoosh, pour pénétrer la civilisation indienne. Tel est peut-être le message de Paul Theroux à ses contemporains, il le distille avec une grande finesse. Nous aimerions avoir ce don d’humour redoutable qui est sa marque et fait mouche.
La Porte de l’Inde est une progression. Nous sommes toujours face à un Américain type, pressé, avide et horrifié par tout ce que l’Inde présente de misère, de microbes et de pollution. Malheureux en amour au point de s’être marié tard avec une égoïste, puis d’avoir divorcé un an plus tard, il succombe aux attraits d’une très jeune Indienne qui danse devant lui seins nus et l’aguiche habilement en présentant ses dons comme un bienfait humanitaire. Les Américains se repaissent de sexe comme de food – fast and fat. Mais le sexe fait sortir Dwight, avocat d’affaires redoutable, de son univers censuré et de ses préjugés hygiénistes. « Oui, l’Inde était sensuelle. Si elle semblait puritaine, c’est que derrière son puritanisme se cachait une sensualité refoulée, plus insatiable, plus nue, plus vorace que tout ce qu’il avait jamais connu » p.208. La délicatesse polie des femmes indiennes le change des harpies égoïstes américaines. Aidé par le jaïn Shah, avocat indien, il se transforme. Le tout est de ne pas accepter l’apparence des choses. Dwight demande à rester un peu en Inde et pousse Shah à aller le remplacer aux Etats-Unis pour un séminaire. Une fois ces épreuves accomplies, l’échange peut avoir lieu : Shah offre la pauvreté et la méditation sur l’existence et Dwight fait cadeau à son partenaire de ses contacts d’affaires américain pour l’essor de sa carrière. L’auteur se garde bien de dire qui devient le plus heureux – ou qui a roulé qui : on est en Inde, pays de l’ambigu où l’apparence cache toujours l’apparence.
Le Dieu Eléphant progresse encore. Après la punition, puis la rédemption, la compréhension. Alice est une étudiante américaine pragmatique qui fait son expérience. Après que sa copine, la précieuse Stella, l’eût larguée pour un frimeur cinéaste et friqué, elle rejoint l’ashram convoité par ses propres moyens. L’occasion, dans le train indien, de rencontrer le gros Amitabh, type de jeunesse indienne moderne qui rêve fric, électronique et anglais globish – tout en restant ataviquement le machiste gâté façonné par l’éducation indienne. La suite avance : l’Américain n’en reste plus à la bêtise satisfaite, ni à la rédemption des péchés humains trop humains. L’héroïne est une fille, positive, yankee dans ce qu’elle a de pionnier ; elle veut comprendre l’Inde et non s’y immerger. Elle se laisse changer par le pays tout en aidant le pays à se changer. Habitant un ashram où un Swami l’enseigne, elle travaille grâce à Amitabh dans un centre d’appels pour produits électroniques où elle enseigne aux jeunes Indiens comment répondre et avec un accent compréhensible. Equilibre ? Presque. Rien n’est éternel, tout passe, le monde est sans cesse en mouvement. Ce fondement de la philosophie indienne la rattrape par le karma, cette suite d’actions qui engendre des conséquences. Le côté américain « bon garçon » qui a fait Alice aider Amitabh (qui se fait appeler Shah en affaires) donne des idées à l’enfant gâté : il se met en tête de la séduire, elle refuse, il la suit. Drame. La justice à l’indienne étant aussi surannée que ses expressions anglaises figées depuis la conquête, seule la justice immanente peut rééquilibrer la balance. Futée, Alice songe à l’éléphant, celui qu’elle nourrit avec plaisir et qu’elle plaint lorsqu’il est pris d’envie de liberté ; il est pour elle l’incarnation du dieu Ganesh. Portez plainte en Inde, vous vous retrouverez englués dans « une culture chicanière. Pas de justice, mais une lutte incessante et des confrontations de biais qui revenaient à fuir la réalité. L’aspect antique de l’Inde, ce côté décomposé, squelettique, était le résultat de cette tendance à tout remettre à plus tard. On pouvait mourir avant de voir la moindre promesse tenue, mais la dénégation était une autre manière de gérer les affaires. Le système judiciaire était basé sur l’accumulation d’obstacles » p.420. Alice applique donc le positivisme occidental du « aide-toi, le Ciel t’aidera », et Ganesh s’en charge. Le lecteur verra comment, nous nous en voudrions de déflorer le dénouement.
Paul Theroux livre dans cette nouvelle « la plus importante découverte des voyageurs. Vous partiez de chez vous pour aller à la rencontre d’inconnus. Personne ne connaissait votre histoire, personne ne savait qui vous étiez : c’était un recommencement, presque une renaissance. Être qui vous vouliez, qui vous décidiez d’être, était une libération » p.332. Il renouvelle la philosophie des routards hippies en mesurant combien ses contemporains se sont éloignés de son élan sain. « Avec le temps, un voyage n’est plus un simple interlude de distractions et de détours, de visites touristiques et de loisirs, mais une série de ruptures, au fil desquelles on abandonne peu à peu tout confort (…). Être seul sans jamais se sentir isolé. Il s’agissait non pas de bonheur mais de sécurité, de sérénité, de découvertes au gré des allées et venues… » p.364.
Dans cette Suite indienne, Paul Theroux montre qu’il est un grand écrivain. Ses trois histoires captivent, ses personnages bien de notre temps évoluent selon leurs ressorts intimes, son style tout de détachement et de précision décape au scalpel. Voilà qui est puissant.
Puissant est peut-être le terme le mieux adapté à ce livre, puissant comme le lotus – cette plante symbole de la culture indienne – qui pousse sa racine d’elle-même, sans insister mais avec obstination, depuis la boue du fond au travers de l’eau stagnante – pour s’épanouir à la lumière.
Paul Theroux, Suite indienne (The Elephanta Suite), 2007, Grasset 2009, 425 pages, €21.25

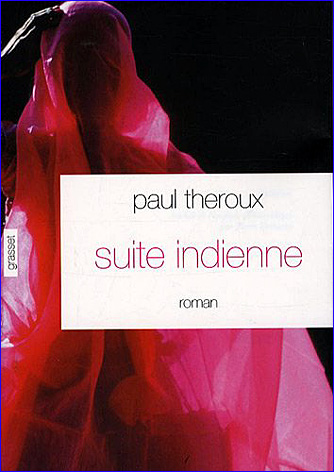

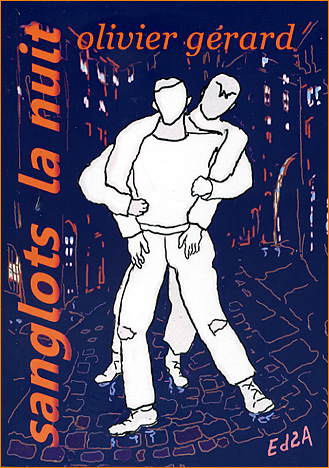





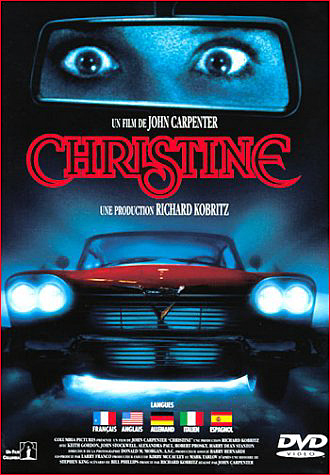





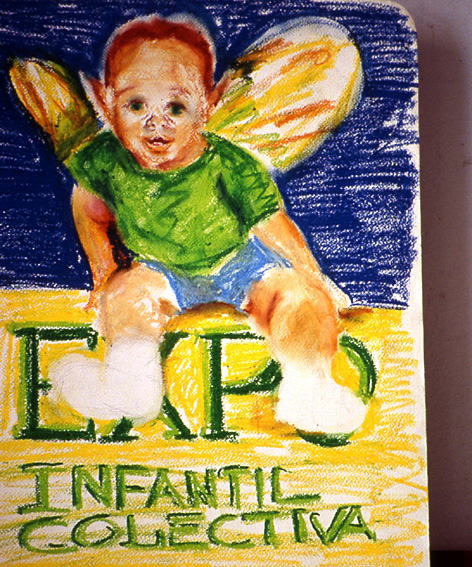


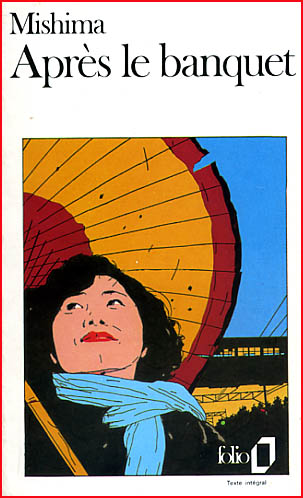






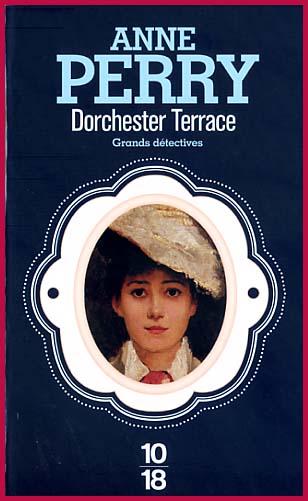



Tuer le rire ?
L’un des tueurs voulait massacrer du juif ; les deux autres faire rentrer le rire dans la gorge. Car pour ces raccourcis du cerveau, on ne peut rire de tout. Si le rire est le propre de l’homme (Rabelais), Dieu l’interdit – ou plutôt « leur » Dieu sectaire, passablement fouettard, Dieu impitoyable d’Ancien Testament ou de Coran, plus proche de Sheitan et de Satan. Ange comme l’islam, mais déchu comme l’intégrisme.
Comme le Prophète ne savait ni lire ni écrire, il a conté ; ceux qui savaient écrire ont plus ou moins transcrit, et parfois de bouche à oreille ; les siècles ont ajoutés leurs erreurs et leurs commentaires – ce qui fait que la parole d’Allah, susurrée par l’archange Djibril au Prophète qui n’a pas tout retenu, transcrite et retranscrite par les disciples durant des années, puis déformée par les politiques des temps, n’est pas une Parole à prendre au pied de la lettre. Le raisonnable serait de conserver le Message et de relativiser les mots ; mais la bêtise n’est pas raisonnable, elle préfère ânonner les mots par cœur que saisir le sens du Message.
La bêtise est croyante, l’intelligence est spirituelle. Les obéissants n’ont aucune autonomie, ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, ils ont peur de la liberté car ce serait être responsable de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. Ils préfèrent « croire » sans se poser de questions et « obéir » sans état d’âme. Islam veut-il dire soumission ? Un philosophe musulman canadien interpelle ses coreligionnaires : « une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste, formaliste, machiste, conservatrice, régressive – est trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, l’islam ordinaire, l’islam quotidien, qui souffre et fait souffrir trop de consciences, l’islam de la tradition et du passé, l’islam déformé par tous ceux qui l’utilisent politiquement, l’islam qui finit encore et toujours par étouffer les Printemps arabes et la voix de toutes ses jeunesses qui demandent autre chose. Quand donc vas-tu faire enfin ta vraie révolution ? »
Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres mais s’interroger sur sa propre religion, distinguer sa pratique de la foi.
Mahomet s’est marié avec Aisha lorsqu’’elle avait 6 ans (et lui au-delà de la cinquantaine) ; il a attendu quand même qu’elle ait 9 ans pour user de ses droits d’époux : c’était l’usage du temps mais faut-il répéter cet usage aujourd’hui ? L’ayatollah Khomeiny a abaissé à 9 ans l’âge légal du mariage en Iran lorsqu’il est arrivé au pouvoir… Les plus malins manipulent aisément les crédules, ils leurs permettent d’assouvir leurs pulsions égoïstes, meurtrières ou pédophiles, en se servant d’Allah pour assurer ici-bas leur petit pouvoir : Khomeiny, Daech, mêmes ressorts. Trop d’intermédiaires ont passés entre les Mots divins et le texte imprimé pour qu’il soit à prendre tel quel. Croyons-nous par exemple que Jésus ait vraiment « marché sur les eaux » ?
Il ne faut pas croire que le Coran soit la Parole brute d’Allah. Que font les intellectuels de l’islam pour le dire à la multitude ?
Toute religion a une tendance totalitaire : n’est-elle pas par essence LA Vérité révélée ? Même le communisme avait ce tropisme : « peut-on contester le soleil qui se lève ? » disait à peu près Staline pour convaincre que les lois de l’Histoire sont « scientifiques ». Qui récuse la vérité est non seulement dans l’erreur, mais dans l’obscurantisme, préférant rester dans le Mal plutôt que se vouer au Bien. Il est donc « inférieur », stupide, malade ; on peut l’emprisonner, en faire son esclave, le tuer. Ce n’est qu’une sorte de bête qui n’a pas l’intelligence divine pour comprendre. Toutes les religions, toutes les idéologies, ont cette tendance implacable – y compris les socialistes français qui se disent démocrates (ne parlons pas des marinistes qui récusent même la démocratie…). Les incroyants, les apostats, les hérétiques, on peut les « éradiquer ». Démocratiquement lorsqu’on est civil, par les armes lorsqu’on est fruste.
Le croyant étant « bête » parce qu’il croit aveuglément, comme poussé par un programme génétique analogue à celui de la fourmi, ne supporte pas qu’on prenne ses idoles à la légère. Toutes les croyances ne peuvent accepter qu’on se moque de leurs simagrées ou de leurs totems : la chose est trop sérieuse pour que le pouvoir fétiche soit ainsi sapé. C’est ainsi que Moïse va seul au sommet de la montagne et que nul ne peut entrevoir l’Arche d’alliance ou le saint des saints du temple, que Mahomet est-il le seul à entendre la Parole transmise par l’ange et que nul infidèle ne peut voir la Kaaba. Dans Le nom de la rose, dont Jean-Jacques Annaud a tiré un grand film, Umberto Ecco croque le portrait d’un moine fanatique, Jorge, qui tue quiconque voudrait simplement « lire » le traité du Rire qu’aurait écrit Aristote. Ce serait saper la religion catholique et le « sérieux » qu’on doit à Dieu… Les geôles de l’Inquisition maniaient le grand guignol avec leurs tentures noires, leurs juges masqués, leurs bourreaux cagoulés devant des feux rougeoyants. Pas question de rire ! Même devant Louis XIV (sire de « l’État c’est moi »), Molière devait être inventif pour montrer le ridicule des médecins, des précieuses ou des bourgeois, sans offusquer les Grands ni Sa Majesté elle-même.
Il ne faut pas croire que le rire soit le propre de l’homme ; ce serait plutôt le sérieux de la bêtise. Que font nos intellectuels tous les jours ?
C’est cependant « le rire » qui libère. Il permet la légèreté de la pensée, le doute salutaire, l’œil critique. Rire déstresse, rend joyeux autour de soi, éradique peurs et angoisses – ce pourquoi toute croyance hait le rire car son pouvoir ne tient que par la crainte. Se moquer n’est pas forcément mépriser, c’est montrer l’autre en miroir pour qu’il ne se prenne pas trop au sérieux. C’est ce qu’a voulu la Révolution française, en même temps que l’américaine, libérer les humains des contraintes de race, de religion, de caste, de famille et d’opinions. Promotion de l’individu, droits de chaque humain, libertés de penser, de dire, de faire, d’entreprendre. Dès qu’un pouvoir tend à s’imposer, il restreint ces libertés-là.
Est-ce que l’on tue pour cela ? Sans doute quand on n’a pas les mots pour le dire, ni les convictions suffisamment solides pour opposer des arguments. Petite bite a toujours un gros flingue, en substitution. Surtout lorsque l’on a été abreuvé de jeux vidéos et de décapitations sans contraintes sur Internet : tout cela devient normal, « naturel ». C’est à l’école que revient de dire ce qui se fait et ce qui ne se fait en société : nous ne sommes pas dans la jungle, il existe des règles – y compris pour la diffamation et le blasphème. Il est effarant d’entendre certains collégiens (et collégiennes) dire simplement « c’est de leur faute ». Donc on les tue, comme ça ? C’est normal de tuer parce qu’un autre vous a « traité » ? Est-ce ainsi que cela se passe dans les cours de récré ? Si oui, c’est très grave…
L’écartèlement entre les cultures, celle de la France qui les a partiellement rejetés, celle de l’Algérie qu’ils n’ont connue que par les parents et cousins, ont rendu les frères Kouachi incertains d’eux-mêmes, fragiles, prêts à tout pour être enfin quelqu’un, reconnus par un groupe, assurés d’une conviction. La secte est l’armure externe des mollusques sans squelette interne. Ils se sont créé des personnages de héros-martyrs faute d’êtres eux-mêmes des personnes.
Il ne faut pas croire que la multiculture enrichit forcément. Que font les politiciens pour établir les valeurs du vivre-ensemble sans les fermer sur l’extérieur ; pour faire respecter les lois de la République sans faiblesse ni « synthèse » ?
Comment faire pour « déradicaliser » les individus ? Une piste de réflexion intérieure, européenne et géopolitique. Lire surtout la seconde partie.