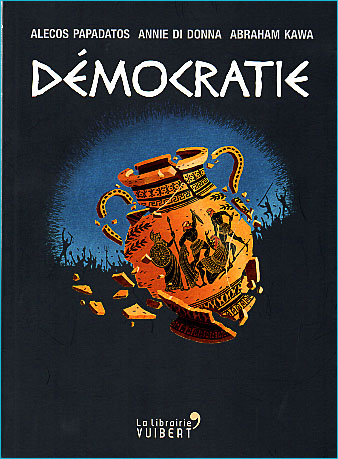
Nous sommes en 490 avant notre ère, à la veille de LA bataille. Dans la nuit de Marathon, sur les hauteurs qui dominent la plage où campent les Perses, hulule la chouette, symbole d’Athéna. Deux jeunes hommes qui ne peuvent pas dormir se racontent leur existence, peut-être avant de mourir demain. Ils sont bientôt entourés de leurs compagnons tant l’existence de l’un se confond avec ce pourquoi ils sont là : la naissance de la démocratie, pour la première fois dans le monde.
Le premier jeune homme est Thersippe, qui sera le coureur de Marathon selon certains historiens (d’autres lui donnent un nom différent) ; il périra dans son effort pour annoncer la victoire aux Athéniens le lendemain, après 42 km et 195 m – performance que l’on reproduit aujourd’hui à chaque épreuve olympique. Le second, le narrateur, est Léandre, personnage inventé.
Léandre remonte cette nuit-là à l’été de ses 16 ans, beau gaillard gracile perpétuellement torse nu, féru de dessin et de peinture. Après avoir enfreint les ordres de son père qui ne lui a permis de peindre qu’un seul des murs de la salle alors qu’il a peint les quatre, emporté par son enthousiasme, il est envoyé se colleter à la dure réalité : celle de négocier un bon prix pour l’huile d’olive du domaine auprès d’un marchand de Thrace. Porter les ballots d’olives et les jarres d’huile lui exercera les muscles tandis que le négoce lui assainira la tête, pense son père qui veut en faire un homme.
Lorsqu’il est de retour à Athènes après avoir réussi, c’est le jour de la procession des Panathénées. Tout le peuple est autour de la citadelle pour voir le spectacle. Dans cette presse, deux tyrannoctones ont prévu d’abattre le tyran Hipparque, qui gouverne avec son frère Hippias en manipulant la masse et en s’en mettant plein les poches. Aristogiton et son jeune amant Harmodios, dont on dit que le tyran les avait insultés, poignardent Hipparque avant d’être pour l’un, le plus jeune, abattu par la garde et pour l’autre arrêté, torturé puis exécuté après avoir donné le nom de ses complices aristocrates. Dans la répression qui suit l’acte, le père de Léandre est tué par la police scythe.

Son géniteur mort, sa maison incendiée, ses biens confisqués (par un ex-ami de son père…), Léandre s’exile, toujours en pagne, jusqu’à Delphes où une connaissance de son père le fait travailler à inventorier les offrandes dans le Trésor. L’adolescent retrouve Hero, la jeune nièce du commerçant à qui il a négocié ses olives il y a peu ; elle est pythie apprentie.
Peu à peu, le garçon se rend compte que l’oracle délivre des messages qui sont filtrés par des prêtres de Delphes appelés « saints », éminemment corruptibles. Malgré l’oracle sibyllin, l’interprétation penche vers qui paie le plus. Mais qu’importe : ce qui compte est d’y croire. La foi insuffle une volonté bien plus forte que la seule raison. La force d’un oracle tient à l’histoire racontée qui donne sens. Qui croit est doué d’un pouvoir de convaincre et de vaincre.
C’est ce qu’apprend au candide Léandre un mystérieux Athénien, Clisthène, venu solliciter de l’oracle l’appui de Sparte pour renverser le tyran survivant Hippias. Clisthène l’Athénien sera considéré comme le père de la démocratie. Il instaurera un système de votes où les citoyens ne sont plus regroupés en tribus clientélistes, mais en circonscriptions où les diverses classes sont mélangées. Chacun verra donc plus l’intérêt général que celui de son clan – et ce sera bien le peuple qui décidera à la fin et non pas quelques aristocrates.

Ce roman dessiné historique conte donc une double quête : celle de l’adolescent Léandre de 16 à 32 ans – et celle de la démocratie athénienne qui émerge avant Marathon. Devenir adulte et devenir citoyen s’apprend, s’entretient et se conforte, car l’état d’homme libre et responsable est toujours précaire, dans un combat sans fin.
Athéna, qui parle au garçon dans ses rêves, représente la transition entre le monde ancien des dieux (les forces obscures qui meuvent l’humain) et le monde nouveau des hommes (ce rationnel scientifique et démocratique sans cesse à consolider). Les deux totems de la déesse sont le serpent et la chouette, alliant la force de qui sort de la terre à la clairvoyance de qui voit dans la nuit – le désir et la raison. Athéna se situe entre ses frères : Apollon garant de l’ordre, de la beauté et de l’intelligence, et Dionysos en état de perpétuelle ébriété hormonale et de joie, insufflateur du désir et de la volonté. Si Dionysos est sorti de la cuisse de Zeus, Pallas Athéna est sorti du même par la tête. Déesse emblématique d’Athènes, elle se veut l’équilibre du bon sens, état fragile toujours à rectifier, paix armée sans cesse sur le qui-vive. La cité ne sera grande que lorsqu’elle incarnera cette double vertu de puissance et de discipline – notamment face aux Perses à Marathon.
- Ainsi le corps du citoyen est-il celui d’un athlète, pareil aux dieux représentés sur les vases que Léandre aime peindre et par les statues. Il est soldat plus que travailleur – et le lecteur pourra comparer les anatomies respectives de Léandre (fils de négociant libre) et de Givrion (fils d’esclave, son ami).
- Ainsi l’esprit du citoyen est-il entre la logique volontiers sophiste et manipulatrice des philosophes, et la passion collective de la foule – le lecteur pourra comparer les personnages de Pisistrate et de Solon.
Le dessin, plutôt sommaire et volontiers pressé, fait souvent surgir la grâce du mouvement et de l’expression, inspiré des lutteurs minoens d’Akrotiri à Santorin. Léandre et Hero sont beaux en leur jeunesse, ils irradient la lumière du désir et courbent leurs formes en élans gracieux. Ils se détachent comme l’avenir sur un passé plus grossier – comme la démocratie qui naît sur l’asservissement coutumier.

Papadatos fait passer la leçon de l’histoire – les valeurs de notre civilisation – par le dessin. L’aventure et l’amour sont complétés par des annexes d’historiens pour mieux comprendre. Le lecteur percevra plus clairement cette ligne arbitraire qui passe entre moutons et citoyens, mais aussi mieux que sur une carte cette frontière impalpable entre la Grèce et la Turquie (hier la Perse) – ce pourquoi ce pays n’a rien à faire dans l’Union européenne (sauf à ne vouloir qu’un marché de libre-échange sans aucune âme).
« Toute fin nous ramène aux intrigues », dit le Léandre de 32 ans à ses compagnons d’insomnie. Il parle de la démocratie, sans cesse menacée par les clans et par les castes, sans cesse à refonder. « Au temps où nous pensions qu’on était les bons, et tous les autres les mauvais (…) cette façon de penser met toujours en avant ceux qui agissent par eux-mêmes, pour eux-mêmes, les ‘grands’ noms, les ‘chefs’, les tyrans, et ceux qui nous sauvent des tyrans » p.197.
Une leçon que les partis politiques d’aujourd’hui devraient méditer, au parti Socialiste comme chez les Républicains, politiciens qui se croient volontiers investis de la mission de commander aux autres. « Cette façon de penser nous ramène à la peur et à la folie, au visage de la Gorgone. Et la force de la Gorgone peut se retourner vers nous à tout moment. Nous pouvons être notre pire ennemi ». Ce ne sont pas les élections régionales de décembre 2015, faisant surgir brutalement un Front national menaçant, qui vont démentir cette antique leçon de politique.
Pour vivre ensemble et faire cité, il ne faut pas diviser mais unir – donc adhérer à une histoire commune. Seule une histoire donne un sens à la vie (p.198) – donc une histoire particulière, patriotique, à construire et à transmettre. Avis au ministre Belkacem et aux pédagogos du mammouth ! Dompter la sauvagerie de l’homme pour rendre l’existence plus douce à tous est la voie d’Athènes, dit le Poète (Eschyle, lui aussi présent à la bataille de Marathon). Une grave leçon de notre culture – il y a déjà 25 siècles ! Leçon que l’inculture de nos politiciens est en train de nous faire perdre.
Alecos Papadatos et al., Démocratie (Democracy), 2015, bande dessinée Vuibert, traduit de l’américain, 237 pages, €21.00
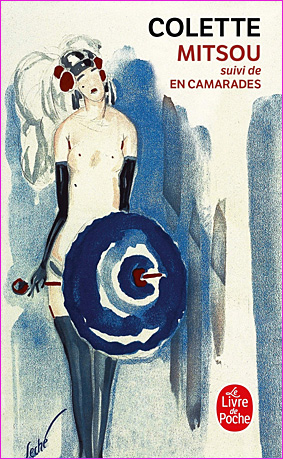

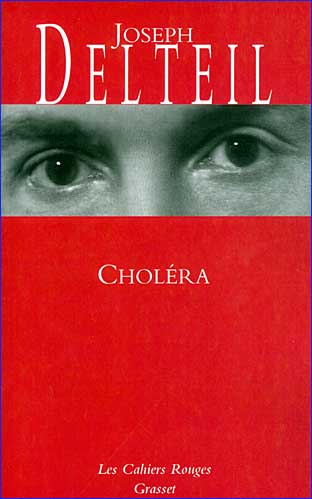
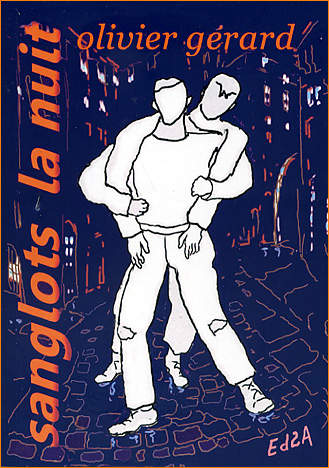
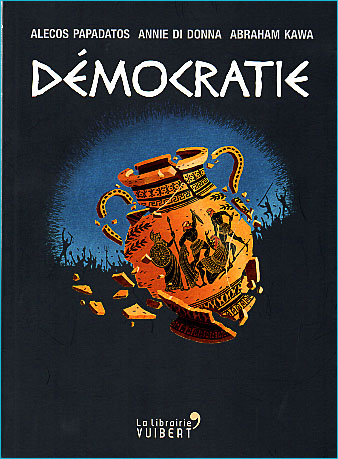



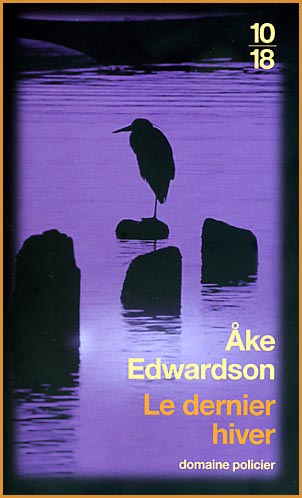
Commentaires récents