Ecrire est une démangeaison, un besoin, une ascèse. Tout le corps, le cœur et l’âme aspirent à s’exprimer par les mots, ce propre de l’humain en relation par le langage. Mais peut-on écrire ? L’art de la nouvelle est précis et exigeant, bien plus qu’un roman. Car il s’agit d’être concis tout en édifiant, de raconter « des histoires avec un commencement et une fin » (p.130) ou de tracer avec justesse des signes en quelques paragraphes comme un haïku sans rime – mais avec la même chute qui fait songer.
L’auteur livre ici plus une suite de textes de hasard qu’un recueil de nouvelles. Le spectacle du monde ravit l’observateur, il en brode aussitôt quelques lignes. Mais elles n’ont ni commencement ni fin, posées en suspension dans l’imagination. Ce sont le plus souvent des exercices de style et non des germes de romans comme chez Haruki Murakami, ou des anecdotes exemplaires comme chez Ernest Hemingway.
L’auteur l’avoue dès le premier texte : il a perdu le sol, cette note de la gamme : « le sol, sonorité primordiale et lieu d’initiation des Maobori » p.132. Sans le ton donné par le sol, peut-il exprimer une littérature ? Peut-il dire « l’émotion absolue » p.142 que tout littérateur recherche ? Au lieu de cela, il croit qu’il ne reste que « la sécheresse de ses mots, de ses phrases, de tout ce qu’il a essayé de faire vivre sur le papier » p.152. Or, si l’émotion génère la poésie, seul le trempage dans la froide raison permet au feu de forger une histoire.
L’auteur explore la glycine vivace et insidieuse, l’exposition de deux bambins pour faire vivre leur mère, le marché de l’art qui singe la violence urbaine pour mieux vendre ses défroques à la mode. Il a reviviscence d’une expérience culinaire chez les Papous où les vers blancs lui rappellent la chair de la sole que sa cuisinière est en train de lui préparer. Il cherche la sensation pour sortir du banal et va acheter une arme pour en menacer une pute et voir ce que le crime fait en vrai. Il a peur de n’être qu’une machine à écrire des lettres sans queue ni tête, alignées à la suite. Il se moque, car certains crieront au génie tant la transgression et l’exploration de toutes les impasses font bien dans l’univers de la mode artiste.
Il y a un peu de tout dans ces quinze textes, dont de vraies nouvelles et nombre de pages arrachées.
Philippe Barrot, Sol perdu, PhB éditions 2019, 155 pages, €12.00

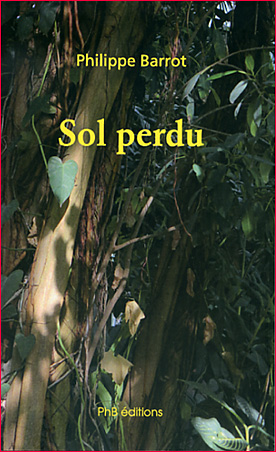
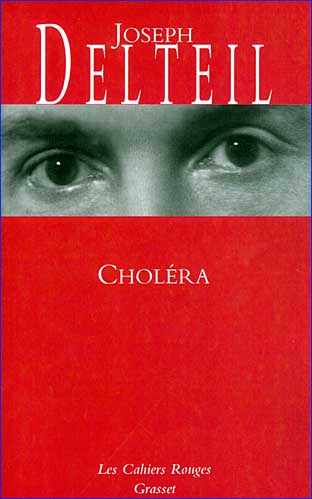
Commentaires récents