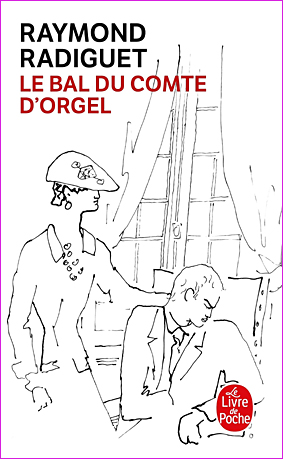
L’auteur du Diable au corps poursuit selon son âge l’exploration des sentiments d’amour, la grande affaire humaine. Alors qu’il avait entre 16 et 18 ans lorsqu’il écrivit les frasques sensuelles et sentimentales d’un adolescent de 15, il en a entre 18 et 20 lorsqu’il décrit cette fois les relations amoureuses d’un jeune homme de 20 ans.
François – le « je » du Diable au corps devait porter ce prénom selon les brouillons – est devenu Séryeuse et a acquis une particule. Il reste un côté potache chez Radiguet, l’enfant terrible des années folles qui fit tourner la tête de Cocteau. François de Séryeuse aime Mahaut, créole de la noblesse émigrée sous Louis XIII, qui aime son mari Anne d’Orgel, comte dont le nom remonte aux croisades, cité dit-il par Villehardouin. A noter encore qu’Orgel est l’anagramme de Legro… une autre potacherie. Lequel aime d’amitié mondaine François.
Radiguet adore décortiquer les sentiments et tenter de comprendre les actes de chacun plus que les actes eux-mêmes, qui semblent dictés par le destin – ou les pulsions. L’amour est irrésistible, même s’il n’est ni « convenable » ni « moral », ni mêle parfois souhaité. Les faux-semblants et les ambiguïtés abondent dans les relations humaines, surtout entre les hommes et les femmes.
Le canevas est celui de La princesse de Clèves, que Radiguet prisait fort (contrairement à Sarkozy). Ceux qui ont aimé les quiproquos, les relations bancales et le style amoureux de ce roman du XVIIe aimeront le roman de Radiguet. Il se passe dans les années folles, juste après la Grande guerre imbécile de 14-18 qui a ravagé cul par-dessus tête toutes les croyances, valeurs et vertus jusqu’ici admises. Rien ne valait plus après la boucherie absurde de la guerre industrielle provoquée par des badernes à l’honneur aussi archaïque et incongru que chatouilleux. L’après-guerre a été par opposition résolue à la fête, aux étourdissements des distractions, à la remise en cause sociale. L’usage du prénom Anne pour un homme, attesté durant la période féodale (Anne de Joyeuse, favori d’Henri III), apparaît comme un renversement du monde bourgeois au début des années 1920 tout comme un rappel de La princesse de Clèves, avec une discrète allusion à l’ambiguïté des amitiés masculines.
Le comte d’Orgel est de ces oisifs qui possèdent château et hôtel particulier et font des bals, aiment briller dans la conversation, tout en futilités et plaisirs. Il invite tous ceux qui sont de son milieu mais aussi ceux qui l’amusent. François de Séryeuse, oisif paresseux à la fortune familiale assuré est de ceux-là (un adolescent prolongé). Rencontré au cirque Medrano (encore une potacherie), Anne, François et Mahaut organisent une mise en boite du trop sérieux et prudent Paul Robin, diplomate arriviste, ami de Séryeuse, qui aime faire étalage de ses relations tout en faisant des cachotteries. A cachotterie, cachotterie et demi : ils lui font croire qu’ils se connaissent depuis longtemps alors qu’ils viennent de se rencontrer. Radiguet s’amuse.
Mais de fil en aiguille, de bals en dîners, de sorties en bord de Marne aux spectacles, le sentiment d’être bien ensemble se développe pour le triangle amoureux en amitié chaude puis en amour fantasmé des uns pour les autres, y compris d’Anne pour François. Il ne se passera rien, tout sera plus « convenable » que le diable au corps du garçon de 15 ans, mais tout sera aussi plus subtil et compliqué. Contrairement au premier, ce roman sera publié après la mort de l’auteur par son grand (petit) ami Cocteau.

Il est écrit simple et direct à la Stendhal, voué à l’analyse psychologique à la Madame de La Fayette. Un exemple de phrase concernant un personnage secondaire dit le style et me ravit : « Pensait-elle faire succéder ses séances de pose à d’autres séances ? François de Séryeuse entendit innocemment la phrase : pas une seconde la pensée ne l’effleura que Mrs Wayne pouvait disposer, pour le fatiguer, d’autres moyens que sa conversation. Il oubliait que cette Américaine était femme, et fort belle » p.44 La litote et la logique amènent une douce ironie qu’un lecteur empathique sait goûter.
Raymond Radiguet, Le bal du comte d’Orgel, 1924, Livre de poche 2003, 190 pages €7,20
DVD Le bal du comte d’Orgel, Marc Allégret, 1970, avec Jean-Claude Brialy, Sylvie Fennec, Bruno Garcin, Micheline Presle, Gérard Lartigau, LCJ éditions, 1h31, €10,18
Raymond Radiguet, Oeuvres complètes, Omnibus 2012, 896 pages, €19,00 e-book Kindle €18,99
Le diable au corps a été chroniqué sur ce blog.

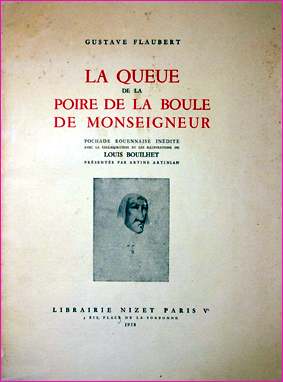

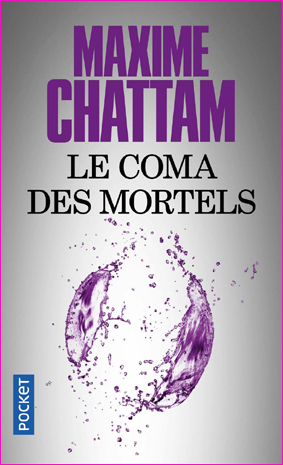

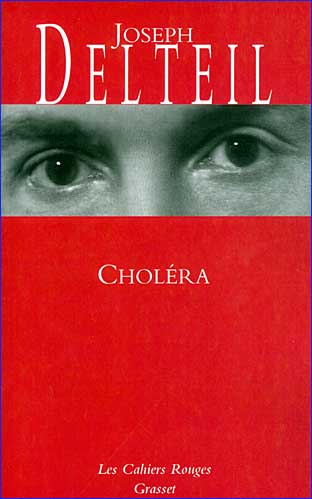
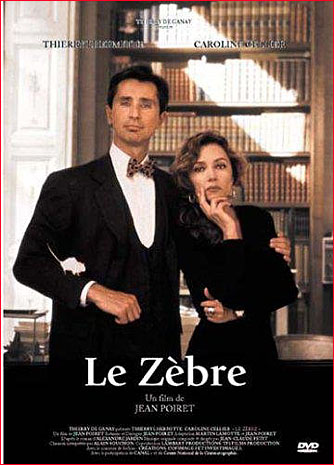






Commentaires récents