Etrange film des années 70, tout à fait dans la buñuelerie par son absence de logique et sa critique de l’absurde bourgeois. La liberté se cherche contre la répression, thème soixantuitard à la mode sous Giscard et « la gauche » s’engouffre bobotement dans la brèche de la contestation de tout. L’inverse de ce qui existe serait-il meilleur ? Ou la liberté est-elle une fumée impossible à saisir ? Il faudrait donc y renoncer ? Au profit évidemment de la science de l’Histoire selon saint Marx ? Car le titre du film affiche la couleur, repris de la première phrase du Manifeste communiste de Marx & Engels
On doute de l’inversion lorsqu’un couple de grands bourgeois fatigués, qui n’ont pour aventure que des histoires de bonne, trouvent « répugnantes » des photos données à leur fillette au parc Montsouris par un gentil Monsieur en noir qui l’a trouvée trop mignonne. Le spectateur s’attend à voir des scènes de sexe, surtout lorsque le mari (Jean-Claude Brialy) évoque ce qu’il a fait avec sa femme (Monica Vitti trop maquillée) à Milan… Mais il s’agit de cartes postales représentant des monuments. La « plus obscène » est évidemment – pour la gauche de mythologie – la basilique du Sacré-Cœur élevée en 1875 après la Commune et la défaite contre les Prussiens, pour expier selon l’Eglise la déchéance morale depuis 1789. Vu en 2018, c’est un brin lourdingue comme « obscénité » allant de soi.
Une assistante médicale (Milena Vukotic) qui part en Renault 16 voir son père à Argenton s’arrête pour la nuit dans une auberge de campagne. Elle y rencontre cinq moines des Carmes déchaussés qui lui demandent de prier saint Joseph avec eux dans sa chambre car « si tout le monde priait saint Joseph une demi-heure chaque matin, tout serait calme », puis se mettent à une partie de cartes qu’on n’ose qualifier d’endiablée, tout en sirotant vin blanc et clopes en misant des médailles de la vierge et des scapulaires. L’anticléricalisme bébête de Buñuel éclate une fois de plus dans la platitude. Et la séance de fouet infligé à un voyageur de commerce « qui n’a pas fait d’études » (Michael Lonsdale) par son assistante chapelière de cuir vêtue préfigure plutôt les partouzes bobos de l’ère Mitterrand à venir que la « contestation » de la sexualité bourgeoise.
Aussi lourde est l’histoire fort conventionnelle du jeune homme de 17 ans (Pierre-François Pistorio) amoureux de sa tante (Hélène Perdrière) qui a bien 20 ans de plus qu’elle. Il l’emmène à l’auberge en fuyant sa famille à particule et fratrie pour « la voir nue ». Ce fantasme très bourgeois serré est incompréhensible aujourd’hui, même s’il faisait bander Buñuel et si Pierre-François a le visage empourpré lorsqu’il ôte d’un coup les draps sur le corps nu de tantine.
Quant au terroriste (Pierre Lary) qui monte sur la tour Montparnasse pas encore terminée pour assassiner au fusil à lunette des passants au hasard dans la rue, il est un exemple d’inversion contestataire plutôt amère au vu de ce qui se passe dans les années 2000. L’ordure cravatée à lunettes est condamné « à mort » mais ressort libre du tribunal en serrant les mains de tout le monde. Quel est le message ? Qu’il est interdit d’interdire ? Ou que le « chacun pour soi » du narcissisme adolescent, né en 68 avec la génération trop nombreuse du baby-boom, affirme pouvoir tout se permettre ?
Les autorités sont bafouées : celle du préfet de police (Julien Bertheau) qui est arrêté alors qu’il va nuitamment ouvrir le caveau de sa sœur morte depuis quatre ans après lui avoir téléphoné, celle du vieux prof de droit à la caserne de gendarmes (François Maistre) qui voit ses « étudiants » aller et venir, pris par les besoins du « service », celle de la directrice d’école qui a « perdu » une élève (Valérie Blanco) alors que l’appel a été bien fait, que le nombre de filles dans la classe est bien le bon et que la fillette se présente, la bonne qui ne surveille pas la fille sous sa garde au parc contre les vilains messieurs, la tante qui tombe amoureuse de son trop beau neveu, l’homme d’affaires prospère qui se voit détecter un cancer du foie… Et après ? La subversion pour la subversion n’accouche de rien que du chaos.
En général, du chaos surgit un nouvel ordre fort, contraignant, dictatorial, pour dresser l’humanité dévoyée. Combien de fois dans l’histoire n’avons-nous pas assisté à cette séquence de révolution-réaction, où ce qui révolutionne va jusqu’au bout – c’est-à-dire revient à son point de départ, mais avec de nouveaux maîtres (comme on dit les nouveaux riches), le plus souvent plus bêtes et plus autoritaires que les précédents. Le communisme, tant vanté par le cinéaste (qui n’a jamais vécu sous son régime), a montré de quoi il était capable dans la « libération » des humains.
L’ouverture du film montre Tolède en 1808, durant la guerre napoléonienne ; des Espagnols rebelles (dont Luis Buñuel déguisé en moine) sont alignés prêts à être fusillés et crient « A bas la liberté ! » C’est cela la buñuelerie : la contestation bobo, au fond aussi bourgeoise, mais en petit. Ses films préfigurent l’inanité et la tranquille bêtise de la génération de petit-bourgeois « socialistes » éclose sous Mitterrand, épanouie dans « Libération », répandue dans le spectacle et le divertissement – pour le plus grand profit des faiseurs de fric.
Un film documentaire où une brochette de célébrités de l’écran se relaient pour une suite d’épisodes d’un surréalisme pesant moins loup que phoque. Il se laisse regarder mais laisse un goût de dégueulis sur cette époque de subversion à la mode. D’ailleurs Luis Buñuel se taira bientôt, ce fut son avant-dernier film.
DVD Le fantôme de la liberté, Luis Buñuel, 1974, avec Jean-Claude Brialy, Monica Vitti, Milena Vukotic, Paul Frankeur, Michael Lonsdale, François Maistre, Jean Rochefort, Pascale Audret, Adriana Asti, Julien Bertheau, Michel Piccoli, Claude Piéplu, Adolfo Celi, Pierre Maguelon, Maxence Mailfort, Marie-France Pisier, Orane Demazis, Ellen Bahl, Muni, Jacques Debary, Guy Montagné, Marcel Pérès, Paul Le Person, Bernard Musson, Studiocanal 2018, standard €11.44 blu-ray €13.89
Coffret 3 DVD Luis Buñuel : Le Charme discret de la bourgeoisie / Le Fantôme de la liberté / Gran casino, Studiocanal 2005, €86.00







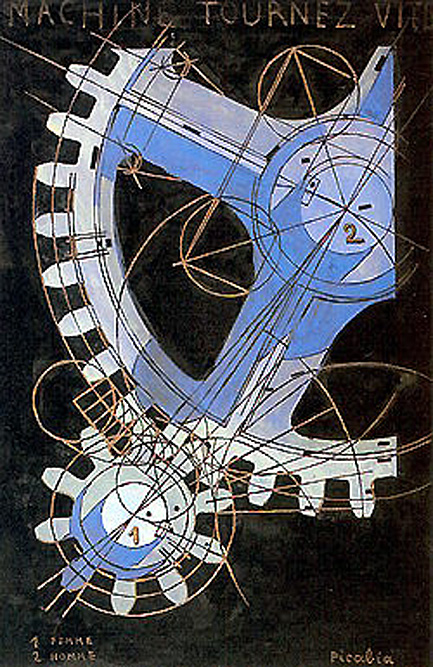



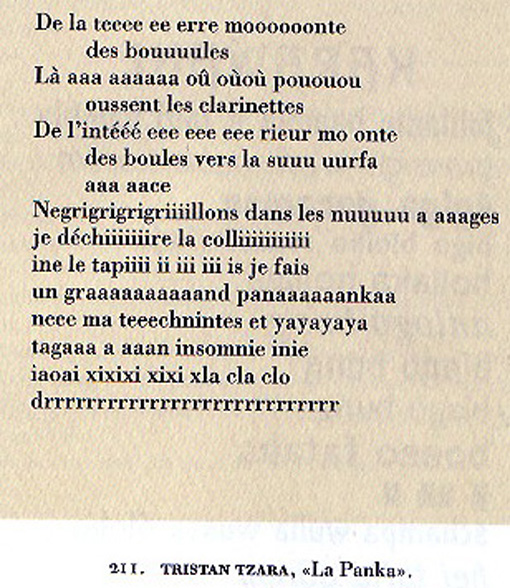

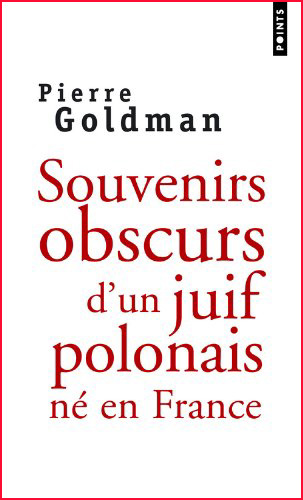


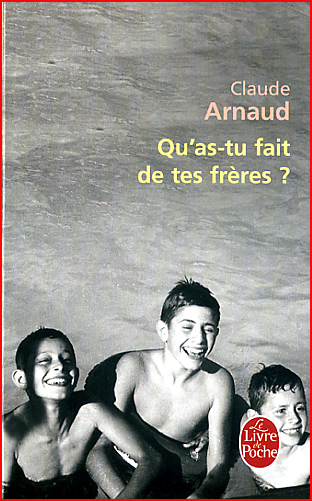
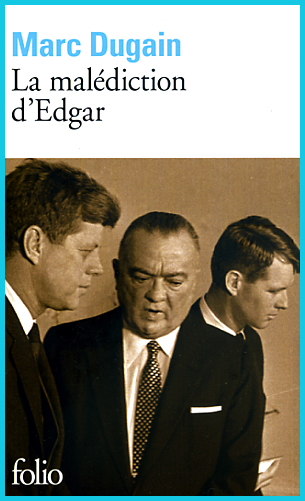

Commentaires récents