
En 1957, un peintre tranquille et froid de New York (Mark Rylance) est arrêté par le FBI pour espionnage. Dans son appartement et dans la chambre d’hôtel qu’il loue sous un autre nom, on trouve du matériel pour microfilmer des documents et autres outils d’espion. Il se fait appeler Rudolf Abel d’origine allemande mais a usurpé l’identité d’un collègue du NKVD en double façade ; il est en réalité William Fisher d’origine anglaise, à la tête d’un réseau d’espionnage nucléaire aux Etats-Unis pour le compte de l’URSS. Le premier plan du film le montre aux trois visages : le sien, celui du miroir et celui de l’autoportrait qu’il peint… Mais cela importe peu au film de Spielberg dont le propos est de démontrer la supériorité démocratique de l’Amérique sur les puissances totalitaires.
Le droit s’impose à tous, quelle que soit son origine, étranger ou pas, entré légalement ou illégalement aux Etats-Unis. Le personnage principal va donc être un avocat d’assurances habile à négocier pied à pied, James Donovan (Tom Hanks). Le Département d’Etat exige de son cabinet qu’il défende l’espion arrêté pour montrer au monde entier comment fonctionne le système démocratique que tout le monde devrait nous envier. Le film est sorti avant l’élection de Trump…

Donovan se fait tirer l’oreille, il n’a pas de compétence récente au pénal et défendre un ennemi qui vise à détruire son pays n’est guère sa tasse de thé. C’est d’ailleurs l’opinion de sa famille et même l’opinion commune, vite poussée au lynchage sans aucune forme de procès. Mais, en ce cas, pourquoi ne pas avoir purement et simplement descendu l’espion pour l’exemple ? Puisqu’il y a procès et que Donovan accepte (sous la pression de son associé comme de l’Etat), il fera bien son boulot. C’est un mantra américain que de bien faire son boulot, à quelque place qu’on se trouve dans la société. Si chacun accomplit sa mission, tout doit se passer au mieux selon les principes libéraux (la recherche par chacun de son propre intérêt conduit à l’équilibre global du marché et de la société). C’est autre chose que « l’engagement » sartrien en France, activisme visant à imposer une idéologie. Pas d’idéalisme aux Etats-Unis, mais les intérêts bien compris. Donovan le répète au policier qui lui reproche d’être l’avocat d’un ennemi, à son fils de 10 ans (Noah Schnapp) à qui l’école fait peur sur la bombe atomique, à l’agent de la CIA qui veut lui voir faire ce qu’il commande, à Rudolf Abel lui-même, à qui il reconnait un caractère de « bon soldat » loyal. Comme lui, il n’a pas peur de bien faire ce qu’il doit, comme un moujik stoïque, selon une histoire de sa « légende » que lui raconte Abel qui s’est dit avoir été impressionné enfant par un paysan qui se relevait après chaque coup de ceux venus l’arrêter.

Malgré les pressions, y compris celle d’un groupe d’excités qui tire sur son appartement, effrayant sa fille aînée (Eve Hewson), malgré le juge (Dakin Matthews) qui balaye d’un effet de manche l’erreur de procédure de l’absence du mandat de perquisition pour fouiller l’appartement de l’espion, malgré la CIA qui veut une condamnation à mort, l’avocat Donovan va accomplir sa mission selon son art. Il parvient à convaincre le juge, qu’il connait bien, de ne pas requérir la chaise électrique mais l’enfermement à vie, au cas probable où un espion américain serait pris en URSS. D’autant qu’il n’y a pas de preuves directe d’espionnage contre Abel, seulement des preuves induites. Il échoue cependant devant la Cour suprême à faire casser la sentence au nom du quatrième amendement mais est félicité pour sa défense.

C’est ce qui va arriver le 1er mai 1960. Dans leur arrogance technologique et leur aveuglement patriotique, les galonnés de l’US Air Force croient qu’espionner l’URSS depuis la très haute altitude (plus de 20 000 m) avec un avion léger muni d’un bouton d’autodestruction, équipé d’appareils photo au zoom de 4000 fois, leur permettra d’opérer impunément sans avoir à se salir les mains en envoyant ou soudoyant des hommes (ils firent la même erreur en Irak et en Afghanistan). Le jeune pilote fanfaron Francis Gary Powers (Austin Stowell), capitaine dans l’US Air Force, se fait descendre au-dessus de l’URSS, survolant une base militaire d’Iekaterinbourg. Si les Mig soviétiques ne volent pas aussi haut que lui, les missiles atteignent sans problème cette altitude, chose que les niais de l’armée n’ont semble-t-il pas envisagée… Il est donc abattu. S’il appuie bien sur l’autodestruction, son siège éjectable fonctionne mal, ce qui le tient lié à l’avion. Il n’a aucune envie de suicide, comme son commandant l’a exigé (sur le modèle des kamikazes japonais ?) ; il annule donc l’autodestruction – ou pas – la scène est très rapide et le cordon se rompt avec l’avion à ce moment précis. Lui dira qu’il l’a fait, les Soviétique exhiberont des débris intacts de l’avion.
Mais Abel ne révèle rien et ne veut pas collaborer ; il ne sert donc que de monnaie d’échange possible. Par les moyens détournés d’un avocat est-allemand (Sebastian Koch), les Organes soviétiques font savoir sans que ce soit officiel qu’un échange peut être envisagé. Donovan est donc pressenti par Allen Dulles lui-même (Peter McRobbie), alors patron de la CIA, pour aller négocier à Berlin-Est. James Donovan n’est pas un inconnu des services américains : il a été le directeur du contentieux de l’Office of Strategic Services, ancêtre de la CIA et est commander (capitaine de frégate) de la Marine américaine. Il part donc dans la gueule du loup sans accréditation officielle, en « simple citoyen » qui défend son client, le faux Abel. Powers ne restera que quelques mois en prison car il ne parle pas plus qu’Abel et la construction du mur de Berlin dès le 12 juin 1961 envenime les relations tendues entre Etats-Unis et URSS. Un échange d’espions permet de faire baisser la tension, chacun reconnaissant l’autre comme adversaire digne de négocier.

La stupidité d’un étudiant américain en économie de 25 ans, Frederic Pryor (Will Rogers) qui n’a rien trouvé de mieux que d’aller se fourrer dans la gueule du loup en pleine guerre froide, conduit à son arrestation par la RDA non reconnue par les Etats-Unis. La naïveté idéaliste de certains Occidentaux laissent toujours pantois : les « humanitaires » qui vont s’occuper des populations en pleines zones terroristes ou les touristes inconscients et se font prendre en otage n’apprennent jamais. Donovan, venu pour échanger Powers, va exiger Pryor en plus, qui a l’âge de sa fille aînée et qui ne sert à rien aux Soviétiques. Sauf qu’il s’agit de l’Etat de la RDA, certes fantoche, mais fictivement indépendant. Il va donc ruser pour obtenir les deux à la fois auprès de deux interlocuteurs différents. La RDA voudrait négocier une reconnaissance internationale, l’URSS récupérer son espion. Mais l’avocat Donovan fait savoir au procureur est-allemand (Burghart Klaußner) que s’il refusait le deal, son occupant soviétique ne serait pas content.
L’échange se fait donc – vite – sur le pont des espions de de Glienicke à 5h30 du matin un samedi pour éviter la publicité. Pryor est relâché, avec un retard de mauvaise humeur de la part de la RDA, au check-point Charlie. Le faux Abel, qui ne s’est jamais départi de son calme glacé (« Vous devriez vous en faire ! – Ce serait mieux ? »), ne quitte pas son avocat sans quelque émotion. Il a bien fait son boulot, comme lui-même pour l’autre camp. Il lui laisse le portrait qu’il a peint de mémoire en prison, montrant que l’accusé a beaucoup pensé à son défenseur.

James Donovan publiera en 1964 un livre, Strangers on a Bridge -The Case of Colonel Abel, traduit en français sous le nom de L’affaire Abel, pour raconter son expérience. Steven Spielberg insiste en nombreuses scènes sur la « barbarie » soviétique du mur d’où l’on tire sur les évadés, les prisons humides et glauques, les interrogatoires quasi nazis – par contraste avec les rues opulentes de Brooklyn, de la famille soudée américaine, des prisons confortables où l’on peut dessiner. C’est un peu gros, c’est américain. Mais ce film d’espionnage est bien monté et captive, d’autant que l’histoire est vraie et peu enjolivée.
DVD Le Pont des espions (Bridge of Spies), Steven Spielberg, 2015, avec Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda, Sebastian Koch, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Austin Stowell, 20th Century Fox 2016, 2h17, standard €4.99 blu-ray €12.97





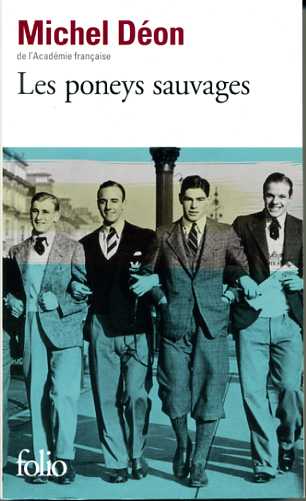
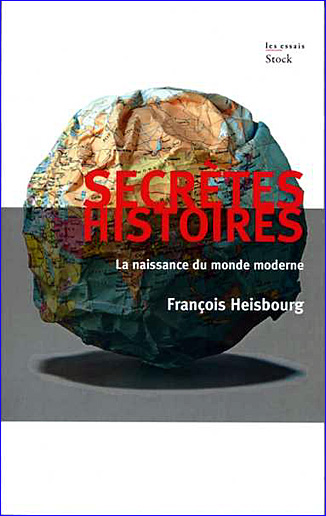




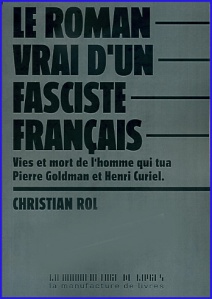












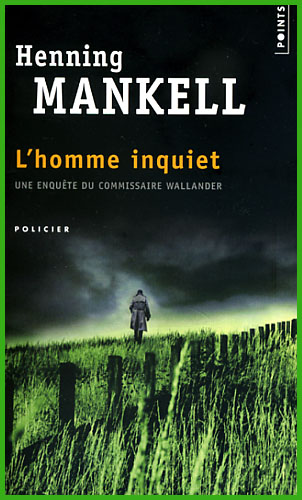



Commentaires récents