Les poneys sont ces jeunes hommes, trois Anglais, deux Français, qui se rencontrent à Cambridge avant de vivre la guerre, puis l’après-guerre. Leur sauvagerie est déboussolée par la médiocrité et le sordide de l’époque. Ils sont aussi le rappel de la nature, ces poneys aperçus un matin de Blitz par la fenêtre d’une auberge de la New Forest par Georges, l’un des membres. Symboles de la vie obstinée qui va, de la nature vigoureuse sans cesse recommencée, des enfants de ces pères désabusés qui forceront leur destin dans le déclin de l’homme blanc. « Nous avons tout à apprendre de cette génération à laquelle nous avons inoculé, sans le savoir, un immense dégoût de l’humanité, du bien, du mal, de l’ordre comme du désordre » p.266.
Comme chacun sait, les Trois mousquetaires étaient quatre, plus l’auteur. Michel Déon reprend le mythe avec Georges le Français en Athos, flanqué d’un fils de hasard (Daniel en Bragelonne), Barry en Porthos ayant une revanche de bâtard à prendre sur la vie (rapprochement avoué p.374), Cyril en Aramis beau, séduisant et poète, et Horace en d’Artagnan – tout aussi fidèle et mourant au service de la patrie. L’auteur se pose en Dumas, ayant nommé son fils Alexandre.
Tout commence en 1938 et se termine juste avant 1970, la guerre chaude se transformant très vite en guerre froide où les étudiants doués de Cambridge trouvent leurs repères mais s’y perdent, changeant d’existence comme d’identité. Seul l’auteur, en quête des personnages, reconstitue le fil. Ce ton distancié, ce style enquêteur, la variation des récits, des témoignages et des lettres, font le charme de ce gros livre.
Michel Déon y rassemble tout son propre univers : Cambridge, Florence, Positano, l’Algérie, Spetsaï, Paris. A 41 ans, il livre une sorte de bilan littéraire de ses inspirations. « La Grèce et la mer Egée où tout est toujours si beau que l’on a envie de se dépouiller, de retrouver la nudité antique pour que le corps entier goûte à la vie » p.461.
Mais ses personnages le mènent, tous un peu fous, hantés de passions qu’ils ne savent porter qu’à l’incandescence. « La passion rétrécit la vie parce qu’elle la dévore. Elle brouille les heures et les jours, elle emplit nos rêves et nos veilles, elle efface la réalité paisible, le sain mûrissement des êtres et des choses. (…) La passion reste la seule dynamique de la vie. Il faut lui être reconnaissant des œillères qu’elle pose, de son entêtement, de ses folies et de l’état de veille extralucide où elle nous maintient » p.466.
Passion que le renseignement et la manipulation ; passion que le communisme clandestin en Occident ; passion que l’amour impossible ou que l’aventure guerrière. Tous y cèdent, fors le narrateur, dont la passion est d’analyser celle des autres. Il sait chroniquer avec affection l’évolution de Daniel, son filleul, que sa mère ignore carrément et que son père trop souvent absent connait mal. Avec le petit garçon le parrain va camper dans la montagne, lui fait avouer une grave faute à dix ans, main dans la main à Nice, et prendre sa responsabilité, le recueille dans son île grecque à 18 ans, le conseille sur l’amour qu’il voue à la sœur de Cyril, Délia, possédée par son frère mort… « Daniel est comme un fils. Je l’aime et le protège autant qu’il me le permet » p.445. « J’ai été son ami depuis sa petite enfance et il m’a appris à aimer les enfants, ce dont je ne lui serai jamais assez reconnaissant » p.177. Ces remarques remuent quelques cordes en moi.
Ce qui a « choqué » les bien-pensants de 1970 sont la « révélation » que les massacres de Katyn (p.147) ont bien été le fait des communistes soviétiques, et le rappel d’une vérité soigneusement occultée qui veut qu’en 1962, la reddition des combattant de la Willaya IV de Si Salah (pp.205 et 223), ait été méprisée pour des raisons de vile politique, le général de Gaulle ayant préféré négocier avec les politiciens du FLN soigneusement planqués au-delà de la frontière tunisienne. Se mettre à dos les communistes et les gaullistes ne pardonnait pas dans la France étriquée qu’on nous vante aujourd’hui par nostalgie du « c’était mieux avant ». Rien de plus con qu’un dogmatique, qu’il soit de gauche ou de droite. Ces querelles de « vérité » sont insignifiantes en 2017, non que les imbéciles aient changé, mais ils ont investi un autre dogme à croire. « Il était possible que la vérité ne servît plus à rien, sinon à fausser les rapports de force, autre vérité plus profonde dont, un jour, sortirait un nouvel équilibre » p.302.
Roman d’une époque, d’une impitoyable critique sociale, d’une intense curiosité pour la vie – il se dit que Les poneys sauvages est le meilleur qu’ait produit l’auteur. Ce qui est sûr est qu’il a reçu le prix Interallié (décerné par un jury de journalistes) à sa parution. Je l’aime beaucoup.
Michel Déon, Les poneys sauvages, 1970, nouvelle éditions revue Folio 2010, 564 pages, €9.30
e-book format Kindle, €8.99
Les romans de Michel Déon chroniqués sur ce blog

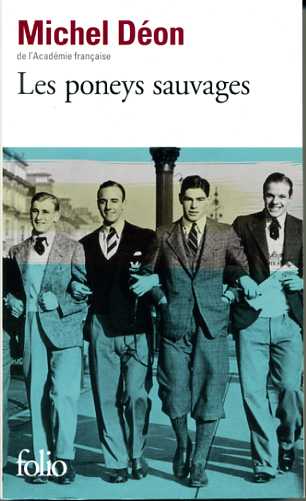
Commentaires récents