Une fortune carrée est une voile de très gros temps : celle que monte Henry de Monfreid sur son mât en mer Rouge lorsqu’il veut passer le détroit de Bab-el-Mandeb. Elle symbolise la « chance » pour Kessel, cet esprit d’initiative et ce courage dans l’aventure qui permet de s’en sortir dans les tempêtes, qu’elles soient sur mer, sur terre ou dans les âmes. Revenu du Harrar et du Yémen, ayant publié son reportage à gros succès Marchés d’esclaves, Kessel fait de ces « choses vues » un roman. Les personnages sont inventés, le décor est vrai.
Trois personnages rythment trois parties : le comte Igricheff, un bâtard kirghize de russe élevé à cheval, « demi-nu » jusqu’à l’âge de raison où son père le reconnait et le fait éduquer ; Kessel en a pris le modèle sur le consul soviétique du Yémen, Bers, prince Eristoff. L’aventurier français Mordhom est la caricature touchante d’Henry de Monfreid. Enfin Philippe, jeune riche parisien venu enfin « vivre » dans l’aventure des romans qui ont bercé son enfance après un chagrin d’amour ressemble au jeune frère de l’auteur, Lazare, tendrement chéri jusqu’à son suicide pour une femme, incompréhensible.
La première partie se déroule au Yémen, l’Arabie heureuse sous la férule de son imam redoutable qui fait la guerre aux Zaranigs et la gagne. Igricheff, chef de mission commerciale révoqué et rappelé à Moscou par les Bolcheviks, décide de partir à l’aventure pour lui tout seul sur le cheval de l’imam Chaïtane (le diable). Il emporte la caisse du consulat et s’allie aux Zaranigs pour défendre la côte, dans un combat sans espoir mais empli de panache « à la russe ». La seconde partie voit le bâtard poursuivi attraper in extremis le boutre de Mordhom qui quitte le pays sans avoir pu vendre sa cargaison d’armes. Il navigue en eaux troubles pour gagner la côte d’Abyssinie, essuyant la menace d’arrestation d’un émir à Moka puis une redoutable tempête, avant d’échouer dans l’antre de Mordhom, une oasis cultivée sur le plateau de Dakhata où le repos libère. La troisième partie est pour le jeune Philippe, affectionné de Mordhom qui voit en lui un être à « chérir et protéger », une sorte de filleul à initier, lui confiant la mission de convoyer les armes invendues au marchand d’esclaves Saïd dont la caravane du Harra va éviter les postes officiels et acheter le tout pour livrer en Arabie.
L’imaginaire et l’exotisme sont à leur paroxysme dans ce roman pour adolescent qui peut toujours se lire tant il captive. Ainsi Moka, décrite p.813 : « le choc de la beauté. A la clarté suprême du clair de lune, se détachait du bleu-noir de la mer et du pelage fauve des dunes une immense ville d’argent. Remparts et bastions, minarets en fuseaux, palais et maisons hautaines nouaient et dénouaient leur réseau fantastique comme dans un rêve délicat et nacré. Toute la puissance, tout le charme et tout le secret de l’Arabie des contes semblait dormir là, derrière les murailles massives, au fond des demeures blanches où Philippe croyait voir, dans les cours dallées de marbre et bruissantes de jets d’eau, vivre des femmes nonchalantes, enfin dévoilées, heureuses de respirer la nuit ».
C’est un conte dans la lignée d’Alexandre Dumas pour la chevauchée du style et de Robert-Louis Stevenson pour la saveur des passions jeunes. Les femmes n’ont pas leur place dans cet univers mâle et, qui plus est, musulman. La seule fille « à peine pubère » Yasmina est une bergère enlevée par le chaouch attaché à Igricheff et « donnée » à Philippe avant de finir sous la protection de Moussa, demi-esclave mais brave et fort. Les uns et les autres sont-ils consommé leur conquête ? Rien n’est dit, le livre peut être laissé entre toutes les mains. Tout est pris comme faits : de l’empire absolu des imams au rôle subalterne des femmes en islam et à l’esclavage admis et encouragé par le Coran. Les aventuriers prennent le monde tel qu’il est et les circonstances comme elles viennent ; ils s’adaptent pour vivre de tous leurs sens le paroxysme de leurs passions. C’est cela qui fait la beauté de ce roman candide, issu du réel côtoyé en reportage mais magnifié par le rêve. La sauvagerie des paysages et des tribus envoûte littéralement les jeunes hommes et l’auteur la fait partager au lecteur, liant le paysage à l’état d’âme.
L’amitié entre mâles est célébrée à la manière des scouts ou de l’armée, la fraternité des épreuves et du combat est plus intense que les bras d’une femme qui « lient » et empêchent. « Quand hurle l’instinct de la vie, les autres voix se taisent » p.879. Car à l’époque, Alexandra David-Néel, Ella Maillart, Isabelle Eberhardt étaient des exceptions ; le risque n’était guère pour la gent féminine. Igricheff fait de l’aventure un pillage à la Mongol, une pure mystique d’exister ; Mordhom veut s’enrichir mais cela reste secondaire, la vie qu’il mène en liberté auprès de jeunes sauvages lui suffit ; quant à Philippe, il a encore une âme d’enfant pure et idéaliste, il vit l’aventure comme un grand jeu fraternel.
La contrepartie de se mettre constamment en danger est la souffrance mais surtout la solitude : abyssale chez Igricheff, tempérée par les indigènes chez Mordhom, elle est contrée par les camarades chez Philippe. Jusqu’à la mort car « il était trop blanc pour vivre » p.966, trop civilisé, trop imbu de sa supériorité rationaliste et technique. La solitude révèle à soi-même, « un étincelant miroir qui réfractait toutes les émotions, tous les espoirs, tous les effrois » p.925. Allez dans le désert, vous le vivrez ; je l’ai vécu au Sahara, dans ces abîmes qui hantaient Pascal.
Joseph Kessel, Fortune carrée, 1932 (revu 1955), Pocket 2002, 320 pages, €5.50
DVD Fortune carrée, Bernard Borderie, 1955, avec Pedro Armendariz, Paul Meurisse, Pathé, 1h48, occasion
Joseph Kessel, Romans et récits tome 1 – L’équipage, Mary de Cork, Makhno et sa juive, Les captifs, Belle de jour, Vent de sable, Marché d’esclaves, Fortune carrée, Une balle perdue, La passagère du Sans-Souci, L’armée des ombres, Le bataillon du ciel, Gallimard Pléiade 2020, 1968 pages, €68.00



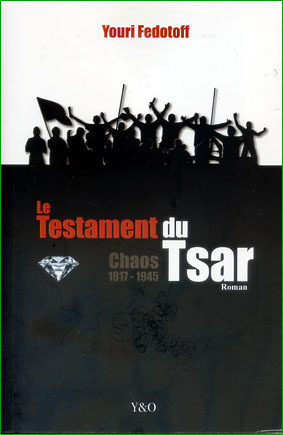



Commentaires récents