
Dans le numéro d’avril 2024 de la revue La Recherche trimestrielle, le sociologue Bernard Lahire accorde un entretien à propos de son nouveau livre paru en septembre 2023,Les structures fondamentales des sociétés humaines.
Un peu comme Mélenchon lorsqu’il déclarait, tout colère, « la république c’est moi ! », le sociologue Lahire, dont le nom est entré dans le Petit Larousse en 2023, et et qui a appelé à voter Mélenchon à la présidentielles 2022, semble dire : « la sociologie de notre espèce, c’est moi ».
Il part d’un fort sentiment de nécessité à propos du dérèglement climatique et de la destruction de la biodiversité « qui peuvent conduire à une extinction de notre espèce. » Le relativisme des sciences sociales ne permet qu’une vision morcelée, sans synthèse opératoire. Pour lui, il faut penser Homo sapiens « dans une continuité évolutive. » A l’inverse, les sciences sociales ont voulu établir une frontière nette entre elles et la biologie, au prétexte que tout dans l’humain est culturel, donc historique.
Or c’est faux. « Non seulement les formes de vie sociale sont partout présentes dans le règne animal, mais la culture et sa transmission s’y manifestent aussi ». Et de citer les chants d’oiseaux, de baleines, les outils utilisés par certains oiseaux pour ouvrir des coques ou des mollusques, le lavage des patates douces chez les macaques japonais et ainsi de suite. « La blessure narcissique » de l’humain depuis Darwin, n’a pas encore été surmontée. L’homme se croit toujours, comme Platon et la Bible, comme essentiellement pur esprit, la chair n’étant qu’une étape à dompter ou nier. Quant au danger supposé de la sociobiologie, assimilée au nazisme, il ne facilite pas la réflexion des sociologues pour la plupart orientés résolument à gauche.
« La sociologie est souvent définie comme étant la science des sociétés. Or, si cela était réellement le cas, elle devrait s’occuper autant des sociétés animales non humaines que des sociétés humaines. » Il faut donc raccorder biologie et sociologie car la biologie évolutive permet de savoir dans quelles conditions les formes de vie sociale apparaissent. Surtout, il semble exister « une coévolution gènes–culture. En construisant culturellement son environnement, Homo sapiens a contribué à modifier les pressions sélectives qui perdent pèsent sur lui. »
Bernard Lahire utilise la méthode comparative.« Il y a deux choses bien distinctes : d’une part des invariants sociaux dans toutes les sociétés humaines, et d’autre part des convergences culturelles entre des sociétés qui se sont développées indépendamment les unes des autres. » Et de noter, contrairement à la doxa féministe et woke, qu’« on ne connaît aucune société humaine, par exemple, qui est été dépourvue de tout rapport de pouvoir ou de domination. » Il ajoute, en enfonçant le clou, « la domination masculine est présente dans l’immense majorité des sociétés documentées ». Bien sûr, certaines sociétés manifestent un certain équilibre des pouvoirs entre hommes et femmes, « mais aucune n’a donné les pouvoirs politiques, religieux, guerriers et économiques aux femmes. » Cela ne justifie pas le présent, mais permet de le comprendre – donc de le faire évoluer, si c’est utile. Une plus grande égalité entre homme et femme peut développer des formes d’échanges et d’entraide meilleures pour la survie de notre espèce.
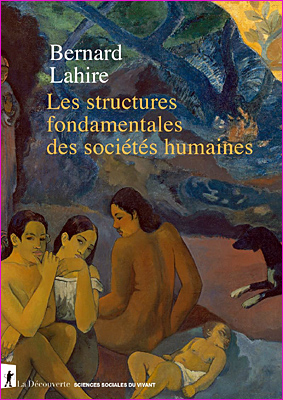
Son livre formule 17 lois générales de fonctionnement des sociétés humaines qui se combinent avec des faits anthropologiques et des lignes de force historiques. Par exemple, la domination masculine repose sur un grand fait anthropologique : la partition sexuée. « En tant que mammifères, les femmes sont seules à porter les bébés et à pouvoir les allaiter, ce qui, depuis 3 millions d’années que le genre Homo existe, a créé un lien très fort entre la mère et l’enfant, et a eu des conséquences en matière de division sexuelle du travail. » Le type de relation qui s’instaure entre l’enfant et ses parents est un rapport de dépendance et de domination. « Or, les femmes étant associées au pôle de vulnérabilité de l’enfance, elles vont être considérées dans de très nombreux sociétés humaines comme des enfants, des filles, des cadettes, des mineures. » Ce qui lui permet d’avancer l’hypothèse que le rapport de domination parents–enfants « fournit la matrice du rapport homme/femme ». Ce pourquoi à mon avis, pour rééquilibrer les pouvoirs, il est important que les pères s’occupent plus de leurs enfants.
Un exemple de biologie évolutive est fourni dans le même numéro de La Recherche, par un article de Thierry Lodé, biologiste émérite à Rennes. Pour lui, le plaisir sexuel n’est pas l’apanage de l’espèce humaine mais procure un avantage évolutif parce qu’il renforce les comportements d’activités sexuelles et reproductrices. Avoir des rapports plus fréquents permettrait de compenser la diminution de la progéniture en raison de la fécondation dans l’utérus plutôt que par des œufs multiples. Les procédures de récompense des hormones font naître le plaisir. « Puisqu’il faut s’accoupler souvent pour produire, plus, l’orgasme accompagné d’un sentiment de plaisir procure une gratification suffisante pour s’engager dans des actions non reproductives telles que les relations sexuelles anales ou orales, la masturbation ou le comportement homosexuel (…) courants chez un grand nombre d’espèces, notamment les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. » Il s’agit d’une observation qui explique, pas d’une norme qu’imposerait « la nature », ce concept flou. L’humain est fait d’interactions sociales, donc de permis et d’interdit, même s’il appartient au règne animal parmi le vivant.
Les sociétés humaines font partie de l’ensemble des sociétés, y comprise animales, démontre Bernard Lahire. « Nous partageons par exemple avec nombre de mammifères les faits de communication entre membres d’un groupe, de leadership, de hiérarchie, de dominance, d’exogamie et d’évitement de l’inceste, de conflits entre groupes, ou encore de réconciliation après conflits. » En revanche, nos capacités symboliques, notamment le langage oral qui permet de parler de choses passées, absentes, à venir ou même inventées, « nous a mis sur la voie du magico–religieux, présent dans toutes les sociétés humaines et absent des sociétés non humaines. » Notre espèce innove parce qu’elle vit longtemps et communique, ce qui permet de longues accumulations des expériences et des savoirs ainsi qu’une transmission culturelle sur des générations.
Notre espèce est même qualifiée « d’hyperculturelle » parce qu’elle produit des techniques qui augmentent nos capacités : aller à grande vitesse, faire porter par des machines des poids très lourds, voir mieux que nos yeux. « En un mot, notre culture nous a fait accéder à une réalité augmentée ». Cet effet culturel et technique a façonné notre environnement et « a eu des effets en retour sur notre biologie en exerçant des pressions sélectives ». Par exemple, le raccourcissement de la mâchoire, de la taille de notre intestin, est dû à la cuisson des aliments ; notre corps a produit l’enzyme lactase pour digérer le lait après l’enfance, à cause de notre pratique de l’élevage ; notre cerveau a augmenté de taille, particulièrement le cortex préfrontal, du fait de l’augmentation de la taille de nos sociétés, de la complexité de nos relations sociales et de l’usage de techniques de plus en plus complexes.
Cette synthèse des connaissances de Lahire est aussi un programme pour les chercheurs. « Il me semble que les étudiants de sciences sociales devraient suivre des cours de biologie évolutive, d’éthologie, de paléoanthropologie, de Préhistoire, entre autres. S’ils recevaient une telle formation, ils ne feraient pas le même genre de sciences sociales. » Tout n’est pas culturel en termes d’organisation sociale humaine. « Le postulat du tout culturel ne tient pas ». En fait, « chacune de nos actions ou de nos pratiques se comprend au croisement de tout notre passé incorporé, sous la forme de disposition à agir, sentir, penser, ou de compétences, et des propriétés du contexte dans lequel nous agissons. »
Enfin une sociologie non-marxisante, qui sort du dogme de l’infrastructure qui détermine la superstructure pour examiner les relations d’interactions mutuelles et élargir à TOUTES les sociétés, même non humaines. Un savoir augmenté. En ces temps d’« intelligence » artificielle qui est susceptible de prendre le pouvoir de façon automatique, il était temps !
Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines, 2023, La Découverte, 972 pages, €32,00 e-book Kindle €23,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)















































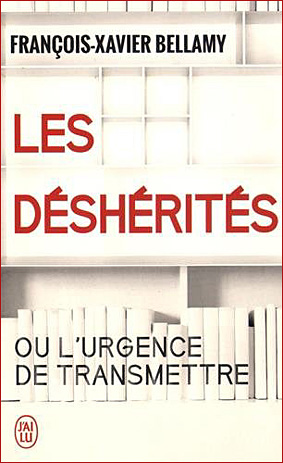




















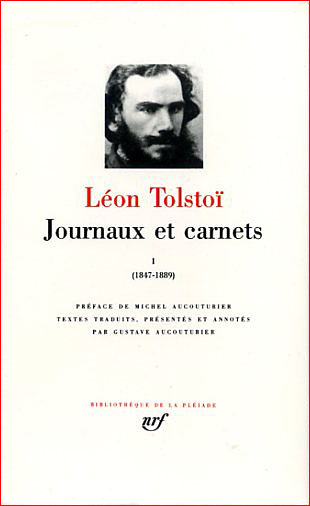










Commentaires récents