Quand les années 1970 se projettent en 2293 – soit dix générations plus tard – ce qu’elles voient n’est pas bon. Le film est écrit après les événements de 1968 un peu partout dans le monde et l’Irlande, pays du tournage, apparaît comme un havre préservé, encore archaïque. Le futur est une utopie écolo-hippie où la technologie (déjà) a permis à une élite savante de se préserver dans une bulle tandis que le monde normal s’en va à vau l’eau. Ce thème m’avait séduit lorsque j’ai vu ce film à sa sortie : les intellos dans le cristal, les brutes dans la merde. Ce n’était pas à la mode et difficilement audible en ces années de gauchisme d’ambiance.
Sauf que les intellos du film, efféminés et androgynes, ayant banni le sexe pour cause de féminisme et l’agressivité pour cause de technologie maternante, ne font plus rien, ne chassent plus rien, ne plantent plus rien. Ils vivent en fermettes coquettes comme Marie-Antoinette à Trianon – mais c’est bien « le peuple » comme hier qui fournit le blé. Pour cela, il faut le forcer, rétablir donc la domination – cette abomination de la nouvelle bible de gauche écolo – et, pour cela « sélectionner » – mot abominable de l’idéologie adverse – des contremaîtres qui vont sévir et faire bosser. Donc rétablir la crainte universelle – et pour cela quoi de mieux qu’une nouvelle religion terrifiante ? Les intellos divins, les soldats politiques et les hilotes cultivateurs : ne voilà-t-il pas les trois ordres de l’Ancien régime reconstitués ?
La religion se révèle sous la forme d’un masque de théâtre grec nommé Zardoz, la gueule grande ouverte et la voix profonde, qui surgit des nuages sur la 7ème symphonie de Beethoven. Mais ce vaisseau – car c’en est un – est actionné par un « éternel » (comme les autres), chargé de tenir les terres extérieures au vortex bulle. Arthur Frayn (Niall Buggy) s’inspire du Magicien d’Oz (The Wizard of Oz – d’où zard’oz), parabole 1900 destinée aux enfants de la grande dépression 1883-1897 aux Etats-Unis, pour inventer le nouveau monde post-industriel de l’an 2293. Il sélectionne des exterminateurs qui seront chargés dans un premier temps de « débarrasser la terre » des nuisibles inutiles que sont les brutes ; il leur fait violer les filles et tuer les mâles afin de produire une race nouvelle mieux adaptée à ce monde en ruines ; il ordonne aux exterminateurs de réduire en esclavage ceux qui sont aptes à travailler et de les faire cultiver la terre afin d’enfourner dans la gueule de Zardoz les « offrandes » de ses adorateurs. Contre livraison du blé, il jette fusils, pistolets et munitions sur la terre. Et le peuple est content, il « croit » ; et les exterminateurs sont contents, ils « chassent » l’humain, violent, tuent ou fouettent ; et les intellos écolos sont contents, ils « ont le blé sans l’argent du blé », juste par leur ruse de clercs.
Après avoir déconstruit ce monde en 68, ce film démontre cinq ans après les engrenages d’une reconstruction anti-utopique. Car les grands mots des belles âmes du new age sont du vent devant la nécessité. Vivre en bulle, c’est confortable : fusionnel, dans un éternel printemps, ami-amie avec toutes et tous, sans peine ni douleurs, sans travail ni enfantement – une vraie Bible à l’envers ! Mais ne serait-ce pas de l’orgueil ? Le péché est puni par la loi divine chez les chrétiens. Dont acte.
Car le chef des exterminateurs Zed (Sean Connery), le plus impitoyable et le plus agressif – mais aussi le plus intelligent, un vrai James Bond 007 – est mandaté pour découvrir ce qui se cache dans le masque de Zardoz. Il est poussé par la curiosité atavique de la volonté de savoir, qui est une forme de l’agressivité à vivre. Aidé par ses compagnons qui enfournent le blé à pelletées dans le masque, il se cache sous le tas et n’émerge qu’en vol. Toujours pistolet à la main, la poitrine nue bardée de cartouchières, il « tue » Arthur Frayn qui s’écrase au sol (mais sera reconstitué dans la machinerie biologique du cristal).
Lorsque le Zardoz revient à sa base dans le vortex, Zed part explorer le coin. Il est idyllique, suite de maisonnettes collectives au bord d’un lac, dans une atmosphère douce où il ne pleut jamais et où chacun vit heureux pour l’éternité. Car un vortex est un tourbillon physique qui enferme les particules. Les savants, deux générations avant, ont inventé un monde préservé, stable et fermé comme un cristal (le Tabernacle), dans lequel tous les éléments se répondent, en écho. Ils ont trouvé le miraculeux équilibre, donc l’éternité. Sauf que les humains, même mutés lorsqu’ils sont « reconstruits », ont encore besoin de manger, même s’il ne s’agit que de fruits et de céréales (la viande, quelle horreur, ce serait agressif !). D’où le recours à la domination sur l’extérieur.
Ils ont perdu toute agressivité donc tous désirs ; les mâles ne bandent plus. Certains sont devenus apathiques, les vieux « éternisés » trop tard aspirent à en finir, les autres s’ennuient dans « le collectif » où règne la pensée unique de l’harmonie universelle. Les séances d’unisson, qui rappellent furieusement les sessions de méditations des stages de psy-quelque chose de nos jours, font froid dans le dos. Qui a réticence, même minime, à se livrer à tous, est rejeté socialement et poussé dehors comme un renégat, déchu de toute relation. Le vote est obligatoire et l’on vote pour tout ; la majorité impose sa loi sans contrepouvoir – or la majorité n’est pas originale, ni meilleure que les meilleurs. Sauf qu’on ne veut plus de « meilleurs », l’égalité absolue règne en théorie. Car même chez les éternels, intellos harmoniques, « la domination » existe ! Elle est collective, donc pire ; l’expérience communiste un peu partout sur la planète le montrait à l’envi dans les années 1970. Le totalitarisme intellectuel n’est pas meilleur que le totalitarisme religieux ou celui des seigneurs guerriers. Arthur Frayn ne fait que traduire le sentiment majoritaire des éternels lorsqu’il veut détruire le vortex via un exterminateur pleinement humain, c’est-à-dire tueur et volontaire. Sean Connery – dit Zed, la dernière lettre de l’aphabet – est parfait dans ce rôle : velu, viril, puissant, il va observer et ne laisser observer que ce qu’il veut dans les « expériences » que font sur lui les femmes qui dominent (mais oui) le collectif éternel. May (Sara Kestelman) lui avouera, spontanée, qu’il est « plus intelligent qu’elle et même que la plupart d’entre nous ». Car lui est issu d’enfantement, pas de machine à procréation ; lui a été élevé dans la survie, pas dans la mollesse de l’éternel printemps ; lui bande pour les filles, pas les efféminés éternels – il a envie, il désire, il veut.
Bien sûr, nous sommes dans les années post-hippies où il était mal vu d’être musclé et de montrer sa force, ce pourquoi le Sean Connery d’époque a le torse plutôt mou. Mais, par rapport aux minets filiformes et imberbes qui l’entourent, il est la bête aux narines frémissantes, en slip rouge comme Tarzan. Ce pourquoi l’autre femelle dominatrice Consuela (Charlotte Rampling), glaciale de désirs refoulés, voudra « le détruire » parce qu’elle est en train d’être séduite par le mâle et que cela l’effraie. Il finira par la ravir, ils s’enfuiront tous deux après le crépuscule des dieux et ils auront un enfant que, dans une scène mémorable, on voit grandir entre ses deux parents jusqu’à ce qu’ado, il les quitte pour vivre dans le monde réel – et qu’eux meurent enfin.
Guerre du Vietnam, du Biafra, du Kippour, du Bangladesh, Watergate, crise du pétrole et suspension de la convertibilité or du dollar, composent un monde cruel où, en 1974, les utopies font long feu. Zardoz en est l’illustration. La religion oppresse, les savants imposent, les intellos oppriment, même le végétarisme et le féminisme sont des contraintes : la domination est toujours là. Le seul moyen d’en sortir est d’être empli d’énergie vitale pour penser par soi-même et se révolter – comme les conquérants, comme les pionniers, comme les grands hommes depuis les origines. Contre le rêve écolo de tout ce qui est « durable » au point d’aboutir à un équilibre éternel. Car l’équilibre parfait est asthénie, apathie, soumission au collectif fœtal, absence complète de volonté au profit du plan – autre forme redoutable de dictature. Les individus ne sont plus, ils forment un œuf ; ils n’ont plus d’existence, plus d’attractions pulsionnelles, affectives ni sexuelles, plus de personnalité. Ils sont standards, interchangeables, égaux éternellement médiocres, ennuyés de tout, déshumanisés.
Il faut dépasser le premier degré kitsch et confus, les longueurs parfois, car ce film mérite d’être revu pour ce cinquantenaire de mai 68. Le message est qu’il vaut mieux accepter sa nature et faire avec plutôt que de la nier (ce péché de toute la génération 68 devenue social-démagogique !). Toute l’œuvre de « civilisation » consiste à canaliser les instincts primaires et à dompter les passions par l’intellect pour les faire servir au mieux l’humain dans son environnement. Ce n’est pas en déniant la nature agressive de la bête humaine que l’on changera le monde – au contraire ! Car l’instinct vital surgit toujours, même là où on ne l’attend pas. Autant le reconnaître, le contenir, l’apprivoiser et le canaliser.
DVD Zardoz de John Boorman, 1974, avec Sean Connery, Charlotte Rampling, Sara Kestelman, John Alderton, Movinside 2017, 1h45, standard €16.99 blu-ray €19.99







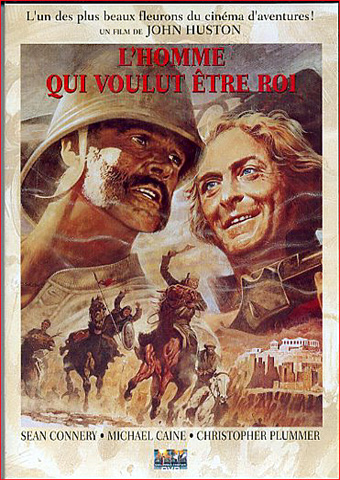



Commentaires récents