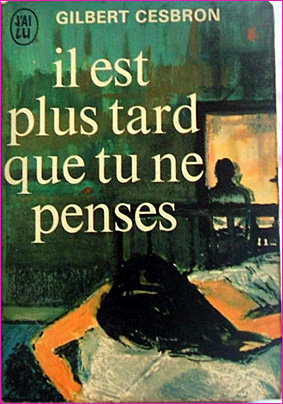
L’auteur écrit un roman social pour son temps sur l’amour, le cancer, l’euthanasie, le deuil – et la religion. Cela fait beaucoup pour un seul texte et la fin est ratée, le dernier chapitre part dans un délire chrétien un peu niais avec petit garçon atteint, refus de soulager sa souffrance par un excès de morphine, « prière » à Dieu au lieu d’être à ses côtés et de l’accompagner sur la fin – et vœu exaucé : Dieu tue le gamin. Il ne souffre plus. Le pire dans l’espoir bébête est cette nouvelle annoncée : « Cancer vaincu. Sérum efficace à 95 % ». Quant on voit que, 66 ans plus tard, « le » cancer n’est toujours pas vaincu mais seulement certains cancers circonscrits, on se dit que la foi de l’auteur est celle du charbonnier et qu’il n’est pas humain de propager une telle fausse nouvelle.
Hors ce dernier chapitre, il s’agit d’un bon roman, bien écrit, avec passion et prenant. Il est tiré d’un témoignage vécu de Sorana Gurian, son Récit d’un combat publié en 1956.
Jeanne et Jean sont jeunes – le prénom Jean signifie jeune ; il désigne le junior de l’équipe du Christ. Jeanne aime Jean, qui l’adore. Il n’ont pu avoir d’enfant et leur amour est devenu fusionnel. Lui est un ancien résistant envoyé dans les camps d’où il s’en est sorti. Pas croyant, il est généreux et humain. Elle, est petite fille, attirée par la protection du grand corps nu dans son lit. Elle voudrait adopter un garçon et le couple est allé à l’Assistance voir le petit Yves-Marie, 3 ans. L’adoption était plus facile en ces années où l’État ne se mêlait pas encore de tout et où la prolifération des bureaux n’avait pas généré cette avalanche de normes et de contrôles – d’ailleurs peu efficaces, comme en témoignent les « ratés » des services sociaux ces dernières années. Les bureaux fonctionnent entre eux et pour eux, générant leurs propres règles et ne faisant leur métier que pour les appliquer, peu concernés par les véritables individus à qui elles sont destinées. Mais à chaque fois, Jean recule devant l’engagement, ou Jeanne ne se sent pas prête. Le petit Yves sera leur grand regret.
Jusqu’à ce qu’un jour, une douleur, un nodule sous le sein, alerte Jeanne que quelque chose ne va pas. Mais elle le dénie et n’ose pas consulter, ni même en parler avec son mari. Elle a peur et joue l’autruche à la tête dans le sable. Lorsqu’elle se résout enfin à demander conseil, c’est à un rebouteux – la science avec sa vérité l’effraie trop – attitude très catholique de préférer l’illusion à la vérité. Ne pas vouloir savoir et prier est l’attitude soumise de ces années-là. Mais « il est plus tard que tu ne penses » et le cancer, cette maladie du siècle, n’attend pas. Il se développe et ronge, indifférent aux émotions. Lorsque l’opération, par « le meilleur » chirurgien (on dit toujours ça) a lieu, il est trop tard. Jeanne ne gagne qu’un répit de quelques mois avant que les métastases ne se répandent et qu’il n’y ait plus rien à faire.
Désormais, la douleur sera permanente, avec ses hauts et ses bas. L’époque n’était pas tendre avec la souffrance. Elle était considérée comme un mal nécessaire, une volonté de Dieu. L’auteur ne nous passe rien de l’exemple du Christ et de son calvaire, sur l’Expiation, sur l’Offrande à Dieu et autres billevesées destinées aux malades laissés pour compte de la médecine qui ne peut pas tout (au contraire de la foi). Mais le mal est de pire en pire, Jeanne souffre tellement qu’elle se replie sur elle-même, en vient à haïr les vivants, y compris Jean, qui en est désespéré. Elle tente de mettre fin elle-même à ses jours en avalant un tube entier de Gardénal ; c’est Jean qui la sauve en la faisant vomir en attendant les médecins.
Mais la souffrance persiste, augmente. Jeanne n’est pas heureuse d’avoir été sauvée et son frère Bruno, prêtre, se demande si Jean n’aurait pas dû la laisser mourir. Les mois se passent, au total la maladie aura duré deux ans. Il n’y a plus rien à faire, seulement atteindre la fin. Mais elle tarde, le cancer tourmente. Jean finit par obtenir une ordonnance de morphine avec les doses à ne pas dépasser. A un paroxysme de douleur de Jeanne, un soir, Jean répond par huit ampoules de morphine au lieu de deux. Elle le supplie des yeux, trace le signe de la croix sur son front ; elle veut en finir. Il ne fait qu’agir sous son emprise : elle dit oui.
Elle meurt donc et, avec elle, sa souffrance indicible. Bruno le petit frère et prêtre comprend. Le médecin ne dit rien. Chacun sait combien Jean aimait Jeanne et que c’était la délivrer que d’agir ainsi.
Mais la conscience coupable du catholique tourmente le jeune homme, ambiance de société malgré son manque de foi personnelle. Trois mois plus tard, il veut se « confesser » au procureur de la République qui, au vu des faits et de la loi, ne peut que poursuivre. Il y a procès, moins de Jean lui-même que de l’euthanasie. L’auteur détaille les arguments juridiques, philosophiques et moraux des partisans de l’une et de l’autre partie. Un thème qui reste d’actualité même si l’on a voulu avec la loi Léonetti le « en même temps » de ne pas donner la mort mais d’assurer une fin sans douleur. La réductio at hitlerum (l’accusation massue de nazisme) n’est pas oubliée, comme quoi elle n’est pas une invention des réseaux sociaux comme aiment à le croire les milléniums narcissiques. Mais le jury populaire tranche : non coupable. Jean n’a fait qu’agir selon la volonté de la malade, sans préméditation, avec la charité de l’amour qu’il lui portait.
Gilbert Cesbron est un écrivain catholique et le fait savoir – un peu trop. Nous sommes dans le sentimentalisme sulpicien, l’amour inconditionnel, la préférence pour les illusion consolatrices face à la vérité, les affres de la conscience coupable et la souffrance rédemptrice, le monde meilleur… ailleurs. Signe des temps, le roman a été vendu à plus d’un million d’exemplaires.
Ironie divine ? L’auteur sera lui-même, vingt ans plus tard, atteint d’un cancer incurable et décédera en 1979 à 66 ans.
Gilbert Cesbron, Il est plus tard que tu ne penses, 1958, J’ai lu 1975, 305 pages, €5,11, e-book Kindle €5,99

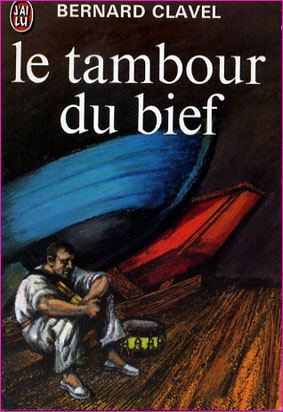
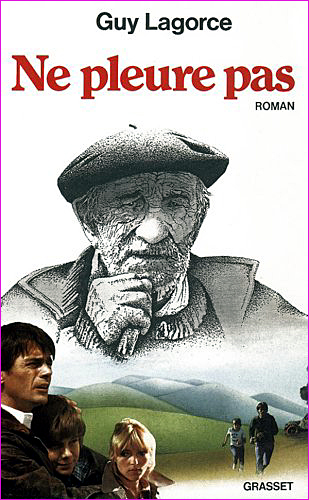
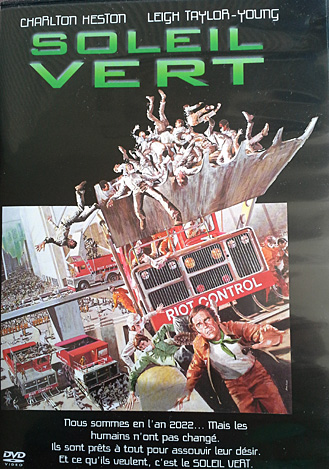


Commentaires récents