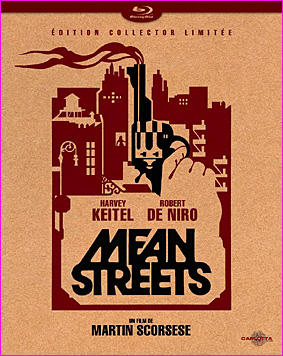
Sorti en 1973, c’est le film qui a lancé Martin Scorsese et Robert De Niro. Il est tiré de la vie de son réalisateur et de son quartier de Little Italy à New York dans les années soixante, quartier misérable, signification de Mean dans le titre. Le terme joue aussi sur l’homonymie entre Main Street (grande rue) et Mean Street (rue minable) peuplée de prostituées, drogués, pédés, macs et paumés. Les personnages de Charlie Cappa (Harvey Keitel) et Johnny Boy (Robert de Niro) s’inspirent de sa propre histoire familiale, son frère était ingérable et leur père avait demandé à Martin de le protéger. Boy est ici le cousin de Charlie.
A cette époque, on ne faisait carrière dans la vie que poussé par sa famille et dans son quartier. Le territoire et la cooptation étaient les clés, plus que l’intelligence ou les études. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent s’entourer et se faire respecter, ainsi l’oncle de Charlie, parrain prospère qui gère ou protège bars, boites de nuit et restaurants (Cesare Danova). Justement, il doit confier un rade qui bat de l’aile à son neveu pour qui il est temps de s’installer. Mais Charlie est pris encore par ses copains et son existence de jeune désœuvré qui se contente de récupérer pour l’oncle l’impôt mafieux sur les commerçants et d’arnaquer des ados en quête de drogue. Il hante les boites de son clan et consomme de l’alcool avec ceux auprès de qui il a grandi, poursuivant les jeux et bagarres de gamins, se réconciliant comme des frères après les coups.



L’oncle Giovanni (Cesare Danova) le parrain respecté, et Teresa (Amy Robinson), la cousine de son compère Johnny Boy avec qui il aime baiser, sont des ouvertures vers l’âge adulte, mais Charlie a peine à franchir le pas. Il est encore habillé par sa mère, conseillé par son oncle, pris par l’église. Le parrain tente bien de lui faire comprendre que les hommes honorables vont avec les hommes honorables et pas avec les perdants comme Johnny « qui a un grain », ni avec les filles entachées comme Teresa « épileptique » ; le catholicisme fait bien du vol et de la baise un « péché », mais Charlie n’en peut mais. Il biaise. Admirant saint François d’Assise, il veut être gentil avec tout le monde et non-violent pour ne pas enclencher le cycle de l’honneur à venger. Il doit protéger Johnny Boy de lui-même en bon Samaritain, il veut aimer Teresa en future mère de famille mais en son temps et plus tard, quand il sera installé dans son restaurant. Il est pressé mais surtout angoissé d’aller si vite. Tout lui est prétexte à ralentir le temps, à rester dans l’état irresponsable de sa jeunesse.



Il faut dire que Johnny son copain d’enfance lui donne du fil à retordre. Rétif à tout travail, il promet toujours sans rien tenir et vit d’expédients. Joueur invétéré par pur goût du défi, il accumule les dettes, tire au pistolet en haut d’un immeuble. Seul le plus con, Michael Longo (Richard Romanus), lui prête encore, n’ayant pas compris qu’il ne remboursera jamais et donnant sans cesse de nouveaux délais qu’il sait ne pas voir tenir. Il s’impatiente mais lorsque Johnny Boy l’insulte à la face de tout le monde en lui proposant 10 $ sur les 3000 $ qu’il lui doit « dernier délai » et en le menaçant d’un pistolet pas chargé tout en le traitant de pédé, il décide de se venger. Son tueur arrosera la voiture des compères Charlie et Johnny, Teresa entre eux, et les blessera – sans les tuer, tant le tueur est aussi nul que son maître.



Johnny « Boy » est la séduction du mal, la mafia dans ce qu’elle a de pas très catholique. Il est le gamin écervelé qui vit de ses instincts, le joker trublion, joueur, menteur, baiseur. Son entrée flamboyante avec deux filles racolées dans un bar est une entrée en scène, surtout lorsqu’il enlève son froc pour le confier à réparer à la fille du vestiaire. Vêtu d’un costume neuf, chapeau crânement vissé sur la tête et ricanement à la bouche, il incarne le diable, le plus bel ange déchu. Sur l’air de l’excellent rock Jumpin’Jack Flash des Rolling Stones il subjugue par son charisme. Charlie l’admire et lui en veut depuis l’enfance pour cette liberté qu’il prend avec toutes les conventions, avec sa vie même. Il est en conflit avec lui-même, se regardant le matin ou après la bagarre dans le miroir pour tenter de fixer son image de jeune mafieux en devenir. Teresa est son double féminin, respectueuse et craintive envers les mâles contrastés Charlie et Johnny – de sa génération. Une plongée dans les années 70 américaines.
DVD Mean Streets, Martin, Scorsese, 1973, avec Robert De Niro, Martin Scorsese, Harvey Keitel, David Proval, Arcadès 2011, 1h52, standard €5.11 Blu-ray €8.50











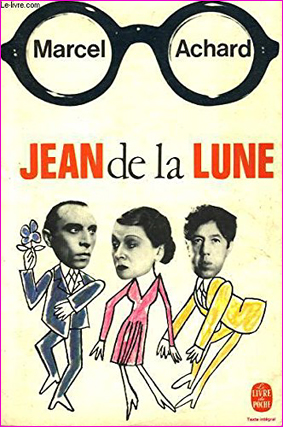


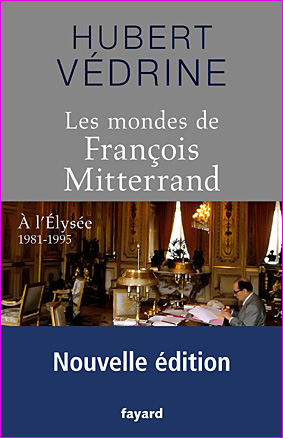










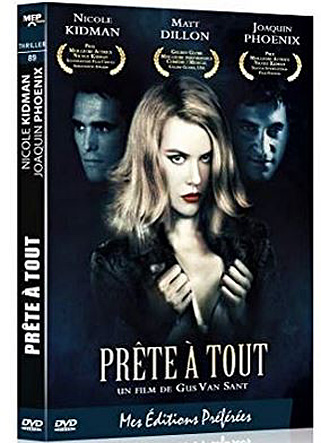



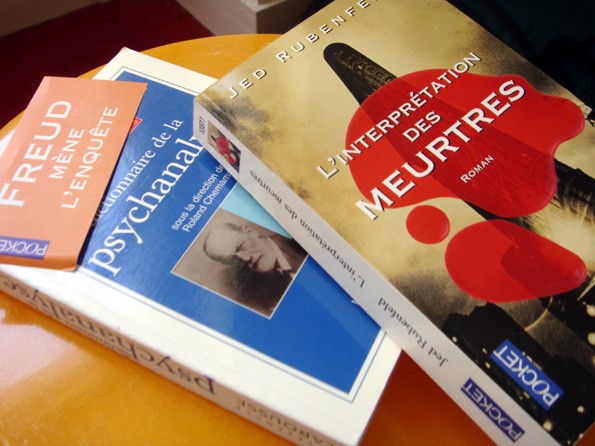







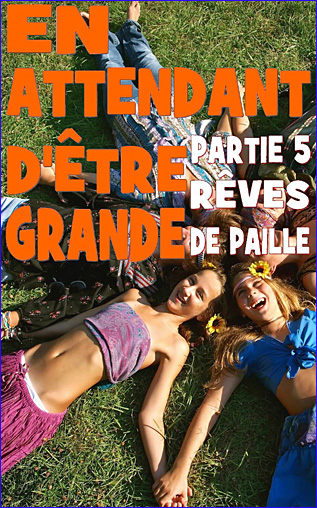


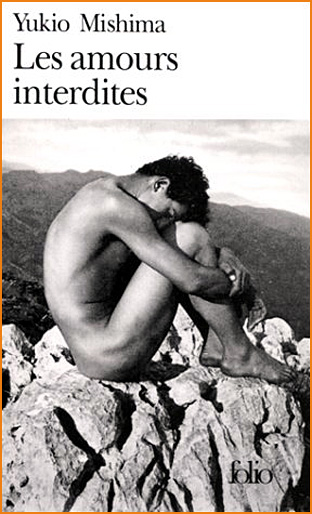

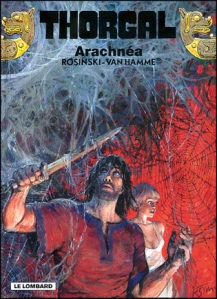
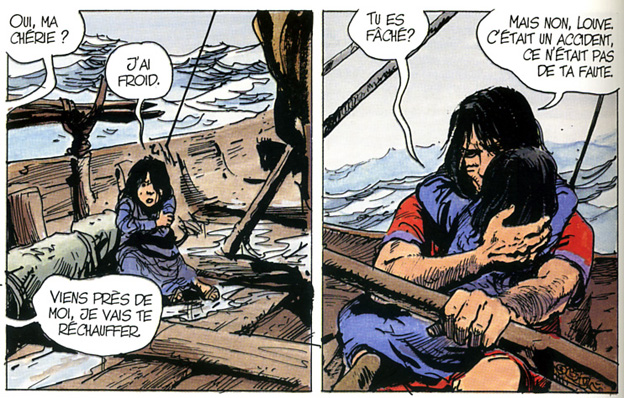
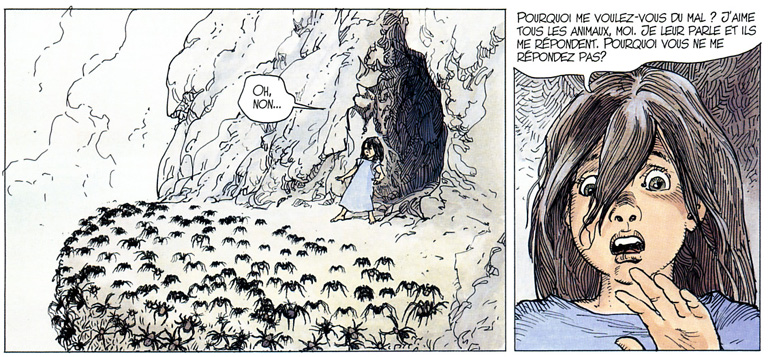
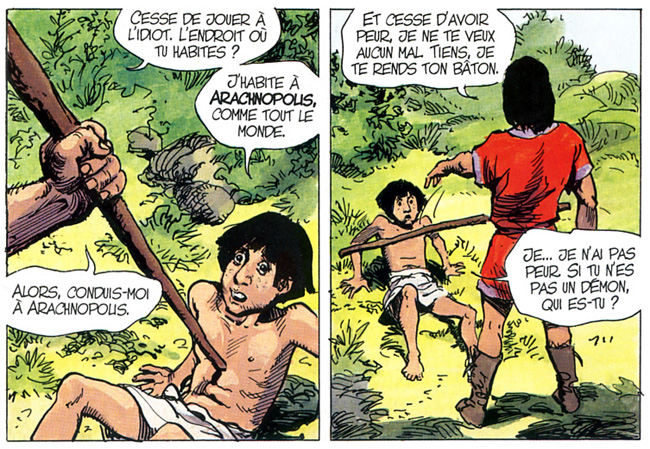


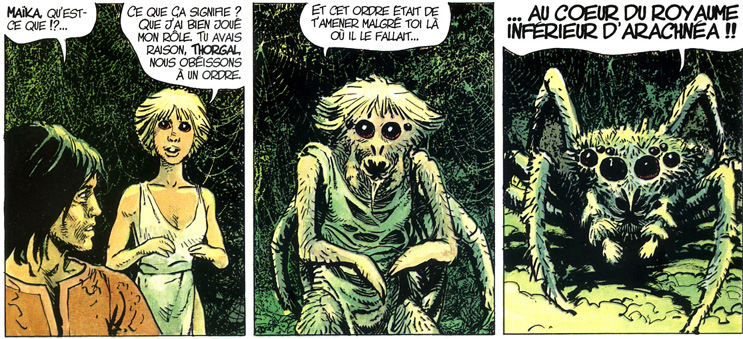
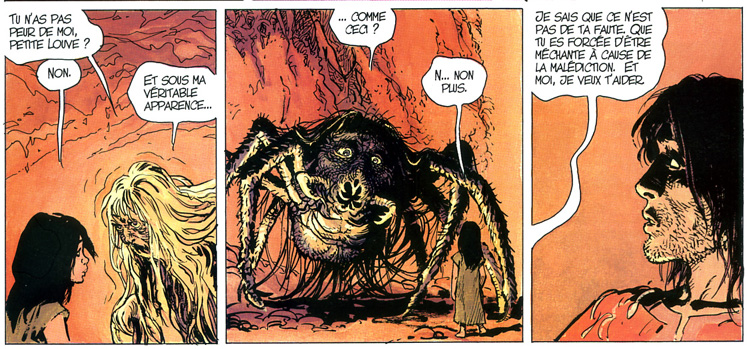
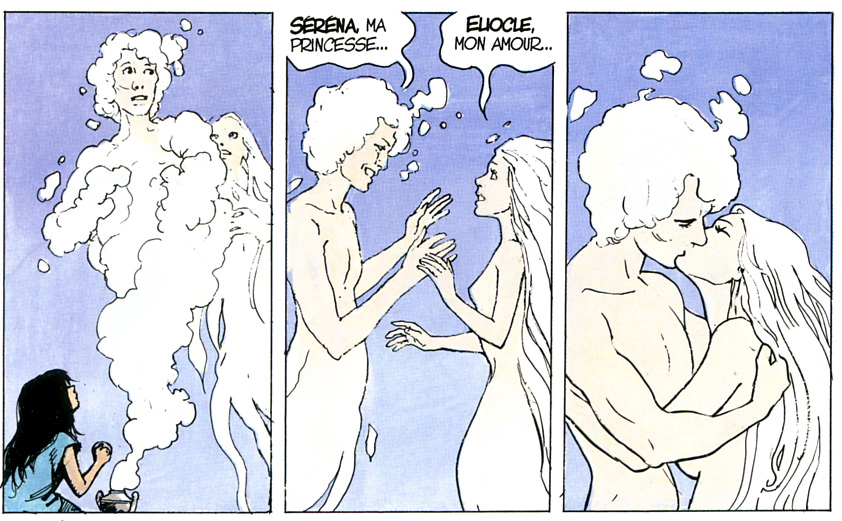

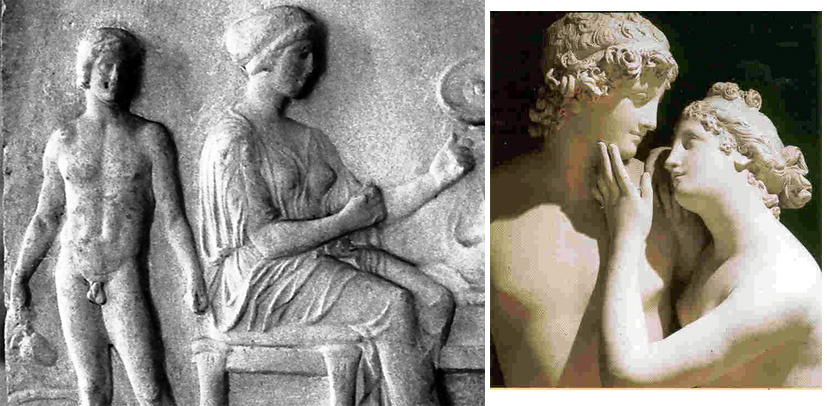

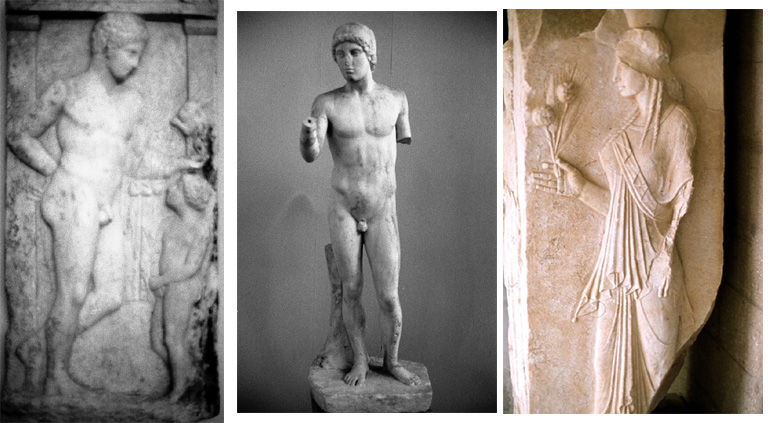



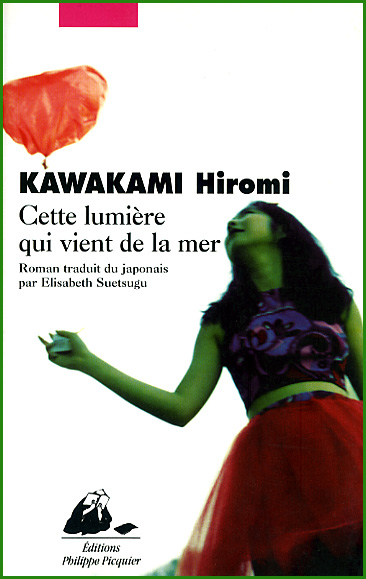


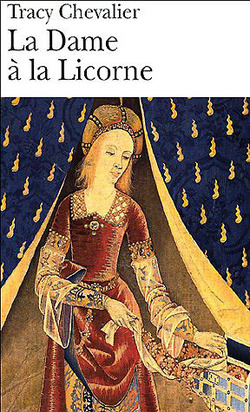







Commentaires récents