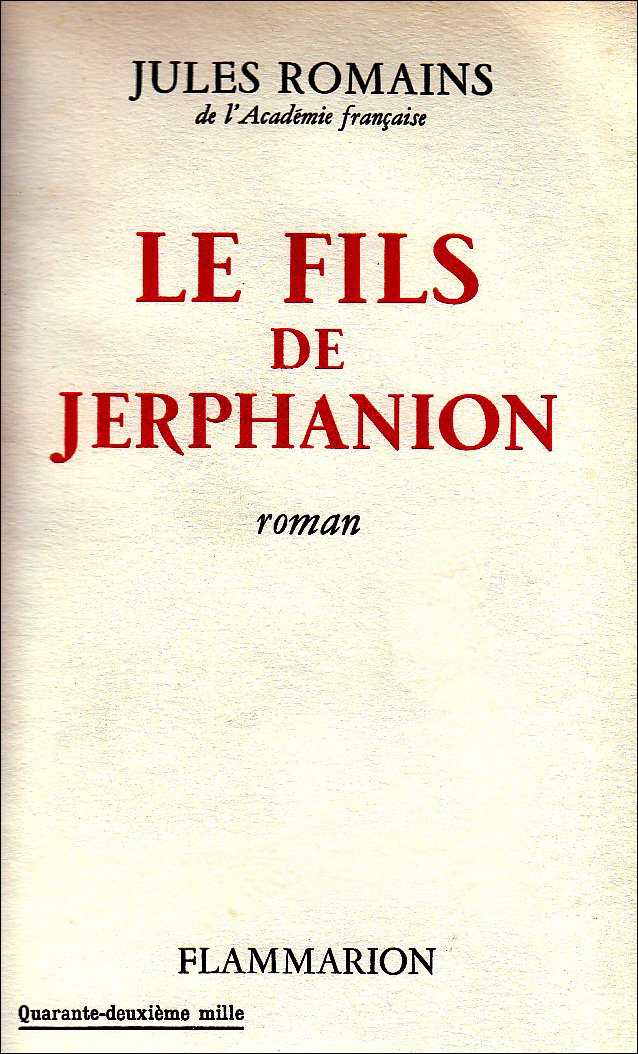
Il ne s’agit pas d’un crime, seulement d’une escroquerie, dont il ne semble d’ailleurs pas vraiment responsable, ayant plus laissé faire qu’agit en toute conscience. Le juge en tiendra compte qui, à l’époque, avait le temps de réfléchir, de consulter et d’arbitrer avant le prononcé du jugement.
Mais l’intérêt du livre, qui a vieilli, est de comparer les générations qui ont connu une guerre mondiale, ce que nous avons oublié si tant est que nous l’ayons un jour su. Jerphanion père a fait la guerre de 14, comme l’auteur. Jerphanion fils, né en 17, était trop jeune pour l’avoir connue, même enfant, mais il en a subi les conséquences dans les années folles qui ont suivi. « Une civilisation démantibulée, une rumeur de catastrophe, plus ou moins lointaine, mais qui en venait à passer pour l’arrière-plan normal de la vie. Or rien, on le sait, ne remplace et rien n’efface des enregistrements de la petite enfance » p.142. Et lui a connu la guerre de 40, son humiliante défaite déjà inscrite dans l’esprit « socialiste » et la lassitude des rejetons de la « der des der ». Toute morale avait été ébranlée en 18 ; elle se trouve écroulée en 45 après les lâchetés et les actes de pur sadisme pour motifs raciaux et par pulsion de brutes des cinq ans de guerre.
Dès lors, comment vivre ? Prendre sa part sans y penser, comme les autres, sans référence à une religion ni à une morale commune ? La politique est une chienlit, la guerre une menace constante, le jouir par l’argent probablement ce qu’il y a de mieux à faire. Et l’on en vient à concevoir un monde débarrassé des oripeaux de « ce qui se fait », puisque ce qui s’est fait en réalité a abouti a ce qu’on sait : les massacres, les camps, les viols, le servage. Le communisme n’est pas meilleur en pratique que le nazisme et Staline vaut bien Hitler en attendant Mao et Pol Pot, et plus tard les Serbes et les Rwandais.
« Nous sommes nés, nous avons eu nos premiers contacts avec le monde au moment où il était en proie à une énorme catastrophe. Nous avons grandi dans l’atmosphère pulvérulente et sulfureuse qu’elle avait laissée. Quand nous avons eu de ce que les prêtres appellent l’âge de raison, ce fut pour assister au triomphe, à travers l’Europe, de gens dont nous admirions peut-être à part nous, l’énergie, l’audace, mais qui piétinaient allègrement tout ce que nos parents, nos maîtres, les livres qu’on nous plaçait entre les mains, nous apprenaient à respecter. Pour mettre notre adolescence d’aplomb, nous avons eu, chez nous, ce Front populaire, pantouflard, flemmard, crasseux. Il achevait de nous démoraliser, parce que si vraiment c’était lui qui représentait les grands principes et l’avenir de l’humanité, et la lutte du bien contre le mal, autant valait se jeter à l’eau. Ou bien se vouer au diable et aux mauvais principes » p.142. Cette moitié de Jules Romains n’aimait pas l’aspect populacier et populiste de la gauche d’époque – tandis que son autre moitié admirait sa générosité et aimait quand même son élan.
A cette époque, eh bien nous y sommes revenus… La gauche au pouvoir sous la Ve République a laissé le pays dans un état de délabrement moral et de désillusions sur « la volonté » politique et le possible économique (ce pourquoi certains rêvent de casser le thermomètre et d’en revenir au parlementarisme instable des petites combines entre politicard, style IVe République). La brutalité reprend avec l’égoïsme sacré des nations comme des individus – dont les lamentables antivax sont le dernier avatar, « croyant » au lieu de savoir que le vaccin ne protège pas du coronavirus et qu’il est inoculé pour des raisons malignes. Les Antilles, populaires et où l’éducation est faible, disons-le, en font les frais à grand bruit. Les « aider » serait les vacciner, pas les réanimer.
Dans le délitement du sens, les pages 104 à 107 font même sous la plume du fils Jean-Pierre une apologie de l’inceste, à but éducatif naturellement, et des mères sur les garçons. Après tout, les éduquer à la femme par une progression constante et adaptée, n’est-ce pas le meilleur service éducatif qu’une mère peut rendre à ses fils ? Cet exposé révolte l’avocat destinataire à l’époque, mais apparaît assez cocasse au vu des récentes « affaires ». Elles ont autrement plus scandalisé la « bonne » société à prétentions bourgeoises et en quête de sens moral – qui copie servilement le puritanisme chrétien venu d’outre-Atlantique tout en se soumettant trop volontiers aux diktats de l’islam intégriste (après tous, « être d’accord » sans réfléchir, juste pour être au chaud tranquille, est la première des soumissions).
Il ne s’agit pas de promouvoir l’inceste mais de concevoir que la fin de toute morale due aux deux guerres industrielles successives nous prépare peut-être (et probablement) des lendemains pires encore s’il survient une prochaine guerre généralisée, ce que les bouleversements climatiques et géopolitiques ne peuvent exclure. Comme quoi lire de vieux livres d’anciens auteurs qui ont eu leur gloire ne nuit point – au contraire !
Jules Romains, Le fils de Jerphanion, 1956, Flammarion, 313 pages, occasion €3.30



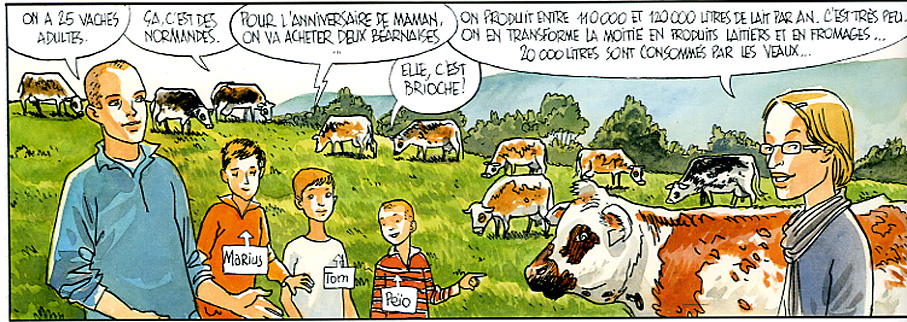
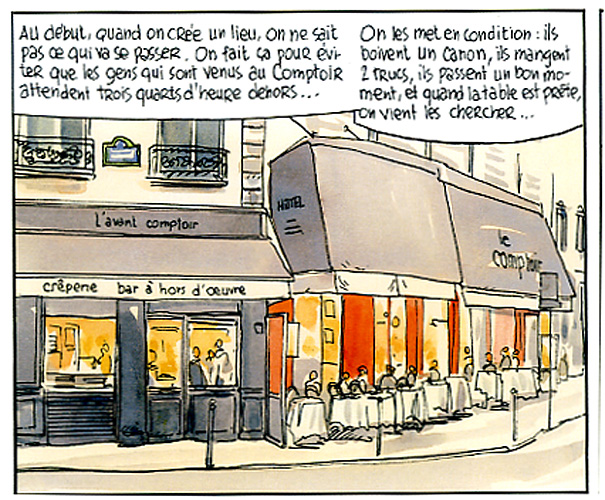
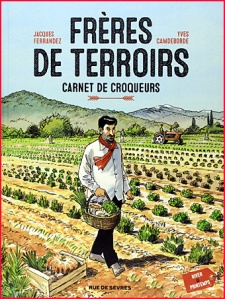


Commentaires récents