Dans la nuit glacée de Sibérie, la lune donne un ton bleu d’écran télé au paysage comme aux visages. Un prospecteur velu surnommé « le Morse » se roule tout nu dans la neige ; il accomplit ce rite par tous les temps, en compétition par correspondance avec un Tchèque. Victor, lui, écrit une lettre à une camarade dont il aimerait bien qu’elle devienne sa femme. Mais elle fait le coup à tout le monde et n’aime peut-être, en fait, personne. Brusquement, le jour n’est pas encore levé, on annonce des oranges. A 200 km de là, un bateau vient d’apporter tout un chargement de fruits d’or du Maroc !
On ne peut imaginer, en 1962, le luxe que pouvait représenter une simple orange dans une URSS où le rationnement était la règle. Et tout le pays alentour de se précipiter au port en camion, en moto, en auto, pour se ranger dans l’une de ses fameuses queues qui furent le symbole de l’égalitarisme communiste durant trois générations. Tel est le thème de ce court roman de 232 pages qui parle moins des oranges que du désir et moins du Maroc que de l’Union soviétique.
Nul n’écrit à 30 ans ce qu’il écrit à 62. Surtout pas en lorsque l’empire existait encore. En 1962, nous étions au temps de Khrouchtchev, un Russe de Koursk (et pas Ukrainien comme on le dit trop souvent). Le personnage fut berger, puis métallo, puis apparatchik, il s’éleva dans l’ombre de Staline avant de prendre sa succession en évinçant les autres. Bon vivant et coléreux, il n’hésitait pas à taper avec sa chaussure sur son pupitre à l’ONU pour se faire entendre tout en couvrant les voix de l’opposition. Il utilisera cette vieille tactique stalinienne contre son maître dans son fameux Rapport de 1956, sorti pour consolider son pouvoir. Mao s’en inspirera pour déclencher un peu plus tard sa Révolution « culturelle »… Axionov ne parlera de Staline que 32 ans après dans Une saga moscovite, une fois l’URSS défunte et enterrée. Il n’aborde le personnage que de loin et en biais dans Les oranges du Maroc. Comment faire autrement lorsque le décor est celui de la Kolyma, reconvertie en nouvelle frontière du Progrès pour « rattraper et dépasser l’Amérique », autre vantardise de « Monsieur K » (qui n’est toujours pas réalisée) ?
Car le « réalisme socialiste », figure de style obligée du roman soviétique théorisée par la propagande, oblige, pour être publié par les officielles Éditions du Peuple en ce temps-là, à célébrer et à chanter « le progrès ». C’était l’idéologie économique du Parti, donc « du peuple tout entier ». Glorieuse époque d’optimisme d’une humanité conquérante : « En tête partiront les bulldozers ; puis les tracteurs emporteront le matériel : miradors, machines, tuyaux… Un hélicoptère transportera peut-être sur place une partie des ouvriers, et ceux-ci commenceront à défricher la taïga en vue des nouveaux travaux » p.230. Faut-il y croire ? On s’en balance, suggère Axionov dans ce livre qui eut du succès en son temps parce qu’il révélait tout haut ce que chacun vivait tout bas.
Cinq personnages en quête d’histoire s’entrecroisent dans ce roman chaleureux où se qui compte, au fond, sont les relations entre hommes et femmes, entre femmes camarades et entre hommes au travail. Chacun sa fonction, plus ou moins bien remplie, chacun ses états d’âme, plus ou moins bien soignés au « cognac tchétchène », à la séduction ou aux grosses bagarres. La vie communiste n’est pas drôle, le travail souvent inutile car planifié par la théorie, les relations humaines hachées par les ordres de mission incohérents venus d’en haut, la paie versée quand le plan de fabrication pour les billets permet qu’il y ait le compte, la nourriture morne parce que décidée par une administration anonyme. Seul l’humain permet de la joie. Les copains, l’alcool et les femmes restent d’éternels bonheurs. Pas la Production industrielle, ni l’Exploitation de la nature, ni la réalisation du Plan.
Avec ce ton vibrant de la jeunesse et cet humour doux amer qui dénonce à petites touches l’ordre ambiant anonyme et contraignant, Axionov peint ici une société de pionniers d’une époque révolue mais où la vitalité n’était pas un vain mot. De quoi nous garder de tout collectivisme tout en réveillant nos sociétés fatiguées ! Car ce qui compte, au fond, ce sont les relations humaines.
Vassili Axionov, Les oranges du Maroc, 1963, Actes sud Babel 2003, 232 pages, €8.27

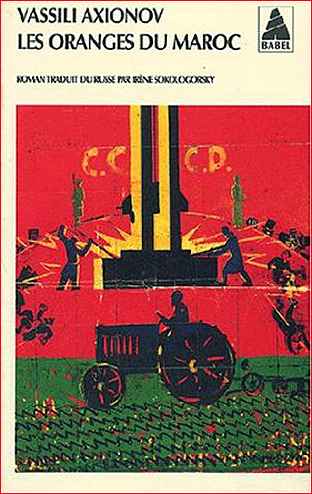
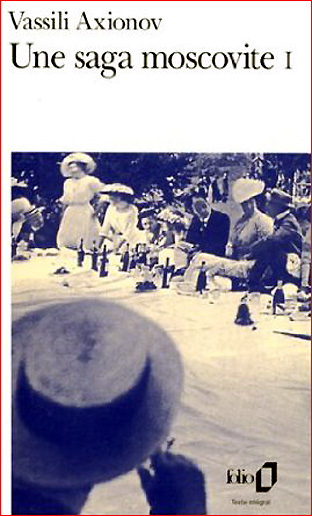

Commentaires récents