Le titre est un terme d‘héraldique qui barre l’écu d’en bas à gauche à en haut à droite et indique la bâtardise. Il s’agit ici non d’une famille mais d’une époque, « une distorsion dans le miroir de l’être, un mauvais détour de la vie » selon l’auteur (introduction). Ecrit de 1942 (à Paris) à 1946 (aux Etats-Unis), Nabokov connaissait l’angoisse d’être mari d’une juive et père d’un petit garçon né en mai 1934 (8 ans en 1942 – tout comme David, le fils de Krug). Cela dans une époque où, chassé de Russie par le communisme dictatorial lénino-stalinien, puis d’Allemagne par le nazisme antisémite, il se sentait menacé dans sa conscience même. Bien qu’il veuille ses romans hors d’époque et centré sur des types humains, Nabokov est ici immergé dans son siècle tant celui-ci s’impose aux consciences : « univers de tyrannie et de torture, de fascistes et de bolchevistes, de penseurs philistins et de babouins en bottes de cuir » (introduction, p.606 Pléiade). Le dialecte inventé du pays imaginaire est d’ailleurs un mélange de russe et d’allemand – ces deux langues de la barbarie du temps.
Car le roman est une allégorie qui prolonge Invitation au supplice (paru en 1934 et chroniqué sur ce blog), où un homme est emprisonné puis condamné pour déviance au Peuple. Ici, Adam Krug est un philosophe universitaire reconnu qui vient de perdre sa femme à l’hôpital. La « révolution » gronde et chasse le régime ancien. Krug se croit au-dessus de la politique, indifférent au régime quel qu’il soit à condition que sa liberté de conscience soit assurée. Or c’est impossible dans un régime totalitaire – où la notion même de totalité rend politique tout comportement et toute conscience. Chacun doit penser comme le Peuple et selon les commandements de Dieu, même si le Dieu n’est qu’un Crapaud, laid, asocial et vil à qui ses condisciples enfants faisaient subir des avanies d’écolier. Krug ne le croit pas, Krug se trompe, Krug en pâtira. Son aveuglement est tragique.
Car deux dieux se disputent « Adam », le premier homme : l’auteur qui est le Créateur et Paduk le crapaud qui est un personnage déchu. Krug est sain, viril et bon ; Paduk est pervers, lâche et mauvais. Le dictateur, ayant amalgamé tous les timides, les exclus, les bancroches, impose sa loi qui est celle de son bon plaisir sous l’idéologie commode d’un certain Skotoma qui prône une égalité totale des consciences et des comportements. Scotomiser est le déni psychologique de faits vécus intolérables – peut-être est-ce un signe. Qui n’est pas conforme est « rééduqué » ; qui n’est pas rééducable est massacré. Or Paduk aimerait bien avoir comme caution réelle Krug, dont la pensée et les travaux sont reconnus à l’étranger. Pour cela, il va le tenter par le pouvoir (devenir président de l’université, puis ministre de l’Education), par l’argent (il triple son salaire) ; puis par la peur (il arrête un par un ses amis proches), et enfin par le levier ultime : son enfant.
Le sadisme impersonnel de l’Appareil se montre alors dans son implacable engrenage. Les nervis sont des illettrés bornés (les soldats sur le pont), des brutes épaisses (Mac le musculeux), des putes en chaleur à peine plus âgées que Lolita (Mariette) ou des adolescents de la « brigade des écoliers (…) attifés de chemises écossaises en laine dont les pans battaient » p.768 ; ils saisissent mal les ordres et les exécutent avec sauvagerie. David est séparé de son père et emmené. Paduk convoque Krug, son ancien condisciple bizuteur pour lui montrer désormais qui détient la force ; il reproduit son enfance. Krug est effondré par l’arrestation de son petit garçon laissé à des adolescents cruels qui le giflent et « l’écartèlent » pour le faire tenir tranquille ; il est prêt à tout accepter et tout signer pour lui. Reconnaissant de cette soumission, « l’Etat » lui présente un petit Krug qui n’est pas le sien mais le fils d’un homonyme qui a 12 ans : il y a « erreur » administrative. Le vrai petit Krug, David, a été emmené dans un centre pour jeunes délinquants où la « rééducation » consiste à reproduire chez la victime ce que Paduk a subi enfant : le bizutage agressif de condisciples plus âgés. La novlangue totalitaire invente le terme d’« ‘instruments de relaxation’ au profit des pensionnaires les plus intéressants ayant un casier judiciaire (pour viol, meurtre, vandalisme sur des biens appartenant à l’Etat, etc.» – le « etc. » est glaçant et le lecteur imagine sans peine l’échelle des sévices que va subir « la petite personne » (autre terme euphémisé de la novlangue) : « dans certains cas, le passage de ces inoffensifs pincements et bourrades, ou légers attouchements sexuels, à l’arrachement de membre, la rupture d’os, l’énucléation, etc. demandait un temps considérable. Il était inévitable qu’il y eût des accidents mortels, mais très souvent on pouvait rafistoler la ‘petite personne’ que l’on renvoyait ensuite vaillamment au combat » p.785.
C’est une véritable épreuve que progresser dans ce chapitre où Krug passe de mains en mains, de fonctionnaires en fonctionnaires, pour finalement arriver au centre pénitentiaire pour enfants situé dans les montagnes où on lui présente d’abord le manteau de David pour prouver qu’il s’agit bien de lui, puis un film ultime où on le voit commencer « l’exercice » de rééducation en étant livré aux fauves délinquants dans un pré, enfin l’infirmerie où peut voir l’insoutenable : le corps martyrisé de son petit, désormais sans vie.
Charitable, le dieu bon qu’est l’auteur rend fou son personnage, ce qui lui permettra, en une ultime confrontation avec le Crapaud, de reproduire la scène d’enfance en humiliant le chef devant tous, même si les balles finissent par arrêter sa carcasse mortelle.
« Le thème principal est donc le battement du cœur affectueux de Krug et la torture à laquelle est soumise une tendresse profonde. Le livre fut écrit pour ces pages où l’on voit David et son père ; c’est pour elles qu’il faudrait le lire » (introduction p.607.). Pour cela, et pour l’analyse profonde de la tyrannie – malgré les intertextes, autoréférences et autres pièges à critiques un brin irritants – j’aime beaucoup ce roman de Vladimir Nabokov. Ne cherchez pas la petite bête, lisez-le simplement, il se suffit à lui-même sans notes de bas de page.
Vladimir Nabokov, Brisure à senestre, 1947 revu 1960, Folio 2010, 320 pages, €7.80
Vladimir Nabokov, Œuvres romanesques complètes tome 2, Gallimard Pléiade 2010, édition de Maurice couturier, 1755 pages, €76.50
Vladimir Nabokov chroniqué sur ce blog


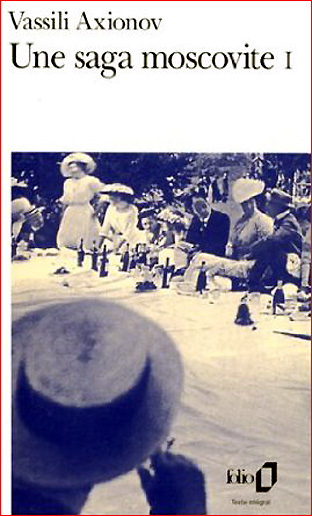

Commentaires récents