
Frédéric Moreau est un jeune homme moyen ; en 1840 il vit sa jeunesse comme un dû. Moyen physiquement, il n’a aucune de ces fortes pulsions qui poussent un individu à agir ; moyen affectivement et moralement, il n’a aucune passion assez puissante pour lui permettre de s’imposer dans la vie ; moyen intellectuellement (et nul spirituellement), il n’est que velléitaire, sans études et sans métier, sans rien qui l’intéresse un tant soit peu : il ne peint pas, n’écrit pas, ne plaide pas. Frédéric Moreau est un raté et son « éducation sentimentale » durera toute sa vie. Il terminera fruit sec en se félicitant d’avoir connu un seul moment de bonheur : celui ou, avec son ami de collège Deslauriers, il va aux putes à 16 ans et décide par peur du ridicule de ne pas consommer…
Comme l’écrit Edmond de Goncourt, cela demeure « un roman qui raconte dans une sacrée nom de Dieu de belle langue l’histoire d’une génération » (lettre du 14 novembre 1869 citée p.618 Pléiade). Celle qui va de 1840 à 1851 et a vécu trois régimes, du légitimiste au bonapartiste en passant par l’orléaniste, sans compter « l’esprit de pion » du socialisme qui a flotté sur tout cela. Où les soubresauts de la société ont accouché du chacun pour soi ; où l’incertitude de tout lendemain ont incité à l’égoïsme, recentré sur le jouir ; où le peuple lâché dans les rues comme des barbares a conduit à voter pour l’ordre et le conservatisme. Tiens ! notre époque en serait-elle un reflet ? « La France veut un bras de fer pour être régie », fait dire Flaubert au père Roque. 1848 veut singer 1789 qui voulait singer les Romains : la somme des désillusions pourrit tout idéalisme politique dans un avortement général de l’esprit. La société est désormais condamnée au matérialisme bourgeois, à l’enrégimentement des convenances et à la platitude des idées reçues. Tout cela préparait le prurit égalitaire effréné de notre époque post-moderne, le triomphe de l’opinion que Tocqueville commençait à dénoncer, la loi du marché, la marchandisation de l’art comme des corps, la peur de tout. Eh ! nous y sommes.
Frédéric – dont le prénom signifie ‘protecteur de la paix’ en germanique – est un faible, velléitaire, lâche et impuissant ; un indécis travaillé de vastes illusions et qui se serait bien contenté de naître s’il eût été riche et noble. Mais voilà, dans ce siècle bourgeois il faut se faire par soi-même et le fils unique d’une veuve provinciale en est bien incapable.
Il tombe en amour à 18 ans sur le bateau qui le ramène en Normandie d’une femme adulte, déjà mère de famille, Madame Arnoux. Il gardera cet amour platonique sa vie durant, tel un chevalier courtois, sans jamais oser le réaliser. Monté à Paris pour étudier le droit (qui ne lui servira à rien), il soudoie une cocotte, puisque cela se fait par tout le monde dans le monde. Sa Rosanette, passée entre toutes les bites depuis l’âge de 15 ans où elle fut vendue par sa mère, est vulgaire et ignorante mais bonne fille ; l’enfant qu’elle met au monde est-il celui de Frédéric ? Rien n’est moins sûr car elle accueille plusieurs hommes, mais elle veut le lui faire croire et y croit peut-être elle aussi. Le marmot a la décence romanesque de mourir au bout de quelques mois d’une quelconque maladie, pauvre gamin. Ces deux femmes sont le jour et la nuit, l’amour et le sexe, encore que Frédéric soit peu ardent à la baise.
Deux autres vont se partager son cœur décidément irrésolu : Madame Dambreuse et Louise. La première est son idéal social, pas très belle mais sûre d’elle-même grâce à sa fortune et à sa position dans le monde. Elle n’aime guère son mari et préfère s’afficher avec de jeunes hommes qui lui font la cour, sans aller jusqu’à l’alcôve ; Frédéric est de ceux-là au bout de quelques années. La Dambreuse lui propose le mariage dès que son mari crève mais Frédéric l’indécis, flatté, finit par refuser sur un mouvement d’humeur lorsqu’elle acquiert par jalousie un coffret de Madame Arnoux vendu aux enchères après saisie des biens. Elle est l’intrigante et la bourgeoise, toute sociale, le contraire de Louise Roque, jeune oison campagnarde connue tout enfant par Frédéric, son voisin de Nogent. Le père Roque est riche car il a bâti sa fortune en maquignon avisé ; la mère de Frédéric verrait bien son fils épouser la donzelle, pas vraiment jolie mais vive et amoureuse, toute animale. Goncourt, dans sa lettre précitée, déclare « une scène bijou est la scène où la petite Louise, une de vos créations les plus délicieuses, envie la caresse que les poissons ressentent partout, on n’est pas plus cochonnement et plus enfantinement sensuelle, et le cri suave (voilà une épithète que je vous envie) qui jaillit comme un roucoulement de sa gorge. C’est du sublime de nature ». L’observateur Flaubert a su croquer les enfants, leur côté direct et animal, indompté socialement. Mais croquer n’est pas croquer et le dessin ne fait pas l’ogre : Frédéric est attendri mais préfère les mûres.
Entre ces quatre femmes, la jeune animale et l’adulte sociale, la femme idéale et la putain pratique, le jeune homme reste niais. Il ne peut choisir parce qu’il ne veut choisir. Décider en tout lui est un supplice, il préfère se laisser bercer par les événements comme un petit garçon dans les bras de maman. Dès lors, ce sera la société qui l’agira et non pas lui qui agira sur la société. Il subira et passera le siècle sans le vivre. Sans cesse il « aspire à » mais reste sans volonté, inapte à vouloir son désir.
Flaubert, en écrivain réaliste qui « fouille et creuse le vrai tant qu’il peut » (lettre à Louise Colet 12 janvier 1852 citée p.1043 Pléiade) – Zola en fera le précurseur du naturalisme -, montre comment un même tronc d’une génération de province peut se diviser dans la société : son ami Deslauriers épousera Louise et deviendra préfet raté, mal vu du gouvernement ; Frédéric, après avoir mangé les trois-quarts de sa fortune dans les futilités et les lorettes, deviendra rentier médiocre resté célibataire. Ces Bouvard et Pécuchet du grand monde illustrent la condition petite-bourgeoise du temps : beaucoup de désirs et peu de qualités, une ambition démesurée mais aucun entregent. L’Education sentimentale est le pendant des Illusions perdues balzaciennes (1843). Monsieur Frédéric, contrairement à Madame Bovary, ce n’est pas lui.
Gustave Flaubert, L’Education sentimentale, 1859 (relu 1880), Folio 2015, 512 pages, €6.30
Gustave Flaubert, Œuvres complètes IV 1863-1874 : Le château des cœurs, l’Education sentimentale 1869, le Sexe faible, le Candidat, La queue de la poire, Vie et travaux du RP Cruchard, Gallimard Pléiade, édition Gisèle Séginger, 2021, 1341 pages, €64.00
Gustave Flaubert, Madame Bovary – L’Éducation sentimentale – Bouvard et Pécuchet – Dictionnaire des idées reçues – Trois Contes, Laffont Bouquins 2018, €30.00 e-book Kindle €19.99
Gustave Flaubert sur ce blog

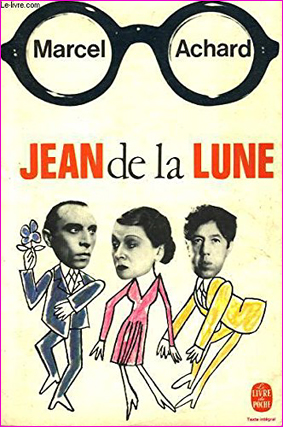





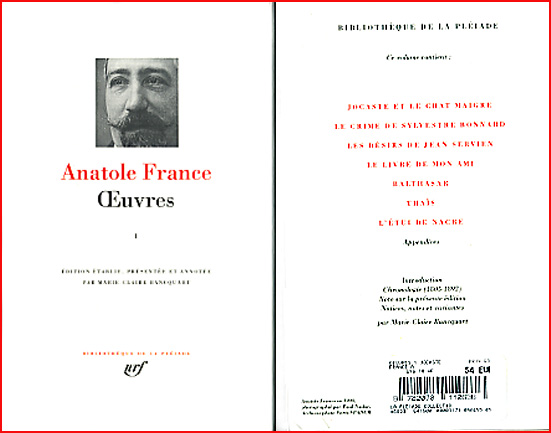
Commentaires récents