
Un bon roman historique qui se passe dans l’Europe du XVIe siècle, durant la Renaissance. La profusion et l’étroitesse de chacun des 64 chapitres donne un peu le tournis, d’autant que l’on passe d’un personnage à l’autre et d’un lieu à un lieu différent, mais la mayonnaise réussit à prendre.
Tout commence à Bois-le-duc, au nord du Saint-Empire romain germanique, sous le règne de Maximilien de Habsbourg. Des églises sont profanées par des cadavres découpés en morceaux et arrangés en singeant le calvaire du Christ. Ce sont des croix à l’envers, des torses affublés de têtes de cochon ou des troncs flanqués de pattes de bouc. Comme si le diable était revenu sur la terre et plantait sa griffe en cette année 1510, pour préfigurer l’Apocalypse prévue par les textes. D’autant que le chiffre de la Bête, 666, apparaît mystérieusement sur les restes de chair – ce qui est tu par l’Église…
La terreur monte dans les chaumières et le peuple des villes commence à gronder. Des émeutes éclatent, des incendies s’étendent. Le pape Jules II ne fait rien, hésitant à excommunier tout le Saint-Empire, d’autant qu’il n’a pas couronné encore l’empereur récemment élu. Les grandes puissances autour s’agitent, car il s’agit bel et bien de politique. La religion n’a que faire dans ces événements, elle ne sert (comme toujours) que de prétexte pour agiter les âmes simples.
Le jeune et bouillant Henri VIII d’Angleterre veut envahir la France avec l’aide de Maximilien du Saint-Empire ; la France veut faire excommunier ledit Saint-Empire pour éviter l’alliance des États allemands avec l’Espagne. Le Saint-Empire bouillonne de révolte contre l’Église de Rome, sa corruption et ses prévarications. Le pape vieillissant est au carrefour de ces intrigues et doit mesurer sa parole et ses actes.
Mais ne voilà-t-il pas que les artistes s’en mêlent, réunis en confrérie puissante pour défendre leurs propres intérêts, ou simplement la libre expression de leur art ? Léonard de Vinci reprend la peinture devant la fille de Ginevra, peinte sans les mains 25 ans plus tôt. Hiéronymus (Jérôme) Bosch poursuit ses figures hantées d’humains tentés par le vice et en parsème ses tableaux. Il semble curieusement inspirer certaines des compositions de chair humaine qui profanent les lieux sacrés. Le beau Raphaël, auprès du pape, intrigue avec un sourire cruel. Le vieux peintre Giorgione cherche à s’opposer aux malversations mais finit mal. L’Europe gronde, les peuples y voient la fin du monde, tandis que les hérétiques allemands relèvent la tête.
La belle Gabriela, noble florentine d’un père banquier très riche et fille de Ginevra, tombe amoureuse de Philippe le Beau, fils de Maximilien. Mais celui-ci est enlevé brutalement un soir à Milan alors que la jeune fille venait de le quitter. Elle n’aura de cesse de le retrouver, mettant au jour par son obstination un sombre complot dont les ramifications s’étendent à toute l’Europe, avant de disparaître. Philippe non plus ne reparaîtra jamais devant son père, soi-disant mort de la peste qui sévit à Venise, laissant l’éducation à la royauté de son fils Charles à son père. Le gamin de 10 ans deviendra quand même Charles Quint.
Léonard, vieillissant, diminué, cherche l’essence qui anime le corps humain en disséquant des cadavres, tout en s’appuyant sur l’épaule lisse du bel éphèbe blond Lorenzo qui le sert. Il lui caresse la tête, constamment ébouriffée comme s’il sortait du lit (ce qui est souvent le cas, suggère l’auteur), ou passe sa main le long de ses côtes pour une caresse tendre. Il est mandaté par le pape pour enquêter de façon scientifique et esthétique sur les compositions de morceaux humains que la crédulité populaire attribue au diable – mais que le pape, prudent, veut croire à la méchanceté humaine. Tandis que le chevalier Bayard, sous les ordres de Louis XII de France, cherche à modérer les forces qu’il a lancées en premier pour déstabiliser le Saint-Empire.
C’est une course échevelée pour mettre au jour la vérité, un faisceau d’intrigues croisées qui mêlent comme d’habitude la politique à la foi, la communication à la vérité, les manigances humaines au diable sous prétexte de stratégie chrétienne. Le roman est assez bien composé, un peu rapide malgré passion et aventure, mais le lecteur ne s’ennuie pas.
Yves Jego & Denis Lépée, La conspiration Bosch, 2006, Pocket thriller 2007, 410 pages, occasion €2,73 (liens sponsorisés Amazon partenaire)













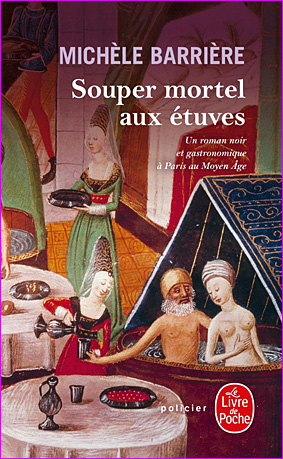


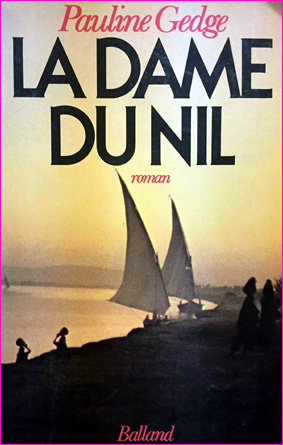














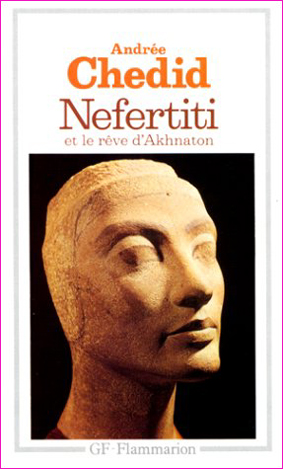







Commentaires récents