
Le melting pot américain n’est en fait qu’une salad bowl : les ingrédients ne s’y mélangent pas et chaque communauté reste entre soi, haineuse à l’égard des autres. Ce pourquoi un pompier blanc parti éteindre un incendie dans le ghetto noir se fait descendre par un dealer noir : par simple haine. Ce pompier, incarnation du citoyen américain moyen, bon époux et bon père de famille, était le père de Derek (Edward Norton), alors bon élève en Terminale.
Celui-ci, dès lors, pète les plombs : à quoi cela sert-il d’obéir à la loi si l’ambiance sociale est à l’indulgence pour les délinquants ? Si le libéralisme féminin de gauche trouve toujours des circonstances atténuantes à une minorité noire qui n’est plus esclave depuis déjà 150 ans ? Si les aides sociales et la discrimination positive profitent toujours aux mêmes, qui ne font rien pour se prendre en main ? Si les Blancs démissionnent et se soumettent à la loi des Noirs qui occupent les terrains de sport près de la plage de Venice et font de leur quartier une zone de non-droit ? L’exemple récent de Rodney King (en 1992), tabassé par les flics de Los Angeles parce qu’il les agressait après avoir été arrêté pour rouler bourré à 190 km/h est exemplaire : le coupable ce n’est pas lui mais les flics qui défendent la loi et les citoyens ! Ce que Derek ne veut pas voir est que faire respecter la loi est une chose, abuser de sa force une autre. Ni les délits, ni les inégalités, ni les injustices économiques ne justifient de transgresser la loi ou de se séparer de la nation. Même si certains se sentent plus « frères » que les autres, les états sont unis et le patriotisme doit être plus fort. C’est ce que se dit l’intelligent Derek, à qui son père a pourtant appris l’esprit critique : tout ce qu’on lit ou apprend à l’école n’est pas à prendre au pied de la lettre ; la Case de l’oncle Tom, c’était il y a plus d’un siècle et demi.

Derak s’est sculpté un corps aryen sainement musclé mais sa jeunesse le rend vulnérable aux passions et la haine est la première, équivalente en intensité à l’amour. Il aimait son père, il aime son petit frère Danny (Edward Furlong), 14 ans, qui le voit comme un dieu et s’est rasé le crâne sans acquérir une carrure comme la sienne ; il aime sa mère cancéreuse et ses sœurs vulnérables. Cet amour centré sur la cellule familiale engendre en réaction la haine des Noirs qui l’ont écornée. Il cherche un coupable pour expulser sa hargne et le mécanisme du bouc émissaire agit à plein sur son âge influençable. Il suit les conseils insidieux d’un Blanc mûr qui révère le Troisième Reich et vit de la vente de vidéos pronazies. Cameron (Stacy Keach) a fondé un gang de jeunes Blancs musclés au crâne rasé avec pas grand-chose dedans qu’il a nommé Disciples du Christ ; il joue au führer mais reste dans l’ombre, se délectant de voir la pègre défiée.
Sur le fond, pourquoi pas ? A toute communauté qui se ferme répond une autre communauté qui revendique autant de droits. Les territoires se gagnent, le respect aussi. Lorsqu’il organise un match de basket sur le terrain en bord de plage, Derek fait gagner son équipe, ce qui expulse les Noirs de la zone. Jusque-là, rien que de légitime.
Tout dérape lorsque la haine en retour de certains Noirs de l’équipe vaincue aboutit à tenter de voler la voiture du père de Derek, garée devant la maison. Alerté par son frère Danny alors qu’il est trop occupé à baiser à grands ahans sa copine gothique Staecy (Fairuza Balk), il sort en caleçon, svastika noire glorieusement affichée au-dessus du cœur et défouraille, menacé par l’un des agresseurs qui tient un pistolet. Jusque-là, c’est de la légitime défense, rien à dire dans les mœurs américaines – même si les armes en vente libre constituent selon nous, Européens, un net danger social. Mais lorsqu’il achève volontairement le second Noir blessé, un membre de l’équipe adverse qui l’avait défié les yeux dans les yeux après l’avoir frappé en plein match au mépris des règles, il va trop loin. Il lui place la mâchoire sur le rebord du trottoir et, d’un coup de talon, lui éclate la tête devant les yeux horrifiés du jeune Danny. Est-ce un rite nazi ? Une pratique esclavagiste ? Il semble que le Noir sait de quoi il retourne avant de crever.

Les flics arrivent aussitôt, alertés par les voisins des coups de feu. Derek est inculpé d’homicide volontaire et écope de trois ans à la prison pour hommes de Chino. Trois ans seulement parce qu’il est Blanc et en état de semi-légitime défense ; son codétenu Lamont (Guy Torry), un Noir à la lingerie qui le fait rire et le prend en amitié, a écopé de six ans pour avoir seulement laissé tomber un téléviseur volé sur le pied du flic qui lui attrapait le bras. Deux poids, deux mesures ? C’est ce que comprend Derek en prison.
Il n’est pas au bout de ses surprises : son idéalisme suprémaciste blanc est mis à mal par l’un des durs de la Fraternité aryenne incarcérée. Derek le voit ostensiblement trafiquer avec des Hispanos, violant le code racial idéal. Dès lors, le jeune homme comprend que c’est l’égoïsme qui mène les gens, pas les principes, et que « la race » n’est qu’un prétexte pour gagner et réussir. On ne joue pas collectif comme dans l’équipe de basket, on en profite perso pour ses trafics. Renouant alors avec « les nègres », Derek est violé sous la douche par le plus macho des Frères aryens. Après cette mésaventure et six points de suture à l’anus, il reçoit la visite du docteur Sweeney (Avery Brooks), son ancien prof d’histoire en prison, le même que celui de Danny. Il fait partie du comité ayant à juger de sa libération conditionnelle. Derek lui expose ses doutes et sa désorientation. Et celui-ci lui demande s’il s’est posé les vraies questions. Par exemple : « Est-ce que ce que tu as fait a amélioré ta vie ? »

Tout est là. La haine engendre la haine en retour, comme une vendetta sans fin ; elle aveugle sur les qualités des autres, les différents – ce dont Derek se rend compte en prison, forcé de travailler face à Lamont ; elle ne permet pas de constater avant la sortie que Lamont le protège sans en avoir l’air des viols et des blessures mortelles des Noirs, bien plus efficacement que les soi-disant « frères » blancs. Le docteur Sweeney avoue avoir eu la haine lui aussi quand il était jeune, contre les Blancs qui avaient asservi sa race et maintenaient sa communauté dans le sous-développement social, contre la société et même contre Dieu ! Mais il s’en est sorti par les études, et la culture lui a montré que le racisme était une castration de l’être, inefficace en société. C’est une réaction primaire, qu’il faut surmonter si l’on veut avancer. L’identité oui, la haine des autres pour se la constituer, non.

Lorsqu’il sort de prison après trois ans, son petit frère Danny vient de remettre par provocation un devoir d’histoire sur Mein Kampf : le sujet était de commenter un livre, ce qui choque son prof, juif et ex-amant de sa mère. Le principal est le docteur Sweeny qui connait bien les deux frères ; il décide alors de prendre en main Danny et lui offre le choix : l’expulsion ou un cours d’histoire qu’il intitule American History X. En référence à Malcolm X qui reprenait le sigle appliqué sur le bras des esclaves ; en référence au Christ qui était désigné par cette abréviation (le « vrai » Christ opposé au « faux » de Cameron ?). Mais X est aussi la valeur inconnue en mathématique, ce qu’il faut trouver. Son premier devoir sera donc de relater l’itinéraire de son frère aîné et de l’analyser.
Derek est accueilli comme un dieu par le gang de skinheads et Cameron lui fait miroiter la direction de tous les gangs qui se sont développés sur la côte ouest et qui se rassemblent. Mais il n’en veut pas ; il veut rompre avec tout ce folklore pour demeurés, avec ce ressentiment sans avenir, avec cette haine qui n’aboutit qu’à reconduire la haine – tout en profitant aux affaires commerciales de Cameron. Il le frappe, maîtrise le gros Seth (Ethan Suplee qui déclare « je ne suis pas gros, je suis costaud ! »), rejette sa copine Stacey qui ne pense qu’à briller dans le gang, jouissant quasi sexuellement de la violence et des gros muscles. Elle ne l’aime pas puisqu’elle ne veut pas lui faire confiance et le suivre. Danny, 17 ans, ne comprend pas et le violente mais Derek le calme, lui explique son itinéraire en prison et pourquoi il en est venu à penser que tout doit être différent. Son petit frère, au contraire de Stacey, lui fait confiance parce qu’il l’aime. Il le suit. Edward Furlong est très bon acteur dans les rôles de petit frère soumis.

Il rédige donc dans ce sens le devoir que le docteur Sweeney lui a demandé pour le lendemain et sa conclusion, après que Derek lui ait raconté, est celle du discours d’investiture d’Abraham Lincoln : « Nous ne sommes pas ennemis, mais amis. Nous ne devons pas être ennemis. Même si la passion nous déchire, elle ne doit pas briser l’affection qui nous lie. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu’on les touchera, elles résonneront au contact de ce qu’il y a de meilleur en nous. » Hélas ! Alors qu’il va pisser au collège, un Noir le descend d’un coup de pistolet, celui-là même qu’il avait défié d’un regard quelques jours auparavant. La haine demeure – la vendetta va-t-elle se poursuivre ? Le film reste sur ce suspens.

Mais l’on voit avec Trump, vingt ans après, qu’elle est sans fin parce que le ressentiment ne meurt jamais et que, plus courtes sont les idées, plus elles marquent les esprits obtus et faibles. Les Yankees ne forment pas un peuple mais une mosaïque, le patriotisme n’existe que s’ils sont attaqués sur leur sol. Entre temps, c’est chacun pour soi, le Colt dans une main pour expédier et la Bible dans l’autre pour justifier ; les financiers et le lobby de l’armement et du pétrole commandent, les riches se préservent de la racaille, les flics tuent plus de Noirs que de Blancs, l’école se délite dans le politiquement correct et la niaiserie sentimentale.
Qu’avons-nous encore de commun avec ces gens-là ?
DVD American History X, Tony Kaye, 1998, avec Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D’Angelo, Avery Brooks, Jennifer Lien, Ethan Suplee, Stacy Keach, Fairuza Balk, Metropolitan video 2001, 2h03, standard €6.99 blu-ray €8.70











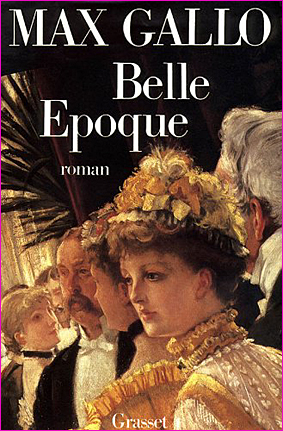


















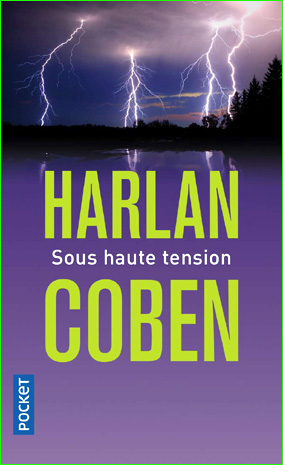
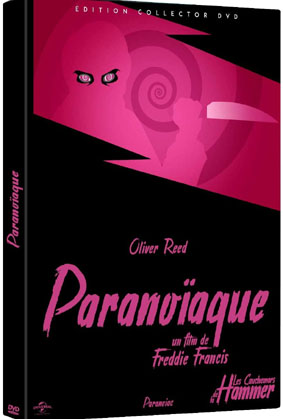





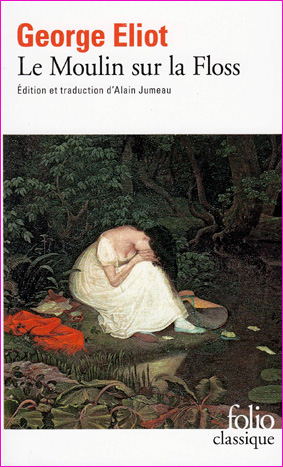

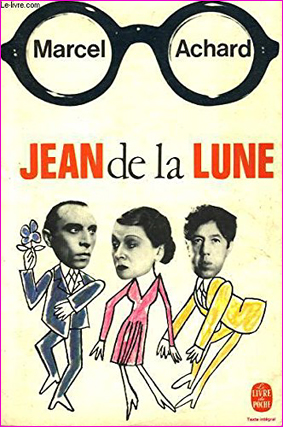

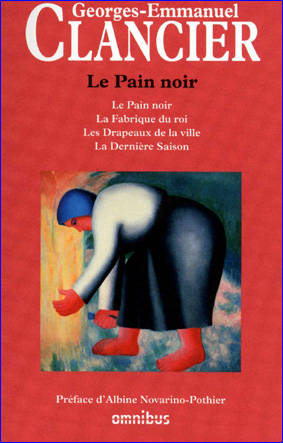
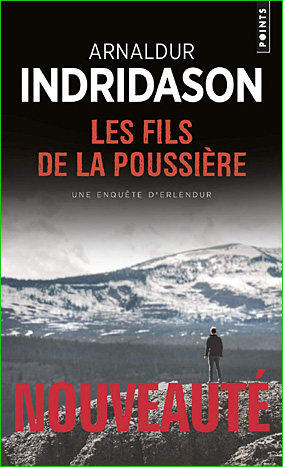








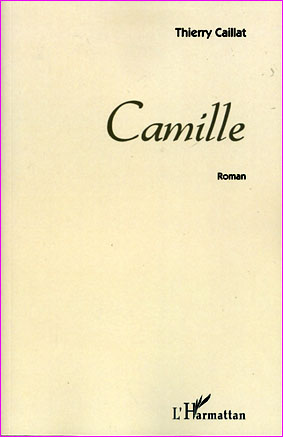








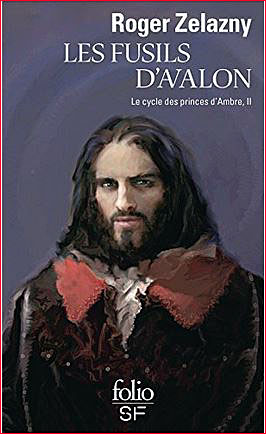

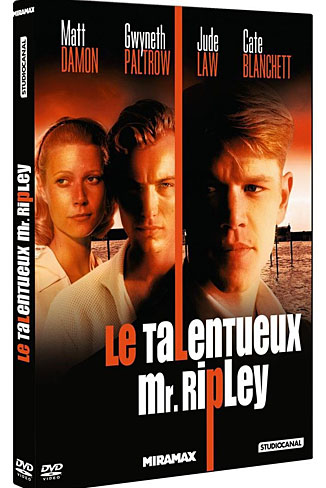











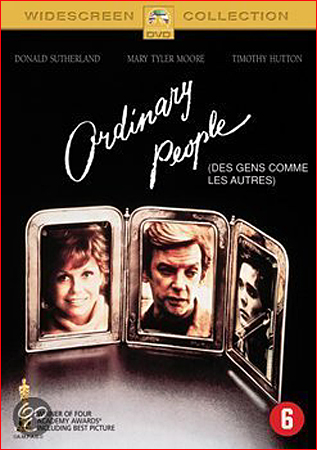




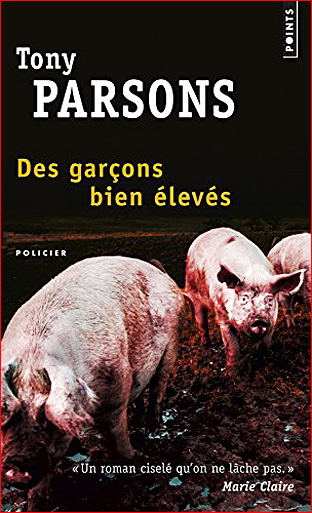

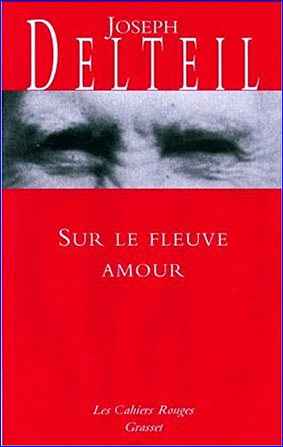
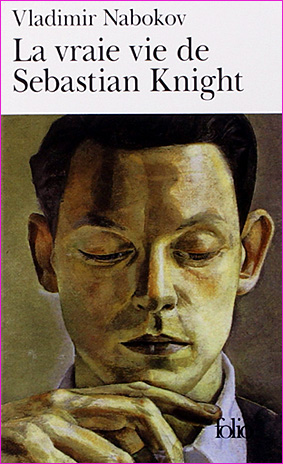









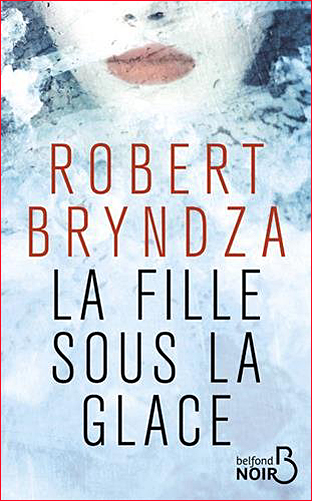







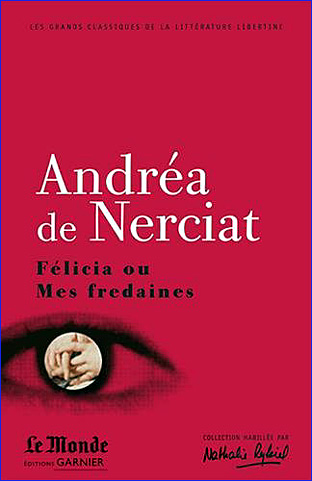




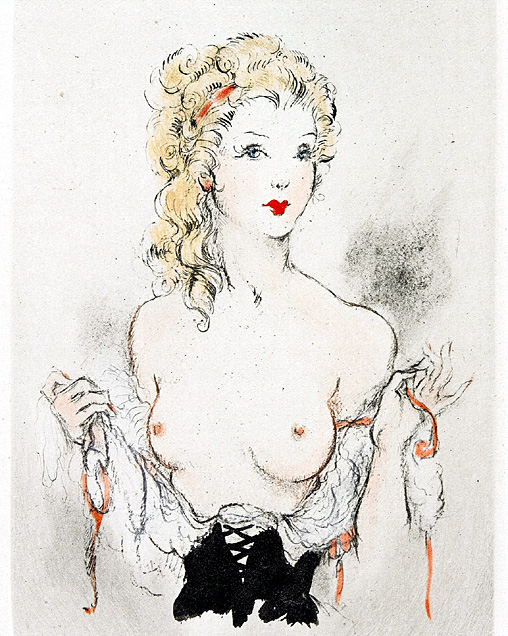
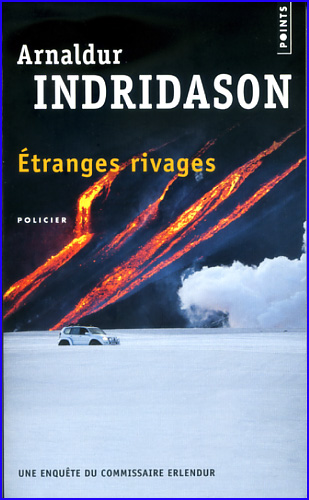

Commentaires récents