Nous irons déjeuner au Ella Hotel Maideya’s Club. La station d’Ella, à 1200 m d’altitude, est prisée des Allemands parce qu’il n’y fait pas trop chaud et pour ses soins ayurvédiques ; il y a des voyages entiers composés en Allemagne sur ce thème. Il est indéniable qu’en traversant le village, le tourisme l’a bien contaminé.
L’hôtel n’a ouvert que depuis quelques mois seulement et le service est tout d’amateurisme. La cuisine ouverte sur la salle est tendance, mais le cuisinier ignore qu’il faut brancher la hotte aspirante quand il fait des frites et autres graillons : l’air saturé d’huile envahit la salle de restaurant ! Les serveurs sont malhabiles mais servent du pain aux herbes de style provençal fort goûteux. Les assiettes montrent un effort de décoration louable. Nous déjeunons d’une tranche d’espadon grillée avec un beurre à l’ail, entourée de petits légumes « anglais », carotte, haricots verts, épis de maïs nain, de frites et de riz blanc. Il fait grand soleil dehors, et le litre d’eau minérale achetée au déjeuner 140 roupies ne dure que l’après-midi.
La suite prévue est une randonnée sur les rails du chemin de fer des montagnes à voie unique, dont le dernier train vient de passer à la gare. Pas d’autre train avant 16 h. Malgré le plat, il n’est pas facile de marcher sur les traverses ; elles ne sont pas à notre pas, et d’ailleurs inégales. Il faut soit en sauter deux, soit piétiner à petits pas, soit marcher à demi sur le ballast en pas intermédiaire, ce qui convient uniquement lorsque les intervalles entre les traverses sont comblés de gravier ou de terre. Tout cet effort d’une heure de marche sous le cagnard du début d’après-midi pour aller voir le pont aux neufs arches, construit par les Anglais au siècle XIX ! Certes, il y a bien neuf arches au-dessus de la rivière, les rails passent confortablement dessus, et je confirme que le pont tient toujours après 150 ans – mais notre vie même n’aurait pas été changée si nous ne l’avions pas vu. Le Sri Lanka considère comme « historique » ce monument, puisque la civilisation moderne n’a débuté ici qu’avec l’arrivée des Anglais.
Nous revenons à Ella-gare par le même chemin de traverses pour aller faire une autre promenade touristique, pompeusement baptisée « randonnée », au mini Adam’s Peak. En d’autres saisons, le circuit propose l’ascension du vrai Adam’s Peak, l’un des points les plus hauts de Ceylan à 2243 m (pas le plus haut, qui est le Pidurutalagala à 2524 m). On dit que le pic Adam serait le berceau de l’humanité, on cite même une empreinte de pied humain sur le sommet de ce bout du monde, vénérée dans un « petit temple bouddhiste qui y a été construit pour abriter l’empreinte du pied d’Adam, laquelle n’est autre qu’une excavation de quelques centimètres de profondeur, oblongue, d’une longueur de 3 mètres et ne ressemblant nullement à un pied », comme le précise en 1898 Ed. Cotteau lors de sa Promenade dans l’Inde et à Ceylan. Francis de Croisset renchérit, dans La féérie cinghalaise, récit de 1935 : « A la vérité, cette légende n’est point sans rencontrer de contradicteurs. Les bouddhistes, si nombreux à Ceylan, affirment que la montagne ne devrait pas s’appeler pic d’Adam, mais bien le Scri-Pada, ce qui signifie le Pied divin. L’on voit, en effet, à la pointe extrême du pic, une empreinte géante qui n’est autre que celle du pied de Bouddha. A quoi les Hindous de l’île apportent un démenti gênant, car ils savent que l’empreinte est due, non au pied dérisoire de Bouddha, mais à celui infiniment plus vénérable de Vichnou. »
Mais, en période de mousson, il n’y a rien à voir, tout est couvert de nuages bas. Le sentier du mini Peak est balisé et un escalier est prévu pour redescendre, pas de quoi se perdre ni exiger de grosses chaussures. Le soleil est derrière les nuages et il est déjà 17 h.
En haut, nous rencontrons des familles en promenade du dimanche, les papas particulièrement fiers de leur bébé un peu grandi. Je prends en photo, un peu en contrebas du col, une « famille idéale » de Ceylan : un couple avec trois beaux enfants de 12, 10 et 7 ans environ, une fille aînée et deux garçons. Ils sont maigres mais vifs, le petit porte une médaille de cuivre au cou qui ravive son teint sombre. Il me prend la main de joie en criant « thank you, oh, thank you ! » quand je leur montre la photo d’eux que je viens de prendre. Son frère le mignote, peau à peau, se tortillant de pudeur. La fille aînée porte une ravissante robe turquoise à volants, brodée de rose et de blanc au col, et un foulard de soie blanche au cou. Famille optimiste dans un pays en pleine émergence, enfin en paix et dans un monde qui bouge, dans l’explosion asiatique. Il y a de quoi être fier de ses trois beaux enfants.
Coucher de soleil sur la colline, à demi masqué par les nuages. Il donne de jolies couleurs.
Nous retournons au même hôtel qu’hier pour une douche bienfaisante, une bière rafraîchissante et des pages d’écriture réjouissantes.













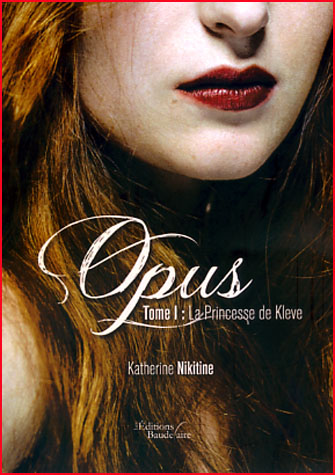
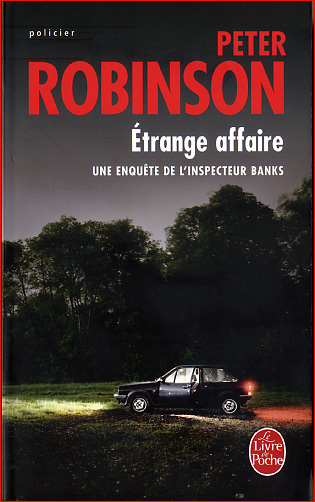



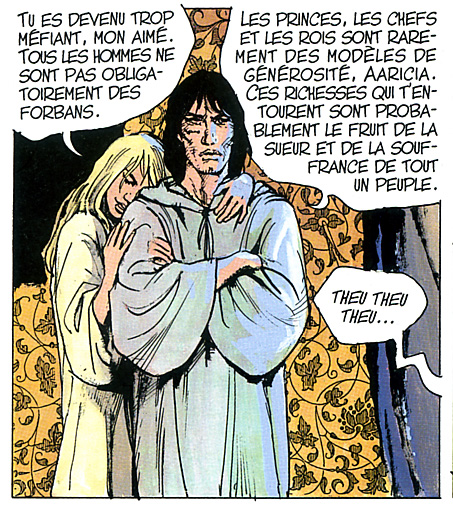




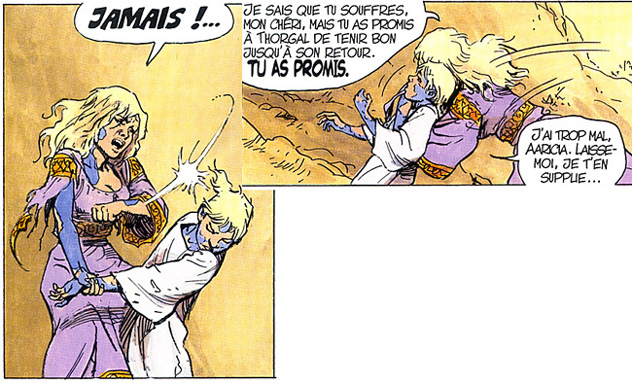
































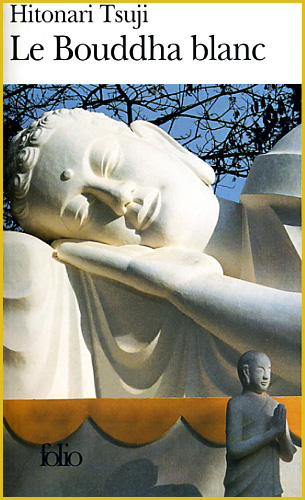


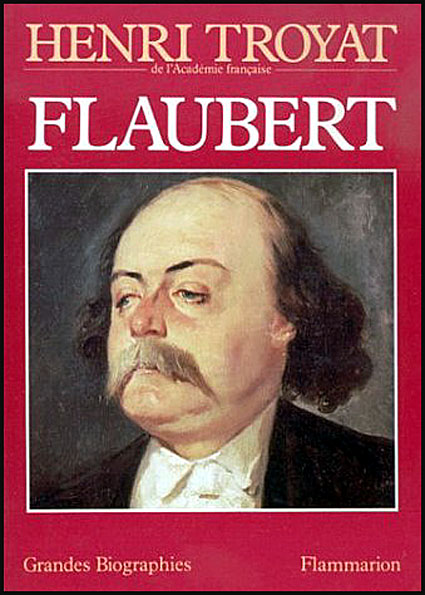


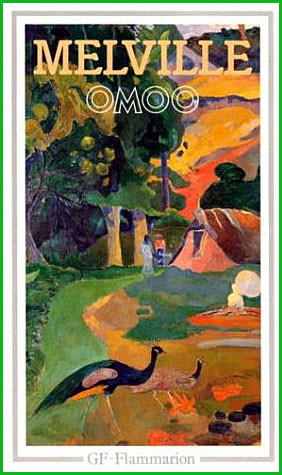

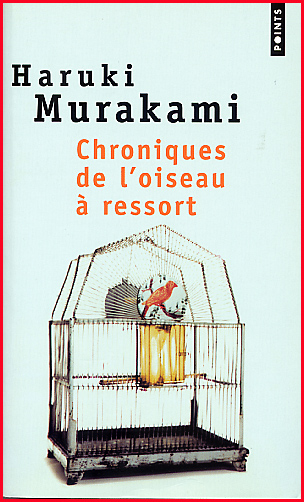





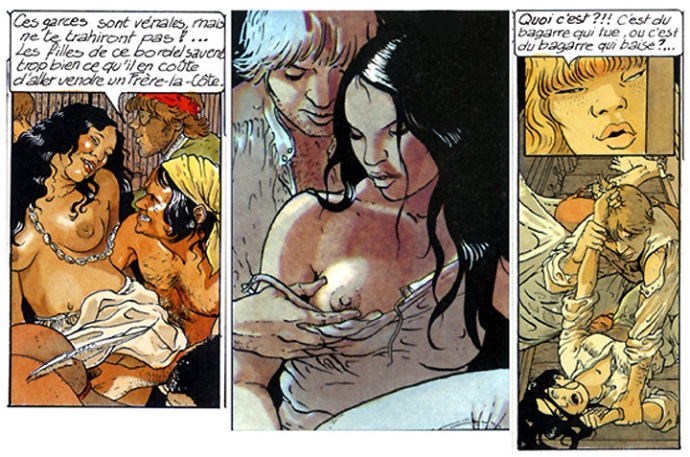



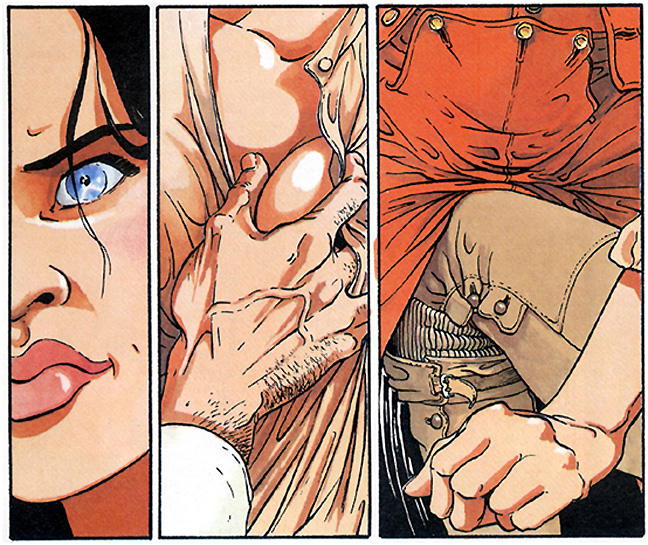
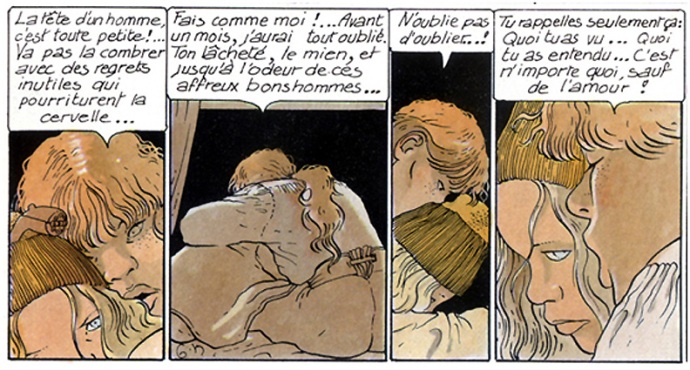
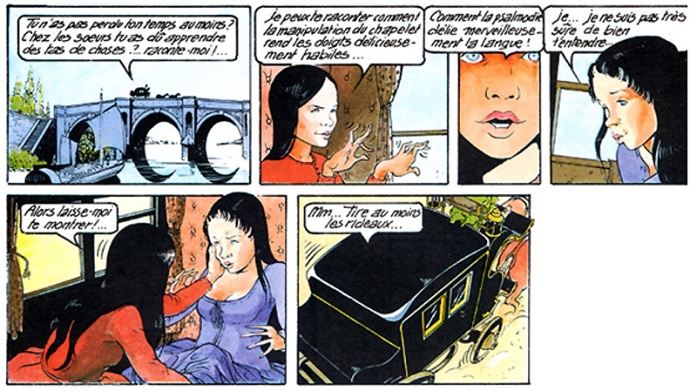
Commentaires récents