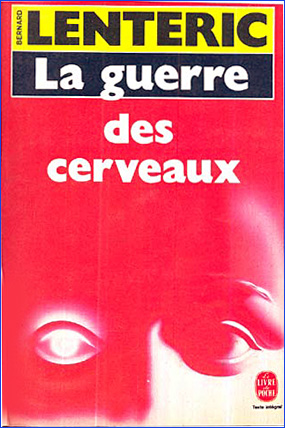
Décédé en 2009 à 75 ans, Bernard Lenteric fut l’un des auteurs de bons thrillers français, au temps où le genre faisait florès. Il a surfé sur les modes. Autant aujourd’hui c’est la Chine qui focalise l’attention, autant dans les années 1980 c’était le Japon. La guerre froide subsistait et l’URSS faisait peur plus par ce qu’on imaginait de mystère que par la triste réalité des choses. Mais les Américains se devaient de considérer l’empire soviétique comme un égal. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, au grand dam du tyran mongol national-xénophobe qui voudrait bien renverser le cours de l’histoire malgré son pays en déclin qui ne fait plus le poids face à des mastodontes démographiques et technologiques comme l’Inde, la Chine, les États-Unis, l’Union européenne ou le Japon…
Un prix Nobel américain pète les plombs après avoir reçu un coup de téléphone ; il massacre toute sa famille avant de s’éradiquer. Un peu plus tard, un neurochirurgien de renom saccage un cerveau blessé avant d’être interné. Encore plus tard, un Français au Muséum détruit ses bureaux et brûle toute sa recherche. Puis un Anglais élitiste va tuer d’un coup de canne-épée un savant qu’il ne connaît pas en lui transperçant le cerveau avant de se tirer une balle dans la tête. Mais cet Ashby n’est pas n’importe qui. Il appartient au club très fermé des intelligences de la planète qui se nomment entre eux les Titulaires. Ils se chargent de détecter les savants prometteurs pour les financer au travers de leur Fondation, avant de les coopter éventuellement pour leur succéder.
Ashby était l’un des quatre, il avait choisi son successeur : un Japonais de la trentaine suprêmement intelligent et descendant de samouraï. Travaillant pour la firme Mitsubishi, il étudiait le cerveau, ou plutôt comment détecter la pensée via l’électronique. L’intelligence artificielle en était à ses débuts et lui avançait par l’imagerie cérébrale tandis que l’Américaine Jessy Flanaghan mettait en conserve les connaissances des cerveaux qu’elle choisissait encore vivants. Les coups de folies répétés des vieux savants étaient une perte pour l’humanité comme pour cette science en devenir.
Peskov, un physicien américain d’origine russe, qui avait travaillé sur la Bombe, se pose des questions. Qu’est-ce qui peut bien relier ces morts successives ? Un sondage auprès d’un savant de ses amis, affilié au KGB à Leningrad, lui apprend que la même chose a eu lieu en URSS, mais évidemment tue par goût du secret. Un savant parti pêcher avec un jeune garçon l’a étranglé après l’avoir sodomisé puis s’est suicidé. Il n’avait jamais montré de tendances à la violence ni d’attirance pour son sexe.
Le point commun ? Si le lecteur observe que les premiers savants fous sont tous juifs, la piste s’arrête là. Il s’agit d’autre chose : tous ont en commun d’avoir séjourné au Japon et de s’être intéressés aux travaux sur le cerveau de la firme Mitsubishi. Difficile d’en dire plus sans déflorer la jeune histoire, mais il s’agit de complot mondial, de manipulation subtile, d’ambitions nationalistes. Qui joue avec qui ? Dans quel but ? S’agit-il d’une « guerre » des cerveaux ou n’est-ce qu’un propos de journaliste ?
Bien mené, ce thriller des années 80 nous conduit là où il faut. Il montre en tout cas que les passions humaines restent éternelles et que la curiosité scientifique peut déraper au service de la puissance.
Bernard Lenteric, La guerre des cerveaux, 1985, Livre de poche 1986, 315 pages, €3,87















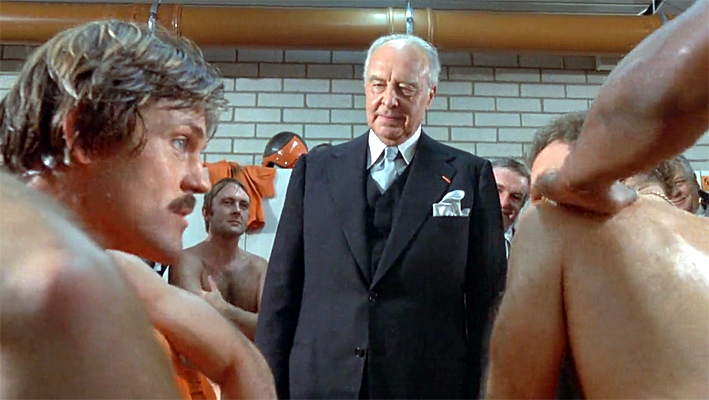




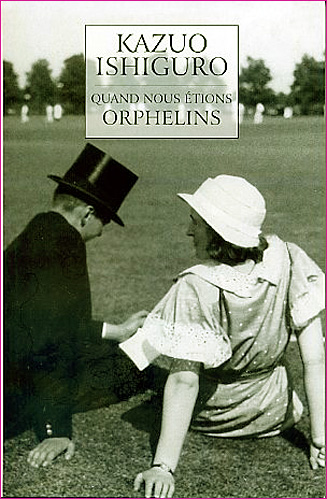
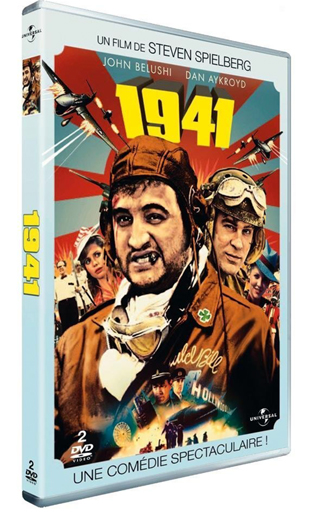








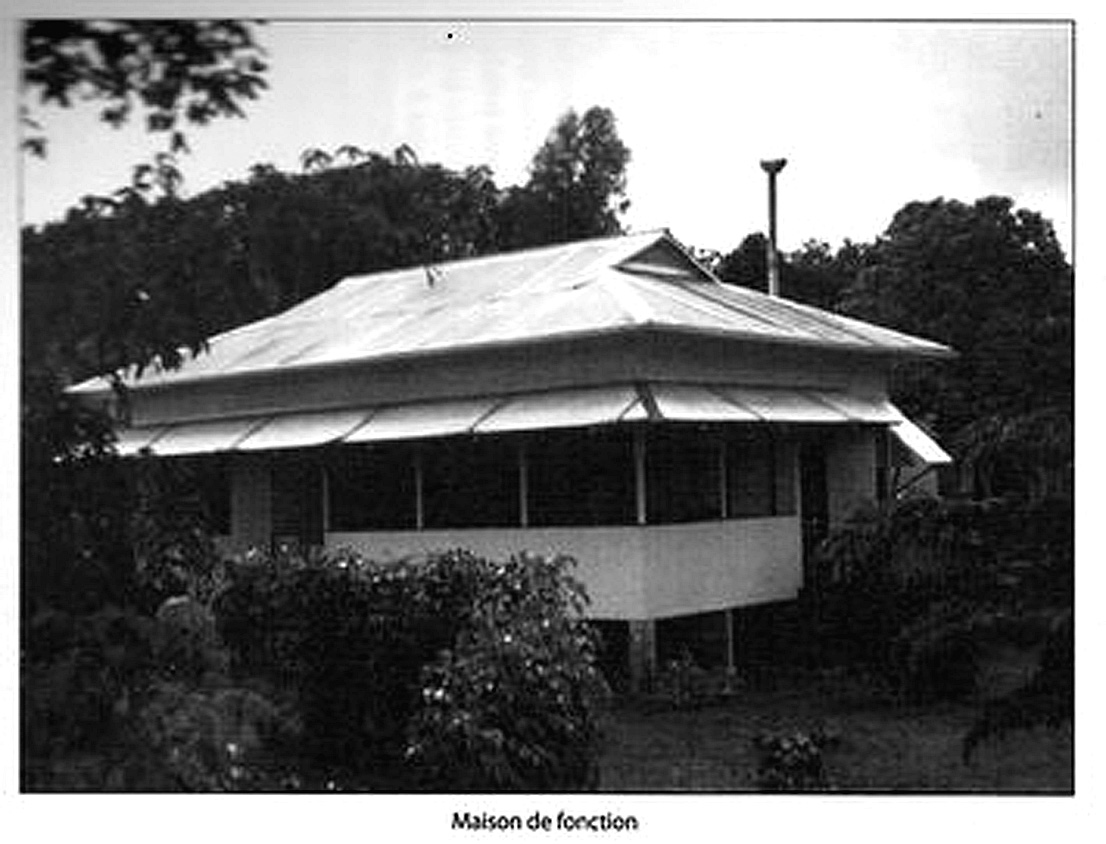

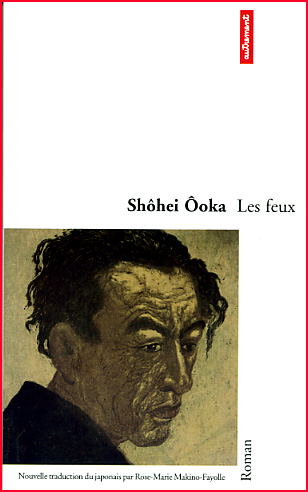


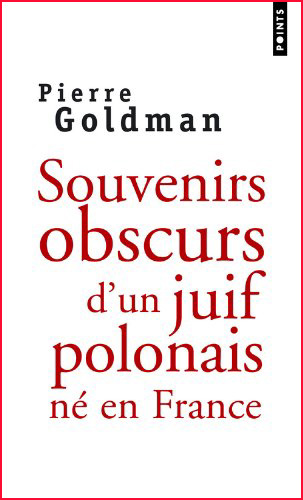

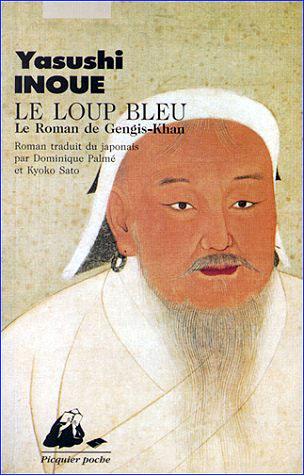
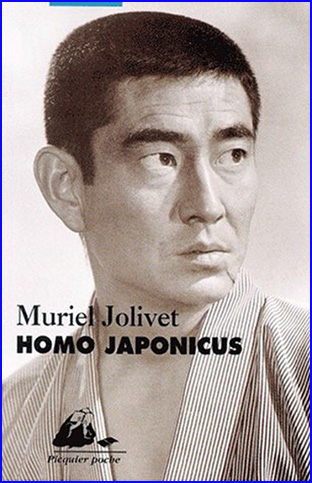







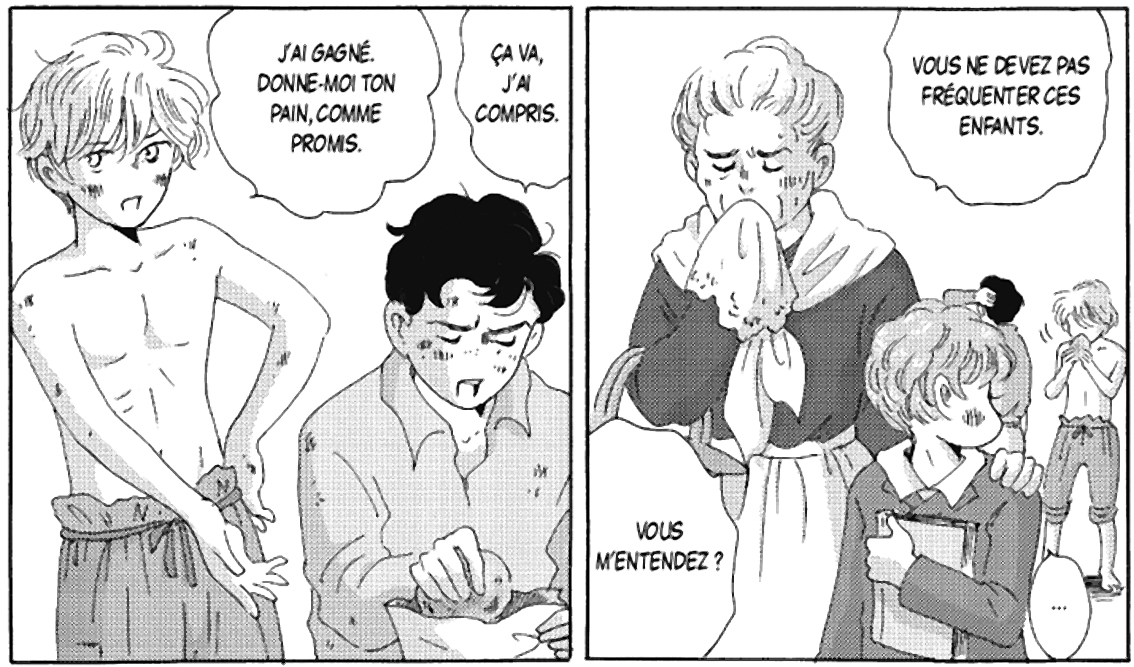




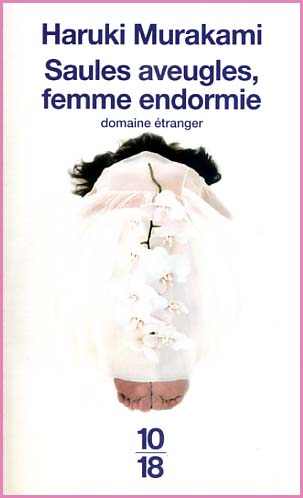























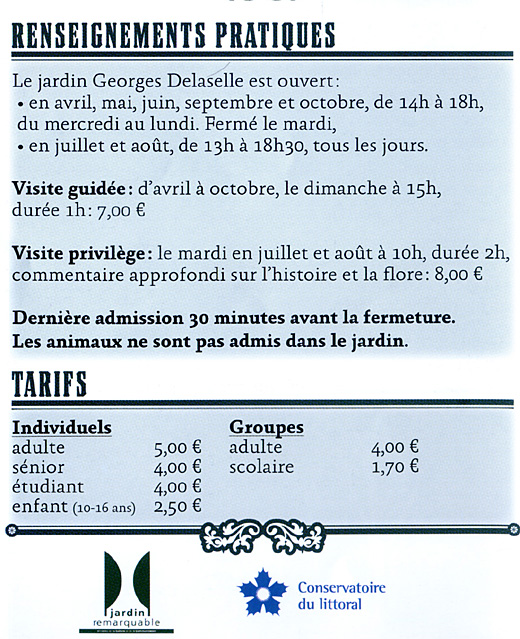
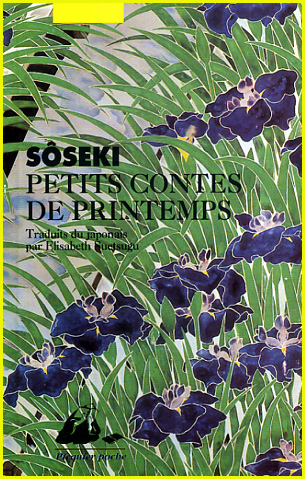
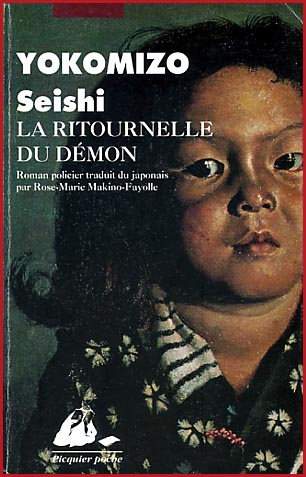
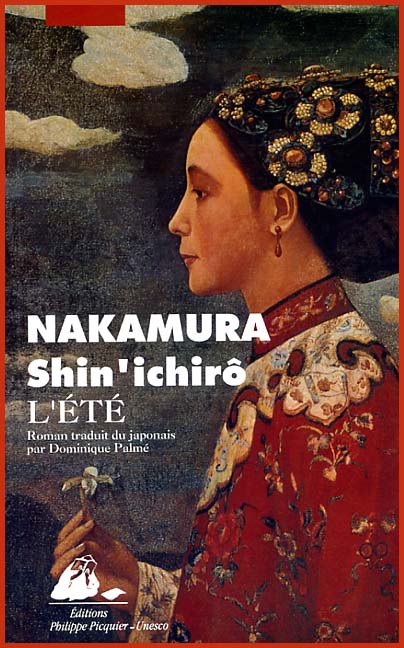









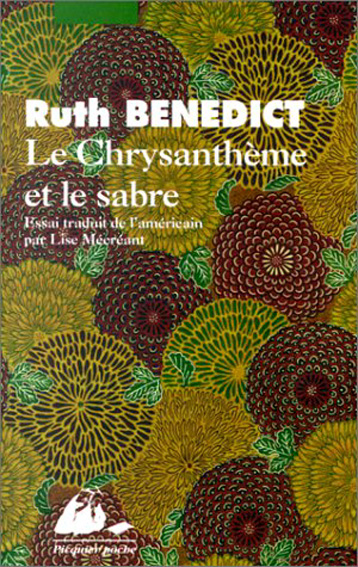
Commentaires récents