Les meurtres se succèdent tandis que l’on n’arrête pas de naître dans ce volume. Deux accouchements nous sont contés dans les moindres détails, l’un hier, en 1945, l’autre aujourd’hui, en 2007. Rien à voir, sauf les liens entre les personnes. Le titre en français donne malheureusement une clé que le titre suédois laisse dans l’ombre… Le marketing éditeur est si frivole, en France.
Comme souvent dans les séries, il est bon de lire les opus dans l’ordre, ce qui laisse au lecteur le temps d’assimiler les personnages, de s’en faire des amis. Si l’on suit ce précepte, on retrouve avec plaisir Erica, écrivain à la maison, épouse de Patrick, policier qui, cette fois, a pris un congé parental pour s’occuper de leur fille, Maja, bébé d’un an exigeant. Pas facile d’écrire dans les hurlements et les cavalcades… pas facile d’être en congé de police quand un meurtre vient exciter le commissariat de la station balnéaire de Fjällbacka.
Deux ados de 14 ans se sont introduits dans la maison d’un ex-prof, collectionneur d’insignes nazis. Ils découvrent un cadavre. Qui a tué l’inoffensif Erik ? Des néo-nazis comme il en surgit de plus en plus ? Un vengeur pour ce que fait le frère, Axel, chasseur de nazis impitoyable depuis la fin de la guerre ? Un être surgi du passé ?
Si la Suède était neutre lors du second conflit mondial, elle a collaboré ; dans le même temps, les pêcheurs suédois aidaient la résistance norvégienne, pays stratégiquement placé, occupé par les nazis. Une bande de quatre ados se sont connus durant ces années noires, plus un cinquième, tout jeune Norvégien évadé qui s’est caché chez le père de l’une des filles. Qui en est tombée amoureuse : qu’est-ce qu’avoir 15 ans quand votre héros en a 17 ? Enceinte à la fin de la guerre, elle voit son promis amoureux partir pour « régler quelques affaires » – et ne jamais revenir.
Cette fille, c’est la mère d’Erica, qui découvre au grenier quelques carnets intimes. Curieusement, manquent les derniers : où sont-ils passés ? Y aurait-il eu quelque chose à cacher ? Quel rapport avec le présent ?
Le meurtre d’une autre des filles de la bande survient, après celui d’Erik ; désormais, deux sur quatre ne sont plus. Sans parler du disparu. L’enquête piétine, rien ne sort, et il faut que l’écrivain Erica mette son talent de romancière noire pour que cette somme d’efforts conjugués produise quelques résultats. Tout n’est pas inscrit dans les archives et il faut savoir chercher et savoir lire. Pas simple, d’où la taille du roman.
D’autant que la petite vie des gens se poursuit, dans le quotidien prosaïque. Quand ils ne sont pas flics, chacun a ses amours, ses regrets, ses soucis. Patrick aimerait bien revenir travailler, mais il savoure chaque moment passé avec son bébé fille ; Martin son adjoint se sent devenir un homme en dirigeant l’enquête en son absence ; Paula, nouvelle venue au commissariat, a un bébé par procuration avec son conjoint… femme. On n’est pas en Suède pour rien, la blondeur nordique fait honte depuis la révélation nazie et le mélange avec le plus coloré possible est bien vu. Même si certains ne sont pas d’accord, comme Frans, l’autre garçon des quatre.
Sauf qu’il a donné le mauvais exemple à son fils et à son petit-fils, que le premier a réussi à le haïr et que le second, qui l’admire, est sur une mauvaise pente. Le passé éclaire le présent, ou l’inverse, et les chapitres alternés donnent une autre vision des remous actuels en Europe du nord. « Le présent est si puissant, bien plus que le passé », philosophe un personnage p.425. « C’est dans la nature de l’homme de ne pas regarder les conséquences de ses actes, de ne pas apprendre de l’histoire. Et la paix ? Si on ne l’a pas connue au bout de soixante ans, on ne la connaîtra jamais. Il incombe à tout un chacun de se la procurer, on ne peut pas attendre une juste punition et croire qu’ensuite la paix se présentera toute seule ».
Chasser les nazis n’a pas empêché les génocides ni les atrocités cautionnée pour le bien de l’humanité par « nos » intellectuels occidentaux : dans la Chine de Mao, au Cambodge, au Chili de Pinochet, en Iran, en Tchétchénie, en ex-Yougoslavie, au Rwanda, en Palestine, en Irak, en Syrie, au Nigeria… Le « nazisme » ou son équivalent est prêt à ressurgir partout, dès lors que les circonstances sont favorables. Se donner bonne conscience en jugeant du passé, des décennies plus tard, ce n’est pas de la morale mais de la pure et simple vengeance. Quelque chose d’obscur qui vient de l’Ancien testament, pas du nouveau, ni du simple humanisme…
En revenir sans cesse et toujours au passé nazi empêche de voir au présent tout ce qui ne va pas. Il est tellement plus facile de s’indigner d’une histoire déjà écrite, quand on sait comment elle s’est terminée, qui sont les bons et les méchants – plutôt que de chercher, à tâtons mais responsable, comment distinguer le bien et le mal et se débrouiller au mieux d’aujourd’hui.
Un roman policier dense et humain qu’il fait bon savourer lors de longs voyages en train ou lors de soirées silencieuses, dans son fauteuil. Le thème en est l’amour, malgré les découvertes macabres.
Camilla Läckberg, L’enfant allemand, 2007, Babel noir 2014, 602 pages, €9.90
Format Kindle €9.99
Livre audio éditions Suspense 2CD €25.40
Les romans policiers de Camille Läckberg chroniqués sur ce blog






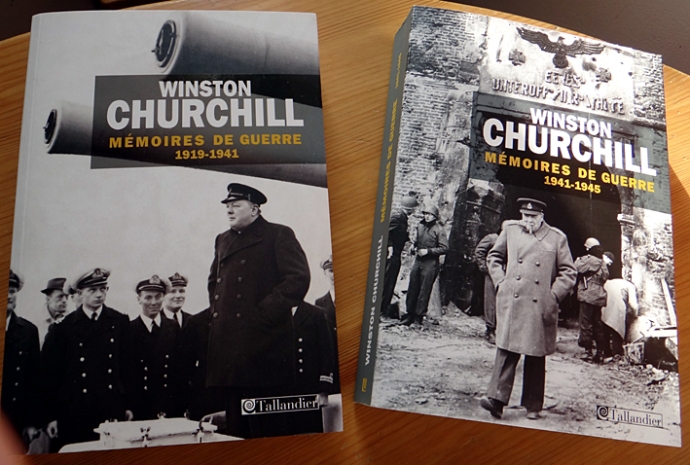



Commentaires récents