
Le vide et l’effusion sentimentale : c’est tout le torrent de mots de ce livre, écrit durant les bouleversements politiques, économiques et mentaux de la Révolution française. L’auteur, né en 1770, s’est imbibé de Rousseau pour pondre ce livre préromantique qui n’est pas un roman, ni un essai, mais des songeries inspirées de la nature alors que le monde est chamboulé en son intime.
Sainte-Beuve en fera l’éloge, ce qui rendra le livre célèbre. Frantz Liszt a consacré l’une de ses années de pèlerinage (en Suisse) à Oberman. Mais les états d’âme de l’auteur sont bien mièvres, même si écrits d’une belle langue. Il est vide et submergé d’émotions ; il n’évoque que les regrets de ce qu’il n’a point accompli, et des confessions de jeune homme qui ne sait pas ce qu’il est. Une sorte d’adolescent avant que le type n’existe, un gémissant qui désire tout court, sans savoir quoi ni qui. Il n’est pas à sa place dans le monde, la société et sa famille et sanglote. Les lamentations de Sénancour sur son tas de fumier, alors qu’il se voyait promis à de hautes pensées, sont la résultante des railleries de sa copains de collège. Lui l’inadapté, a tenté de faire de sa blessure une plaie universelle – et ce n’est pas trop mal réussi.
« Indicible sensibilité ! charme et tourment de nos vaines années ; vaste conscience d’une nature partout accablante et partout impénétrable ! passion universelle, indifférence, sagesse avancée, voluptueux abandon : tout ce qu’un cœur mortel peut contenir de besoins et d’ennui profond ; j’ai tout senti, tout éprouvé dans cette nuit mémorable. (…) Qui suis-je donc, me disais-je ? Quel triste mélange d’affection universelle, et d’indifférence pour tous les objets de la vie positive ! Une imagination romanesque me porte-t-elle a chercher, dans un ordre bizarre, des objets préférés par cela seul que leur existence chimérique pouvant se modifier arbitrairement, se revêt à mes yeux de formes spécieuses, et d’une beauté pure et sans mélange plus fantastique encore. » Lettre 4.
Il a ce qu’on appellera, mais plus tard, le spleen, ce sentiment de décalage entre l’être et le monde. Il se sent vide, et peut-être l’est-il au fond. Toute la substance de l’œuvre est dans ce ressenti face à la nature, dans ces épanchements émotionnels abstraits envers les semblables – qu’il fuit. Il voudrait autre chose, du mieux, mais quoi ?
« Il y a une distance bien grande du vide de mon cœur à l’amour qu’il a tant désiré ; mais il y a l’infini entre ce que je suis, et ce que j’ai besoin d’être. L’amour est immense, il n’est pas infini. Je ne veux pas jouir ; je veux espérer, je voudrais savoir ! Il me faut des illusions sans bornes, qui s’éloignent pour me tromper toujours. (…) Je veux un bien, un rêve, une espérance enfin qui soit toujours devant moi, au-delà de moi, plus grande que mon attente elle-même, plus grande que tout ce qui passe. » Lettre 18.
L’auteur a connu une vie errante entre la France et la Suisse, valorisant les bergers solitaires dans les montagnes nues (ou peut-être inconsciemment l’inverse, lui que son père destinait au séminaire où l’on apprend de drôle de mœurs). Il abandonne son âme aux songes. La réalité lui fait mal, la société lui est douloureuse car elle l’éloigne de ce divin ressenti tout seul dans les hauts.
Mais Sénancour n’est pas Nietzsche et son jeune homme point Zarathoustra. Il est le velléitaire empoissé de faiblesse, celui qui préfère l’illusion au vrai, ce lâche qui refuse de se battre pour la vie et finira obscur, végétant dans de petits boulots littéraires après un mariage raté. Une curiosité de lecture qui fait partie de la littérature française.
Étienne Pivert de Sénancour, Oberman, 1804, Garnier-Flammarion 2003, 570 pages, €14,00 e-book Kindle gratuit










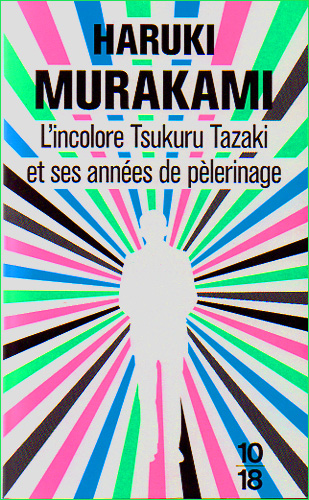
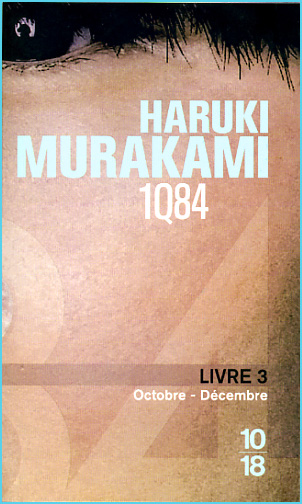
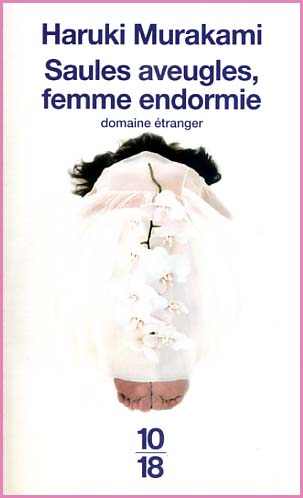

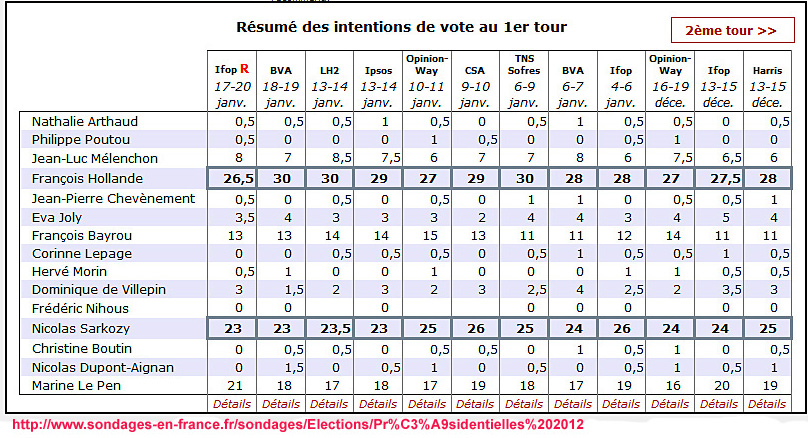
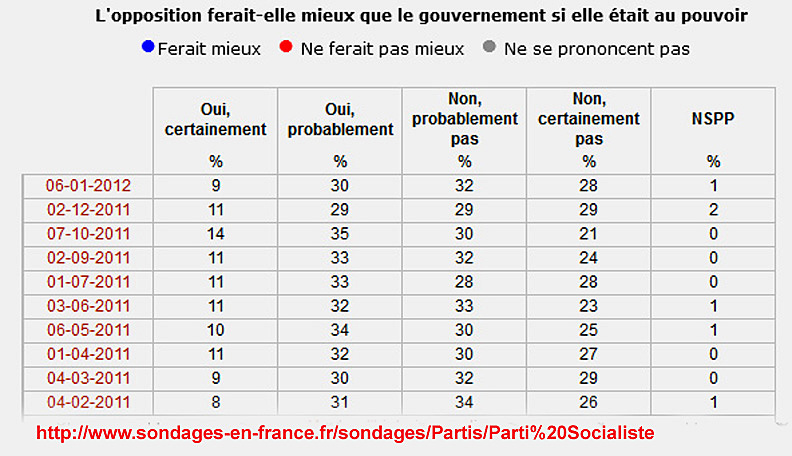



Commentaires récents