Un thriller efficace sur un scénario banal dans la théorie du Complot chère à l’époque. Tiré du livre Point of Impact de Stephen Hunter, il met en scène le Yankee moyen, le sergent Bob Swagger (Mark Wahlberg), en butte aux riches et puissants qui veulent n’être qu’encore plus riches et puissants. Le patriotisme est utilisé comme hochet pour agiter le peuple tandis que la super-élite se goinfre sur le dos de la planète, des gens pauvres et des pays faibles.
Le sergent des marines Bob Lee Swagger est dressé pour tuer au fusil à longue portée CheyTac M200 Intervention. Il est un expert de son métier, capable d’évaluer le vent, l’hygrométrie et la température pour ajuster sa hausse à plus de mille mètres. Formé à l’excellence par le système, il est sacrifié lors d’une mission clandestine en Éthiopie où la CIA protège des mercenaires yankees chargés de faire le vide (par le massacre) d’un territoire destiné à un oléoduc de pétrole. Demandant une protection aérienne devant la survenue d’une armada ennemie, cela lui est refusé et la liaison est coupée : on ne vous connait plus. Son observateur est tué à ses côtés et lui parvient à s’en sortir et se venge. Le chef de la CIA qui a ordonné de le laisser tomber « disparaît » un mois après.
Le sergent se retire dans les Rocky Mountains (ce refuge du Millénaire) où il vit en solitaire survivaliste avec son chien. Trois ans passent mais il est rattrapé par son dossier. Un certain colonel Isaac Johnson (Danny Glover) – un Noir pour montrer que la corruption n’épargne personne – parvient en puissant 4×4 V8 à accéder à son chalet perdu et lui demande de l’aider – en tant qu’expert – à contrer un attentat prévu contre le président des États-Unis. Swagger, un peu con, ne voit pas le piège pourtant évident : son expertise peut servir sur le terrain à réaliser l’impossible en temps réel, tirer à plus de mille mètres sur une cible protégée par les Services seulement jusqu’à 800 m. Où l’on mesure le grand écart entre la formation experte pointue, délivrée par l’entraînement américain à ses spécialistes, et leur niveau de bêtise. Gros bras, petit cerveau ; tout dans l’action efficace, rien dans la réflexion. Le succès des bataillons français lors de la première guerre du Golfe avait de même surpris les Américains, peu habitués à ce qu’un colonel prenne de l’initiative sur le terrain.
Le président doit prononcer prochainement trois discours dans trois villes et Bob finit par accepter par « patriotisme », bien qu’il n’aime pas spécialement ce président (le tournage a lieu en 2007 et le président est George W. Bush). Il confie son chien, et explore les trois villes pour cibler le meilleur lieu pour un attentat, livrant tout cuit le meilleur plan aux comploteurs. Ce sera à Philadelphie.
Le fameux jour, Swagger parle tout haut en expert et donne le moment où le tir doit avoir lieu. Les comploteurs sont ravis et tout se passe comme prévu : « on » tire sur le président à la tribune. Sauf que ce n’est pas lui qui est touché mais l’évêque d’Ethiopie à un mètre à sa droite, venu là pour « dénoncer » des faits. Il ne parlera plus et le spectateur saura de quoi il retourne par la suite. Aussitôt, le shérif de la ville, Timmons tire dans le dos sur un Swagger qui ne se méfie pas. Il est touché à l’épaule droite et sur le flanc mais bascule par la fenêtre et réussit à fuir. Il rencontre un agent du FBI sorti de l’école trois semaines plus tôt, Nick Memphis (Michael Peña), lui vole son flingue et sa tire après lui avoir quand même dit ne pas avoir tué le président.
Course-poursuite classique, ruse dans une station de lavage pour échapper à l’hélicoptère de traque, trucs pratiques pour soigner une blessure par le sucre désinfectant, Swagger va trouver la seule personne en qui il a confiance au plus près de là : la fiancée de son coéquipier tué, Sarah, qui voulait devenir infirmière. Il a lui a écrit une longue lettre après le décès de son ami Denis et envoyé des fleurs chaque année. La fille aux seins bien moulés vit seule, hésite à l’aider, alertée par les médias qui dénoncent le sergent comme auteur de l’attentat, ne connait rien au métier d’infirmière, « fantasme de Denis », et manque d’appeler la police. Puis elle se ravise, selon les stéréotypes classiques de l’instinct maternel et de l’obscur désir pour les muscles vigoureux. En bref elle suit ses instructions, va se fournir en magasins et le soigne.
Swagger se remet (un peu vite pour la vraisemblance) et décide de traquer les comploteurs car il sera à jamais recherché s’il ne le fait pas. Cette prédestination est bien dans la mentalité biblique version protestante – et la seule façon de s’en sortir est de se montrer méritant, donc d’agir. Il sauve l’agent du FBI qui commençait à avoir des doutes sur la version officielle et s’intéressait de trop près aux détails de l’attentat : son supérieur lui dit carrément d’attendre le rapport officiel pour rédiger son propre rapport. Encore une fois, le système montre ses contradictions en formant des spécialistes pointus tout en les forçant à ne surtout pas penser par eux-mêmes mais à aveuglément obéir (la bonne recette pour opérer des attentats aux Etats-Unis, le livre que lit Swagger porte justement sur le rapport du 9-11). Comme l’agent du FBI s’y refuse, les comploteurs mettent en scène son suicide et Swagger intervient in extremis, comme il se doit, avec sa spécialité qui est le tir à longue portée. Les deux vont alors remonter la filière. Il y aura d’autres péripéties, Sarah sera enlevée et violée pour faire pression, des tirs fuseront dans tous les sens, beaucoup d’explosions illumineront l’écran, en bref vous ne vous ennuierez pas.
La fin n’est pas morale – mais efficace : dans la mentalité yankee. Un immonde sénateur (le gros Ned Beatty) qui annonce le cynisme de Trump est derrière tout cela. Il n’obéit qu’aux intérêts de sa caste de prédateurs économiques cupides et déclare, dans son langage inculte propre à ces milieux : « la vérité, c’est ce que moi je décide ». Le procureur reconnait l’innocence de Swagger parce qu’il n’y avait pas de percuteur dans le fusil retrouvé (en bon spécialiste, il le changeait toujours après avoir tiré) et qu’il n’a pas pu être l’arme du crime. Le colonel s’en sort devant la justice et le sénateur aussi – mais le procureur dit que, si la loi l’empêche d’agir, il faudrait pour faire justice en revenir aux pratiques du Far-ouest. Ce propos tombe dans une oreille préparée et Swagger, une fois libéré, fera ce qu’il faut dans un opéra à la Rambo.
Le patriotisme comme opium du peuple est une originalité du film. Malgré son canevas peu vraisemblable (l’assassinat simulé du président pour atteindre la vraie cible) et la stupidité du sergent (« il suffit d’appuyer sur un bouton et je marche »), l’action est bien menée et tient en haleine jusqu’au bout. Avec pour conclusion cet aspect de la mentalité américaine post-11-Septembre : chacun pour soi. Retour à la mentalité « western », la justice n’est que paravent bridé par les lois faites par les politiciens pour protéger les politiciens (et leurs financeurs). A chacun de régler ses problèmes comme au temps du Far-ouest ; par le flingue.
DVD Shooter tireur d’élite, Antoine Fuqua, 2007, avec Mark Wahlberg, Michael, Danny Glover, Kate Mara, Ned Beatty, Paramount Pictures 2007, 2h01, standard €9.99 blu-ray €10.99

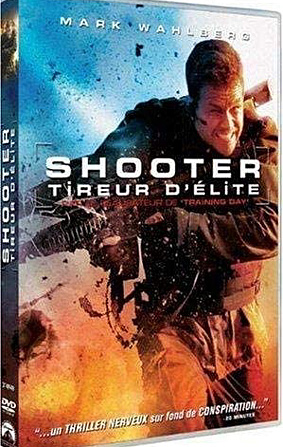



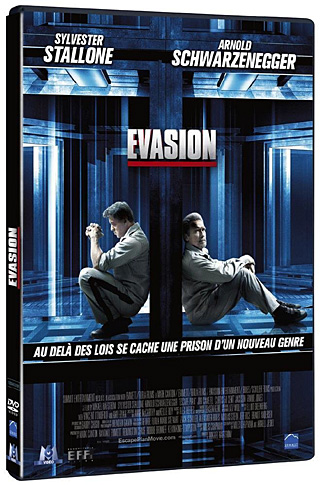






Commentaires récents