
Un jeune homme qui n’a plus de famille, William Blake (Johnny Depp), part de Cleveland au sud du lac Érié pour aller au bout du chemin de fer de l’Ouest, symbole du rêve américain. Il se rend à la station terminus de Machine, ou une aciérie lui a envoyé une lettre d’embauche comme comptable. Les paysages se font de plus en plus arides, rocheux, morts, et des carcasses d’animaux et des crânes humains parsèment les environs de la voie. Des trappeurs fous tirent même du train sur des bisons qui passent, signe que le convoi quitte toute civilisation. Le train de l’Ouest remonte le temps, de la civilisation industrielle et cultivée à la sauvagerie des coureurs des bois où l’homme est un loup pour l’homme.


Le temps de régler ses affaires et de faire le voyage en train, deux mois ont passé. Ce pourquoi, lorsqu’il se présente, tout le monde s’esclaffe. Il insiste pour voir le patron, Mister Dickinson (Robert Mitchum), mais celui-ci le renvoie, impérieux et hautain. Dès lors, Blake est perdu dans cet Ouest sans règles, où un cow-boy se fait sucer dans la rue, pistolet à la main contre qui y verrait offense. Rejeté par la société normale, le jeune homme fait la connaissance d’une fille facile poussée dans la boue hors du saloon par un nomme éméché. Il la reconduit chez elle et elle couche avec lui. C’est à ce moment que surgit son ancien amant, qui regrette de s’être disputé avec elle et de l’avoir quittée. Elle lui dit qu’au fond elle ne l’a jamais aimé, ce pourquoi il sort un pistolet et tire, blessant William Blake mais surtout tuant la donzelle. Effrayé, réagissant par réflexe devant la mort en face, le jeune homme saisit le pistolet sous l’oreiller et riposte, ratant deux fois sa cible faute d’avoir ses lunettes sur le nez, avant de percer par chance son adversaire en plein cœur. Lui qui n’avait jamais touché une arme, il a tué pour la première fois.


Il s’enfuit très vite par la fenêtre à demi-habillé, vole le cheval pinto du fiancé, et s’enfonce dans le veld. Évanoui, il est réveillé par un Indien solitaire qui tente d’extraire la balle fichée dans son épaule gauche. Il lui apprend qu’il est métis de deux tribus différentes, donc d’aucune, ce pourquoi il s’appelle Personne (Nobody) ou ‘parle fort pour ne rien dire’ (Gary Farmer). Il a été enlevé enfant par des hommes blancs qui lui ont fait traverser l’Atlantique pour l’exhiber en Angleterre et en Europe, où il a eu l’astuce d’imiter les Blancs et de s’instruire. Adulte, il a retraversé la mer pour revenir chez lui. Les deux solitaires lient une certaine amitié, l’Indien initiant le Blanc à la vie sauvage et aux relations brutales de l’Ouest. Il le prend pour le peintre poète anglais pré-romantique qu’il a lu en Europe (1757-1827), citant même un poème : « Certains naissent pour le délice exquis, certains pour la nuit infinie » (Auguries of Innocence).


Pendant ce temps, le vieux Dickinson a mandaté trois tueurs chasseurs de primes pour se venger de celui qui a tué son fils et sa fiancée. Cole Wilson (Lance Henriksen), Conway Twill (Michael Wincott) et Johnny « The Kid » Pickett (Eugene Byrd) ont chacun une réputation redoutable, Cole ayant « baisé et tué ses parents – oui, les deux – avant de les faire cuire et de les manger » (dixit Conway), Conway ayant prouvé son professionnalisme de tueur à gage, tandis que l’adolescent noir Pickett « compte plus de tués à son actif qu’il n’a encore d’années » (dixit Dickinson). Mais les trois paraissent assez peu sûrs au vieux pour qu’il offre en plus une prime publique par affichage ; il veut (wanted) William Blake « dead or alive », mort ou vif. L’humour montre la prime qui augmente à mesure des morts, passant de 500 à 2000 $.


Tous les tués par balles vont dès lors être attribués à William Blake. Le jeune blanc-bec qui n’avait jamais touché un revolver jusqu’à sa rencontre avec Dickinson, a désormais la réputation d’un tueur sans pitié. Le film montre tout son humour noir, caricaturant l’Ouest mythique avec ses chasseurs de primes, ses affiches de recherche, les balles qui partent le plus souvent par accident, ou les gens qui s’entre-tuent en avant même d’avoir Blake au bout de leur fusil. Ce sont deux Marshall qui observent les traces plutôt que d’observer l’homme qui vient vers eux, les trois tueurs professionnels qui se mettent une balle dans la peau professionnellement par derrière, le dernier mangeant l’avant-dernier, selon sa réputation dans l’Ouest, ou trois homos qui veulent se farcir un « Philistin » comme il est soi-disant autorisé dans l’Ancien Testament, dont Iggy Pop déguisé en gouvernante. Il est vrai que la jeunesse imberbe et les longs cheveux de William Blake lui donnent un air féminin qui excite la sexualité des bravaches de l’Ouest réduits aux putes des saloons, lorsqu’ils sont en fonds, ce qui n’arrive pas souvent. Cole, le plus méchant des tueurs pro engagé par le patron de l’aciérie de Machine, va même jusqu’à singer le coït en détachant les syllabes de son nom : dick-in-son, autrement dit en anglais ‘bite en fils’, ou acte pédocriminel. C’est assez cocasse. L’Ouest révèle son lot de tarés, d’hallucinés, de psychopathes, bien loin de l’image d’Épinal qu’Hollywood en a faite.


L’errance se poursuit, comme un voyage sans retour, un chemin vers la mort. Car William Blake, pris pour le poète anglais par l’Indien faux savant qui l’accompagne, est un mort en sursis, a Dead Man. En prenant une autre balle dans l’épaule gauche, par derrière suivant le fameux courage de l’Ouest, il descend son adversaire à 30 m d’un seul coup de Winchester. Il a pris l’habitude. Son ami indien le hissera dans un canot qui descendre la rivière jusqu’au village de la tribu ou une cérémonie lui sera assurée, un enterrement à la viking. Le corps encore vivant mais pour peu de temps sera placé dans un canoë sur des branches de cèdre, poussé vers le large et la fin de toutes choses. Mais pas sans avoir encore tué deux fois sans toucher un fusil, Cole ayant enfin rattrapé les fuyards et tirant dans sa direction, tandis que l’Indien le descend et que lui riposte dans le même temps, ce qui fait deux morts de plus ajoutés à la réputation dans l’ouest du hors-la-loi William Blake.


Les riffs de guitare électrique de Neil Young font beaucoup pour l’atmosphère du film durant l’errance, cette lente élévation des esprits vers l’infini et l’éternité, l’accomplissement du destin de chacun. Un acteur envoûtant, une histoire étrange et l’ironie du sort, font de ce long film (plus de deux heures) un périple dans l’Ouest mythique en noir et blanc.
DVD Dead Man, Jim Jarmusch, 1995, avec Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen, Michael Wincott, Robert Mitchum, BAC films 2008, 2h14, €11,90
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)












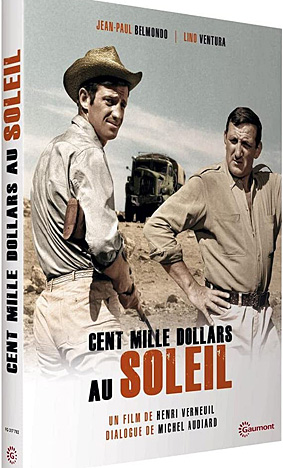



































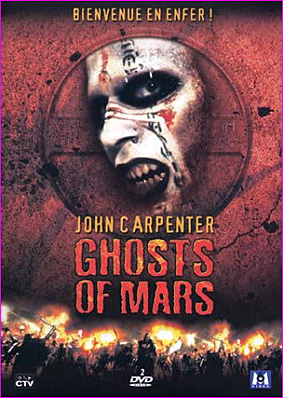





















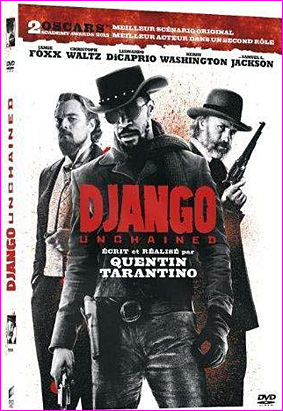


























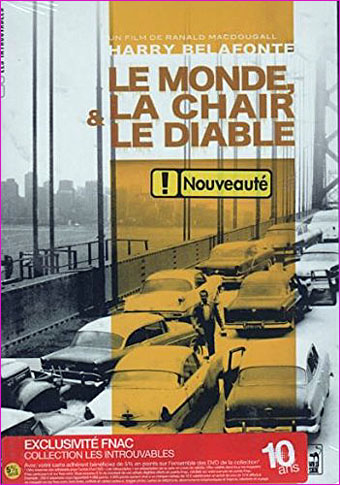






















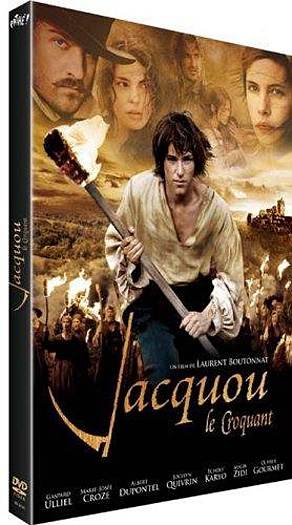









Commentaires récents