Une histoire d’amour d’un cinéaste pour le cinéma yankee qui ne chavirera que les fans. Car l’histoire est inexistante, un vague fil sur la fin menant à une distopie – une bifurcation de la réalité historique. C’est long (2h35 !) et ennuyeux jusqu’au premier tiers, amusant par le jeu d’acteur de Brad Pitt (bien meilleur à 52 ans que Leonardo di Caprio, déjà décati à 44 ans). Le film ne mobilise l’attention que lorsqu’il y a de l’action, c’est-à-dire seulement vers son milieu. Il n’y a auparavant qu’une célébration du vieux cinéma des bons contre les méchants, une dérision de Bruce Lee (Mike Moo) et de Sharon Tate (Margot Robbie), le premier couinant avant de faire des mouvements d’art martiaux pas très efficaces, la seconde souriant niaisement à se voir sur écran, les pieds (sales) sur le dos du fauteuil. Heureusement, la bande son pop et rock des sixties évite l’ennui.
Rick Dalton (Leonardo di Caprio) est un acteur de séries western des années cinquante, Le Chasseur de primes et Lancer, puis FBI des années soixante, Sur la piste du crime. Il fonctionne en duo depuis neuf ans avec son cascadeur attitré, dont on dit qu’il lui ressemble assez, Cliff Booth (Brad Pitt). Ce dernier fait la part la plus rude du boulot et le premier en retire la gloire et le fric. Mais cela convient au tempérament un brin rentre dedans de Cliff qui, dit-on, aurait tué sa femme, une pétasse agaçante entrevue en une scène sur la mer. Cliff vit sur la bête Rick, conduit la Cadillac DeVille 1966, répare la villa de Cielo Drive sur les hauteurs de Los Angeles, voisine de celle du couple Roman Polanski et Sharon Tate. Ces derniers deviennent peu à peu célèbres tandis que Rick décline.
Nous sommes en 1969 et le cinéma s’industrialise tandis que l’âge d’or de la télé est passé. Le mouvement hippie, né contre la guerre au Vietnam, bat son plein. Les filles du Flower Power sont jeunes, fraîches, habillées au minimum mais sales. Elles affectionnent de marcher pieds nus ou en sandales, manière gourou de sentir la terre par leur corps ; elles baisent dès le plus jeune âge avec la bite qui leur plaît et vivent en bandes matriarcales, usant des mecs comme de gardiens et de sex-toys. Elles préfigurent le féminisme, nonobstant leur ignorance crasse et leur anarchie où seuls leurs désirs sont des ordres.
Dans le film de Tarentino, un certain Charles Manson a vu tout le parti qu’il pouvait tirer de ce genre de harem et il squatte un ancien ranch qui a servi à tourner les feuilletons western des années cinquante. Cliff, qui prend en stop dans la Cadillac crème Pussycat (Margaret Qualley, 24 ans au tournage), une fille de moins de 16 ans à demi nue et aux pieds sales. Le jeune animal lui propose une fellation que, contrairement à Polanski adepte des jeunes filles de 13 ans, il refusera. Il va jusqu’au ranch Spahn pour et elle le présente aux femmes. Il veut revoir George (Bruce Dern), avec qui il a tourné huit ans auparavant mais celui-ci est vieux, aveugle et jalousement gardé sous clé par la horde femelle qui l’exploite en squattant les lieux et le paye en chevauchées sexuelles torrides qui le laissent à plat. Ce qui est amusant est que tout ce petit monde de tarés camés de la Manson family est accro au petit écran bleu de la télé noir et blanc. Il se gave de meurtres, de crapules et de justiciers de l’Ouest, ce qui ne va pas sans endommager les cervelles amoindries à l’acide. Une clope trempée dans le LSD ne vaut que 50 cts, un demi dollar de 1969, autrement dit quasiment rien.
C’est l’arrivée de Cliff dans le squat, son insistance à voir George, sa conviction que tout ne tourne pas rond et son altercation avec un torse nu idiot (James Landry Hébert) qui lui crève un pneu qui va déclencher la machine. Cliff rosse le bête et méchant et l’oblige à changer la roue devant les yeux de la horde femelle qui caquette peace and love. Mais il s’attire la haine de ces paranoïaques abrutis par la drogue et qui se montent la tête entre eux. Charles Manson le gourou a décrété qu’Hollywood devait payer. Les studios n’ont pas reconnu sa musique, ne l’ont pas embauché, il veut se venger. Il jette alors trois de la horde, Tex, Patricia et Susan, sur la villa de celui qui l’a évincé, Terry Meicher, occupée désormais par Polanski et Tate. Mais la présence de Cliff dans la villa d’à côté, qui vient d’enterrer la vie de garçon de Rick avec force cocktails et LSD, les détourne de leur projet initial…
Au fond, seul le cascadeur est réel dans le métier du cinéma, car il doit se colleter avec la réalité des scènes. Les acteurs ne sont que jeux de rôle, répétés à satiété, se gonflant devant le miroir pour se faire méchant ou glamour. Les actrices ne sont que des icônes dont le cul masque le godiche des scènes. Jeu de miroir, images démultipliées sur écran, affiche, télé, bus, le métier d’acteur rend schizophrène – sauf le cascadeur. Rien d’étonnant à ce que la famille Manson se soit reconnue en négatif dans ce virtuel hollywoodien.
DVD Once upon a time in Hollywood, Quentin Tarantino, 2019, avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Julia Butters, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, Sony Pictures 2019, 2h35, standard €19.99 blu-ray €27.09

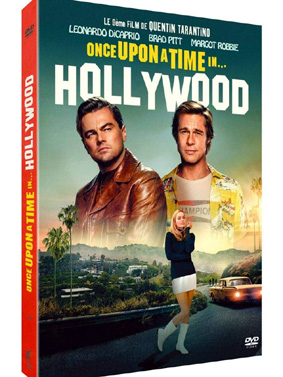





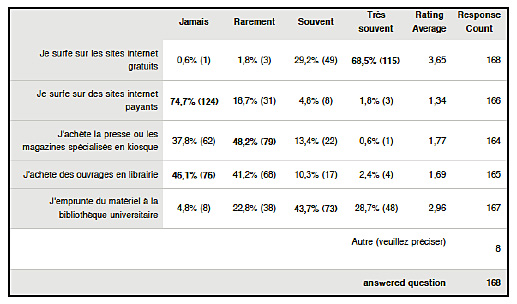
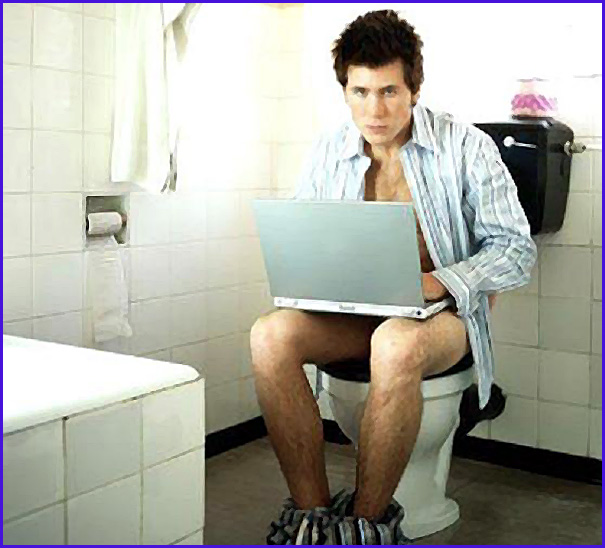

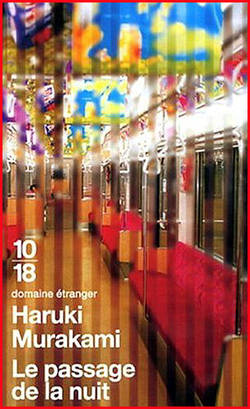

Commentaires récents