Depuis que l’Etat-papa autorise ses enfants à sortir de la maison et, pour les plus grands, à aller vaguer au-delà de 100 km autour du domicile, un air de vacances a saisi les Français. Ce n’est pas encore l’étranger, mais presque : les frontières européennes sont plus ou moins ouvertes (avec quatorzaine pour entrer dans certains pays), pas encore le grand large.
C’est le moment de se replonger dans le passé pour voir comment les voyages ont été vécus. Pour cela, la collection familiale de cartes postales est un trésor inépuisable. Certaines datent de la fin du XIXe siècle déjà ! Mais oui, on écrivait en ce temps-là et la Poste fonctionnait.
C’était la grande époque du chemin de fer, pas très brillant ni confortable, pas vraiment rapide malgré les noms qui le laissaient espérer : « express », « rapide », « direct » … En réalité, ils s’arrêtaient moins mais n’allaient pas plus vite. En 1939, un oncle de mon père notait même qu’il pleuvait dans les wagons et que l’averse avait fait ralentir le train Paris-Lille à 30 km/h ! La culture de l’excuse SNCF ne date pas d’aujourd’hui. Je reste toujours étonné que le Canada, la Suède ou la Russie fassent rouler des trains par -30° centigrades alors que notre franchouille ferroviaire connait immédiatement des « retards » et des « encombrements » par -5°. « On ne l’avait pas prévu ! » Ah bon ? Pareil pour la chaleur, les trains roulent en Espagne par +45° mais pas en France où le fer a le rail qui s’dilate, la caténaire en galère et le chauffeur en touffeur. Je m’en foutisme ou fonctionnariat syndical adepte du perpétuel petit travail tranquille ?
Les vues envoyées, en sépia ou en noir et blanc sur cartoline assez forte, montraient presque exclusivement la France (quelquefois le nord de l’Italie), et principalement des villes de garnison (pour les jeunes envoyés au « service »), des villes d’eau (pour les bourgeoises adeptes de la « cure »), ou les provinces traditionnelles des vacances à l’hôtel : Normandie (car pas trop loin de Paris), Bretagne (plus exotique et surtout vivifiante), la Provence (pour le soleil, malgré l’ail et l’assent). Un déjeuner tout compris (service et boissons) revenait à 353 francs 1953, soit 3.53 francs 1958, soit 8.02 euros compte-tenu de l’inflation. Aujourd’hui, avec les taxes et charges sociales, en France t’as plus rien.
L’évolution des textes avec les années est révélatrice. Au début du précédent siècle, on parle surtout nourriture puis, après-guerre (la Première), climat : il fait beau, il pleut, il y a du vent – donc de la chance ou pas de chance. Sautons une guerre (la Deuxième) et surgissent le grand air, l’air pur, le calme ; le scoutisme est passé par là, et les maquis de la Résistance. Les gens sont plus nature, dégagés des soucis matériels (Sécurité sociale, emploi de reconstruction des Trente glorieuses, première automobile) et lassés de la ville ou de la villa banlieue.
Les années 1970 élargissent l’horizon. Les cartes sont de plus en plus envoyées de l’étranger comme si l’on avait presque honte de passer ses vacances en France (comme les vieux). Sauf les familles avec enfants petits qui adorent la plage comme on adore la Vierge Marie chez les cathos, quoiqu’avec la pointe de sensualité supplémentaire d’aller en habit de peau un mois durant. Les commentaires sont sur le bain, le garçon qui nage comme un poisson et ne porte jamais de vêtement, les copains de la plage qui font pareil « même sous la pluie ! », la fille qui ne veut pas porter de haut de bain à 12 ans comme les garçons ou qui s’obstine à faire de la balançoire sans avoir mis de culotte sous sa robe courte à cause de la chaleur, « vous vous rendez compte ! ». Mais c’est l’Espagne qui a la cote, pas trop loin, pas chère, avec des plages immenses et un exotisme quasi arabe dans le grand sud. L’Italie remporte les suffrages des adultes qui se cultivent en visitant Venise, Florence, Rome, Naples et Pompéi. La Grèce fait son apparition avant L’Egypte puis la Turquie.
Le Royaume-Uni est la destination des ados en séjour linguistique ; ils se disent en général contents (mais la bouffe et la conduite à gauche en vélo les désorientent). Ils sont aussi surpris que les Anglais fassent souvent coucher les garçons dans le même lit. La même carte précise que le mois d’août est très chaud et, surprise ! qu’il ne pleut pas tout le temps.
Je retrouve sur les cartes postales des anecdotes familiales très anciennes, datant des grands-parents, lorsqu’ils étaient jeunes et pas encore mariés et se traitaient de « mon chéri » en 1911. Durant la guerre de 14, ils montraient le souci de savoir qui de connu au village avait été blessé ou si l’on avait bien reçu le colis. Beaucoup de soldats ou de jeunes partis en ville annoncent leur venue par carte postale vite écrite bien longtemps à l’avance car, avec les trains, même une fois la guerre finie, on ne sait jamais.
Au début des années 1950, c’est le temps des stages pour les parents – loin des maisons familiales. Caen est en ruines et des bâtiments neufs surgissent de terre, comme à Brest ou au Havre. Cela fait « moderne » et nouveau monde… avant de devenir triste et entassé. Les fins de semaine (du samedi après-midi au dimanche soir) sont l’occasion de visiter les alentours et d’aller « manger une omelette de la mère Poulard » au Mont Saint-Michel ! Le voyage de noces se fait en car, moins cher et plus souple que le train, pour aller visiter la grande bleue en passant par toutes les villes intéressantes : Limoges, le barrage du Castillon, les gorges du Verdon, Avignon, Aix, Nîmes, Cannes, Menton – et même une incursion d’une journée à Gênes (sans passeport), quelle audace !
On apprend que le père n’avait jamais pris le bateau avant d’aller de Marseille à l’île d’Aix, ni ne savait nager avant de s’être plongé en Méditerranée. On apprend que la mère a voyagé seule en Algérie (alors département français) et qu’elle a pris l’avion, un Dakota Douglas DC3 non pressurisé de Marseille à Alger qui volait à 2300 m d’altitude ; qu’elle a vécu en camp de toiles puis en auberge de jeunesse avant d’aller visiter en car Philippeville où les femmes « arabes » étaient rares dans les rues – et voilées. On apprend que le jeune oncle à l’époque enchaînait les colos pour se faire de l’argent de poche durant les vacances tandis que l’autre, officier du génie, détournait les mineurs (en bouchant une entrée de mine mal stabilisée). Que les grands-pères emmenaient les grands-mères systématiquement en vacances dans la maison familiale de leurs propres père et grand-père, « retapée » en vue de la retraite. Dans leur nouvelle 4CV Renault dont le moteur faisait bzzt ! bzzt ! comme une abeille, ou en Dyna Panhard, véhicule que j’ai toujours trouvé fort laid avec un bruit de casserole. Curieusement, j’ai toujours eu le mal de la route en Panhard, rarement dans les autres véhicules.
Dans les années 2000, la famille décrit la pousse des petits, offre des nouvelles des vieux, s’informe des jeunes qui étudient ou commencent à travailler, dit qui envisage de se marier. Les liens se distendent, la correspondance fait moins recette que le téléphone, en attendant l’Internet. Le virtuel ne laisse que peu de traces, rares sont ceux qui enregistrent leurs communications Skype ou autres. L’aujourd’hui se méfie même des réseaux sociaux et ne dit plus rien d’intime ni de compromettant, ne publie plus de photos qui soient interprétables (par une ex, un patron, un juge, un ennemi). La Poste devient aussi en retard et peu fiable que le train, toujours par ce même je m’en foutisme de « service » public (qui « sert » surtout à être payé, être garanti d’emploi et de retraite). D’où l’invention de la « lettre suivie » pour ne pas qu’elle se perde ! Avec un tarif plus cher, comme de bien entendu.
L’envoi des cartes postales se raréfie depuis des années. Avec la télé et le net, à quoi cela sert-il de montrer des vues du pays ou du monde ? Avec le téléphone mobile et les courriels, à quoi cela sert-il de correspondre par carte ou lettre ? L’écrit se perd et la parole est d’or, mais surtout l’écrit reste et la parole s’envole. En notre époque de zapping et en notre pays de particulière méfiance envers les autres, mieux vaut écrire le moins possible et en dire peu.





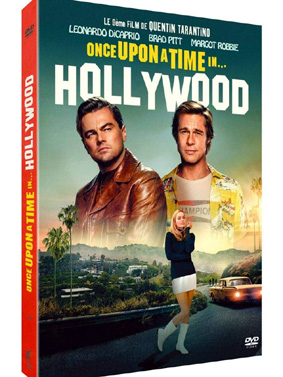




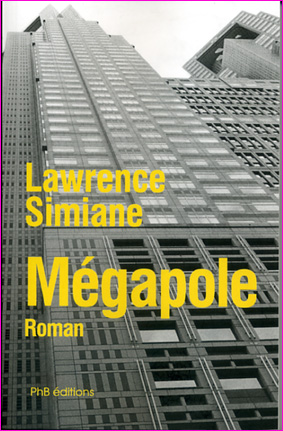

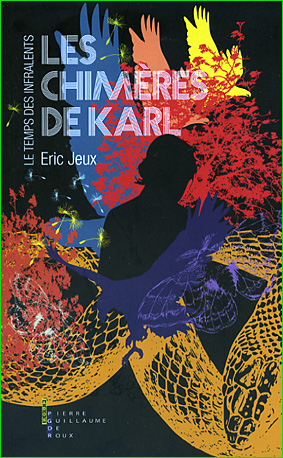
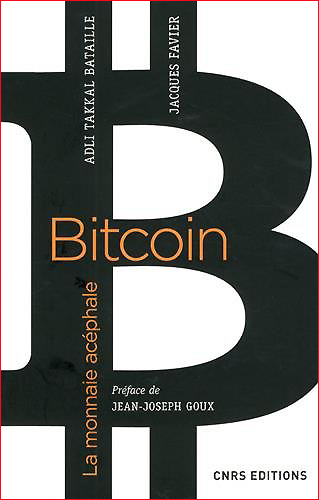

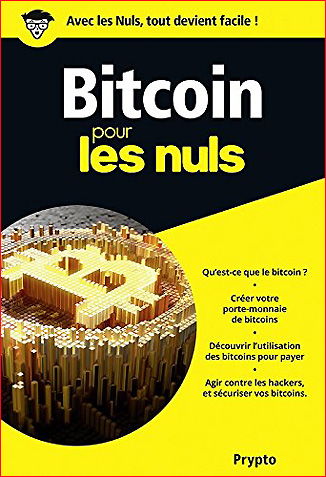

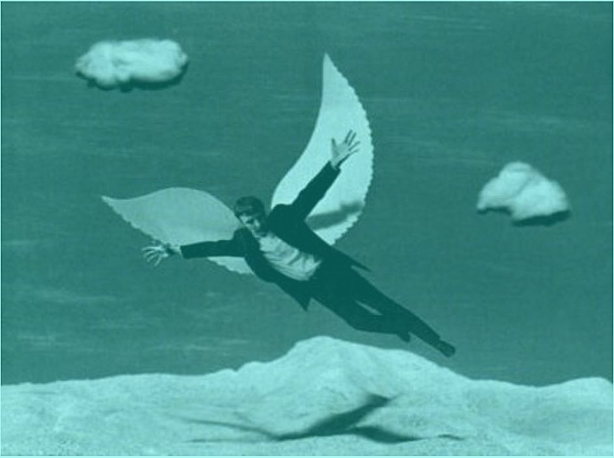
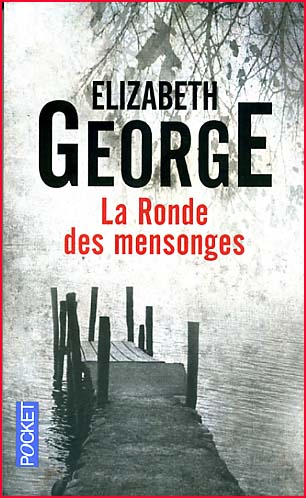










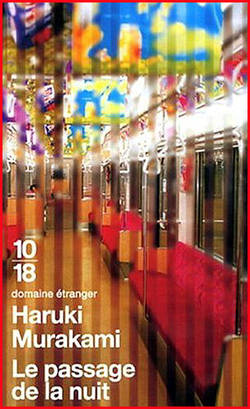

Commentaires récents