Ce livre très récent fait le point sur la bourse et sa place dans l’épargne des particuliers – donc des professionnels qui gèrent pour eux. Il se lit bien, présenté assez logiquement mais, malgré ses qualités, présente un défaut majeur et trois mineurs. On aimerait qu’il soit encore meilleur, ce pourquoi les quelques faiblesses sautent aux yeux.
Le défaut majeur est d’être publié au mauvais moment, dans une période où rares sont les particuliers à s’intéresser encore vraiment à la bourse, perçue comme un « casino » où les requins sans scrupules s’en mettent plein des poches sur le dos des entreprises comme des épargnants, tandis que « les autorités » ne voient rien, ne font rien et se contentent (des mois ou des années après) d’un appel à la morale.
Les défauts mineurs sont d’une part son titre mal choisi, dans la mode « identitaire » qui n’a pas grand sens pour une entité telle que « le » marché, mais aussi de ne jamais prendre clairement position avec un ton porté à la synthèse, enfin de ne pas dégager véritablement les « conseils » donnés aux particuliers.
Le trading à haute fréquence, plus ou moins défendu par l’auteur, améliorerait selon certains la liquidité du marché mais la submergerait de faux mouvements pour d’autres. A mon avis, cette façon de contourner la concurrence de marché par une série de micro-monopoles techniques (algorithmes automatiques, serveur local gagnant de la microseconde à se trouver plus proche du serveur central, afflux d’ordres pour faire monter les cours et affoler les indicateurs puis aussitôt les « annuler »), devrait purement et simplement être interdite. L’ampleur des volumes et les feintes de traders sont une mise en danger systémique de tout « le marché » financier.
Malgré cela, ce livre est rare en français, émis par un praticien de la finance sur une trentaine d’années, surtout comme vendeur actions puis analyste. Il se situe dans la suite des ouvrages de Paul Gagey, Didier Saint-Georges, Alain Sueur et Edouard Tétreau, pour citer les plus significatifs. L’auteur a le mérite de faire état des études américaines sur le sujet, bien plus nombreuses qu’en Europe, car il existe un vrai engouement pour « le marché » aux Etats-Unis, bourse toujours leader de la planète.
L’investisseur avisé, qu’il soit particulier ou même professionnel, lira donc Philippe Gallot avec profit. Le livre est en trois parties, la première sur les rumeurs et les informations, la seconde sur l’efficience attribuée au marché boursier, les exceptions et les conseils (la meilleure, à mon avis) et la dernière sur les acteurs, les malversations et la non-transparence.
Bien-sûr, il y a abus d’adverbes et des phrases parfois alambiquées, une erreur sur les Exchange Traded Funds (ETF) qui ne sont pas « Electroniques » (p.171) et Gustave Le Bon qui s’écrit en deux mots. Il y a aussi le dédain pour l’analyse technique ou graphique, sans expliquer vraiment pourquoi (sinon que l’auteur a été longtemps analyste, donc opposé à toute vue directe des mouvements). S’il évoque la finance comportementale avec profit, il manque d’exemples pris dans la pratique de gestion boursière et ne donne de conseils que généraux pour éviter ces erreurs humaines. Sur le trading et ses risques, il ne cite pas Jérôme Kerviel, pourtant LE cas français, ce qui est curieux pour un ouvrage destiné à un lecteur français.
Il est cependant très vivant lorsqu’il fait état de sa propre expérience, ce qu’il aurait dû mieux développer et imager. Ce livre apparaît plus comme un essai que comme un manuel pratique mais expose de façon utile la manière de fonctionner des « marchés », c’est-à-dire des acteurs qui le composent, chacun dans sa propre fonction. Le lecteur aura une compréhension large de ce qui se passe et pourra donc, avec ce recul, gérer au mieux sur le long terme, ses avoirs en actions, obligations ou monétaire.
Je ne crois pas, à la différence de l’auteur, au « moyen » terme, car les techniques automatiques de passations d’ordres en masse biaisent le moment : entre le trading au jour le jour (pour jouer les écarts) et la gestion à long terme (type assureur ou Warren Buffet), il n’y a plus rien. Comment un particulier ou un professionnel classique pourraient-ils « se battre » avec les algorithmes automatiques et faire triompher le bon sens là où n’existe que la curée du plus rapide et du plus fort ?
Philippe Gallot aime à citer les adages boursiers issus de la longue tradition anglaise d’abord, puis américaine ensuite. Il est cependant un adage qu’il ne cite pas : « Sell in May and go away – but buy back on Derby Day”, vendez en mai et quittez la bourse, mais rachetez dès le jour du Derby passé (premier dimanche de juin). L’observation – graphique, n’en déplaise à l’auteur – de cette année 2018 montre qu’effectivement, il était judicieux de de délester autour du 15 mai pour racheter dès le 1er juin, comme quoi les adages ont un fond de sagesse. L’explication en est probablement la publication des résultats à venir après la clôture du 30 juin, anticipés par le marché. Or, toute anticipation étant un risque, la prudence prévaut. Le premier trimestre est traditionnellement meilleur que les autres, avec les ventes de Noël et les perspectives de l’année entière ; le second trimestre suscite des doutes, donc du retrait de la part des investisseurs – même automatiques, car les modèles amplifient tous les mouvements moutonniers.
Au total un livre utile aux boursicoteurs (pour qu’ils prennent conscience de l’inanité de se battre contre les machines) et au épargnants long terme (qui verront pourquoi le bon sens et les grandes tendances emportent tout sur la durée).
Philippe Gallot, L’identité des marchés financiers – Conseils aux épargnants avisés, mars 2017, L’Harmattan, 276 pages, €29 e-book Kindle, €22.99





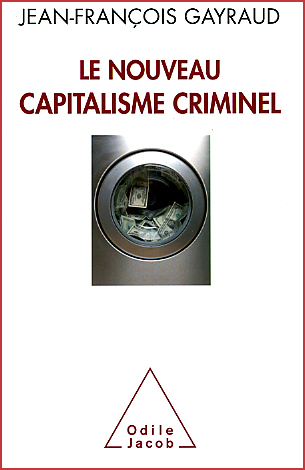











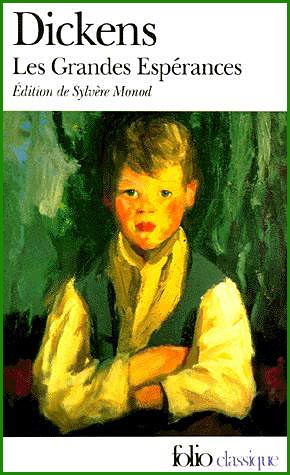


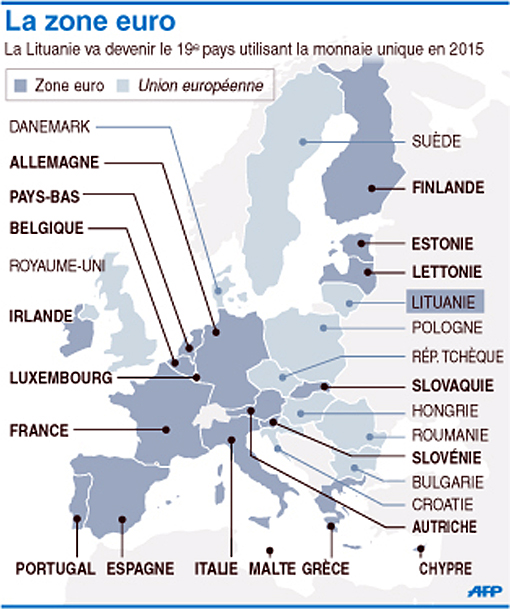
Commentaires récents