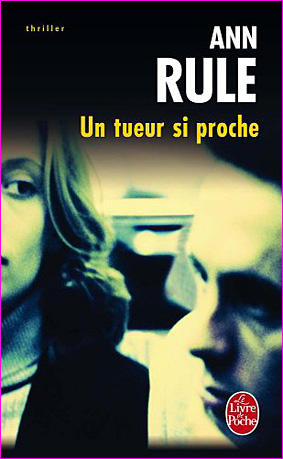
L’auteur, journaliste proche des milieux d’enquête de la police pour avoir appartenu à leurs rangs avant de mettre au monde quatre enfants, retrace la macabre épopée du premier tueur en série américain identifié comme tel, dans ces années 1970 d’une naïveté confondante. Tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil… et l’auto-stop la règle. Ann Rule a connu personnellement Ted Bundy à Seattle en 1971, alors qu’elle faisait du bénévolat sur une ligne d’assistance téléphonique pour personnes suicidaires. Ted était l’un de ses coéquipiers deux soirs par semaine et ils sont devenus amis.
Elle l’a donc suivi jusqu’à la chaise électrique, en 1989, marquant enfin la terme de ses meurtres prémédités de jeunes filles et de ses évasions rocambolesques. Ted Bundy était intelligent, un QI de 124 à l’université. Il a fait des études de droit et de psychologie, sans toujours finaliser ses diplômes. Il a participé à la campagne électorale du gouverneur républicain Evans pour sa réélection puis est devenu assistant de Ross Davis, le président du Parti Républicain de l’État de Washington. Il aurait pu devenir avocat et faire une belle carrière en politique, étant d’une intelligence aiguë, avec un sens de l’écoute, un conservatisme affirmé et une agressivité de squale. Il n’en a rien été.
Ted Bundy a été rattrapé par ses démons. Le premier est d’avoir été abandonné trois mois par sa mère à sa naissance, bâtard d’une fille réprouvée qui « avait couché ». On soupçonne aujourd’hui que c’était avec son propre père bien qu’elle ait désigné tout d’abord un soldat de l’Air force ou un marin comme géniteur envolé : elle n’a jamais vraiment su. Comme fils de pute – il n’y a pas d’autre nom pour les coucheries de sa mère – le gamin s’attache à son (grand?) père mais en est séparé à l’âge de 4 ans. Il l’adorait mais les faits révèlent que ce père de sa mère était violent, emporté, macho, raciste et un brin psychopathe. Les gènes ne mentent pas… Il en a gardé une fixation morbide sur « les femmes », leur reprochant leur sexualité irrépressible et leur exhibition sur les photos des magazines. Tout petit déjà, il avait découvert des revues porno chez son (grand) père et prenait plaisir à les regarder.
Il est probable qu’il ait tué sa première victime à l’âge de 15 ans, une fillette de 9 ans jamais retrouvée. Sa première victime « officielle » est à l’âge de 20 ans et son corps n’a jamais été retrouvé. Bundy aimait en effet déshabiller les filles une fois assommées à coups de barre de fer ou de bûche, puis étranglées avec un bas nylon, les mordre à pleines dents sur les fesses et les seins, les violer par le vagin et l’anus, leur enfoncer des objets loin dans les orifices, puis en séparer la tête pour la collectionner sur un lieu qu’il aimait bien dans les montagnes. En bref un vrai psychopathe qui voulait se venger de « la » femme, sa mère dont il n’a jamais été aimé tout petit.
L’auteur liste ses victimes reconnues, celles probables, plus celles possibles. Il y en a 36 vraisemblables (plus une survivante), avouées ou non, et une centaine possibles de 1962 à 1978. Toutes des filles – aucun garçon – et jeunes, de 9 à 26 ans. Les filles avaient en général les cheveux bruns, longs et séparés par une raie centrale. Les attirer n’était pas difficile, Ted Bundy étant beau mec, se présentait souvent comme handicapé, un bras en écharpe ou une jambe dans le plâtre, portant une sacoche ou une pile de livres. Il demandait gentiment assistance pour les mettre dans le coffre de sa Volkswagen Coccinelle, la voiture fétiche des jeunes Yankees post-68. Il les assommait alors d’un coup de barre de fer avant de les hisser dans son auto dans laquelle il avait ôté le siège passager avant (une fonction que seules les Coccinelles offraient), puis allait « jouer » avec elles plus loin sur la route.
Il entrait alors en état second, devenant une sorte de berserk, un fou sanguinaire sans aucune limites mentales. Le jeune homme affable, gentil et bien sous tous rapports devenait alors autre, un monstre démoniaque agi par ses pulsions primaires.
Ann Rule, qui l’a personnellement connu puis l’a suivi par lettres, appels téléphoniques et suivant les progrès des enquêtes dispersées dans plusieurs états (la plaie du système judiciaire américain), en fait un livre de journaliste, purement factuel et d’un style plat qu’affectionnent particulièrement les boomers. Un style de mille mots, pas plus, accessible aux primaires, selon les canons du journalisme papier d’époque. Un style à la Annie Ernaux qui « se lit bien » mais sans personnalité, qui pourrait être écrit par un robot. D’ailleurs le journalisme aux États-Unis se meurt pour cette raison et les gens sont remplacés de plus en plus par des machines et des algorithmes.
Si les tueurs en série vous passionnent, si le sort de Ted Bundy vous intéresse, si vous aimez lire sans penser ni vous préoccuper du style, ce genre de « roman policier » qui n’en est pas un est fait pour vous. Il dit la réalité d’un tueur mais n’entre jamais dans les profondeurs qui fâchent.
Ann Rule, Un tueur si proche, 2000, Livre de poche 2004, 544 pages, €2,77, e-book Kindle €6,99

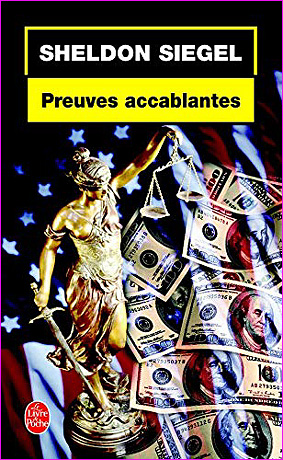
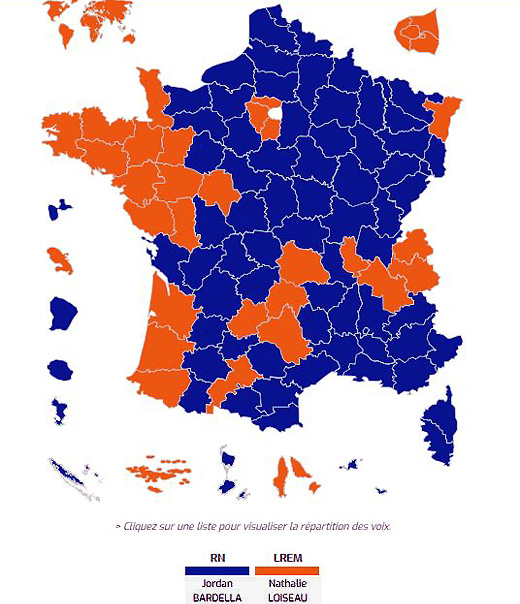


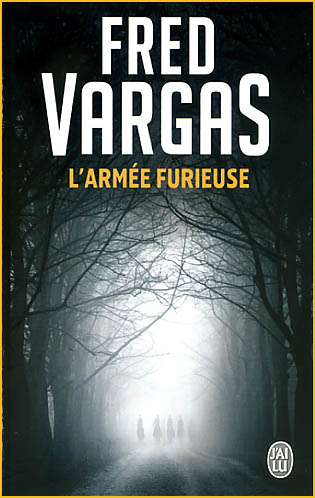
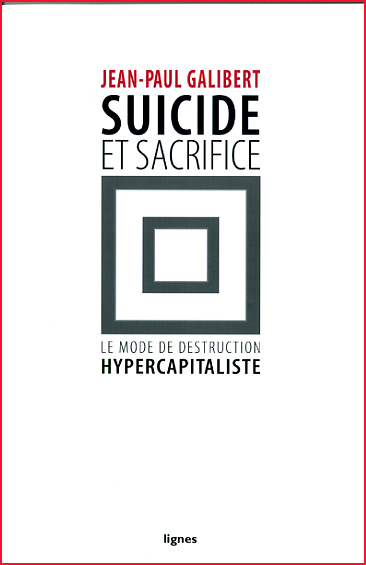

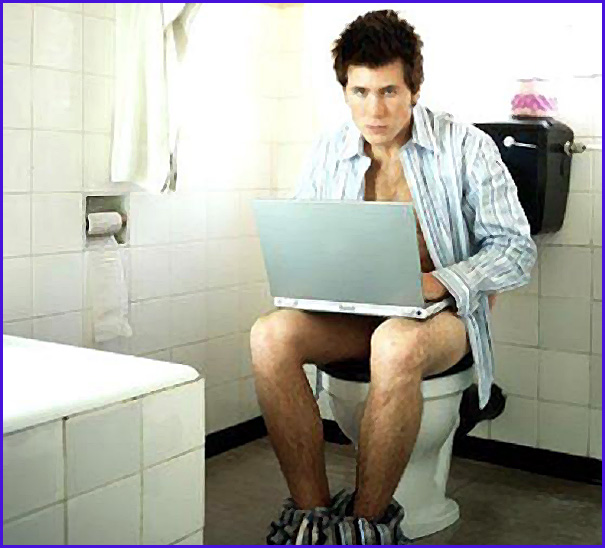


Commentaires récents