Sous la contrainte de l’Occupation émerge la liberté d’un homme profondément français, appartenant viscéralement à cette culture particulière vouée à l’universel. Le Normalien professeur de littérature en khâgne à Louis-le-Grand, note au jour le jour ses réflexions, ce qu’il vit, et le fil des jours tisse la toile d’un tempérament. Cela donne un hymne au vieux fond de pensée de notre pays, aux dangers de notre société telle qu’elle est, aux trahisons de certains de ses fils et filles à l’époque. La leçon est belle car, écrite dans l’urgence, elle accède à l’éternel : celui d’une originalité culturelle, celle de la France.
La défaite est une catastrophe, elle appelle la remise en cause de soi, de la société, de la culture même, pour refonder les valeurs et préparer l’avenir. Pour se réformer soi-même, rien de tel que de remonter aux sources de sa vie profonde, inaccessible refuge de pensées bien à soi, éprouvées comme une foi. « Je me réfugierai dans mon vrai pays. Mon pays, ma France, est une France qu’on n’envahit pas » (25 juin 1940). Il s’agit de refonder une certaine idée de l’homme, de la dignité humaine, issue de siècles d’histoire et de pensée française. « Rabelais, Montaigne, La Rochefoucauld, Fontenelle, Voltaire, Chamfort, Stendhal, France, Gide, autant de dénonciateurs de la ‘cérémonie’ » p.62. La liste des vrais Français sur lesquels s’appuyer pour conforter les valeurs est de taille.
Le premier d’entre eux est sans aucun doute Montaigne. Guéhenno écrit, le 24 juillet 1940 : « Jamais n’ai-je mieux saisi l’étrangeté de Montaigne. Le plus admirable est que ces Essais, si raisonnables, si mesurés, aient été écrits pendant les guerres de religion, quand la démesure triomphait » p.26. Dans les temps troublés, en 1540 comme en 1940, il faut en revenir à Montaigne. « Voilà un esprit propre. Même cette propreté est tout le principe de sa force, et ce qui rendra à jamais sa pensée efficace et active. Je note qu’il se méfiait de la musique comme des idées vagues. Il avait en horreur toute feintise, la « cérémonie » qui ne nous interdit pas seulement de nous montrer ce que nous sommes, mais qui nous empêche de nous connaître ce que nous sommes, en nous remplissant de révérence pour de fausses idées de nous-mêmes. Il veut qu’on se connaisse » p.61. C’est lourdement dit, maladroitement exprimé, mais le fond est crucial : sans lucidité, point de refondation.
Guéhenno se veut tout ce que la bourgeoisie collaboratrice hait : « Un homme indépendant qui ne doit son indépendance qu’à lui-même, à son effort, à son métier (…), un barbare qui a bousculé les notables, un boursier sans respect pour les héritiers, un homme libre » p.23. Parce qu’il n’est englué dans aucune contrainte sociale, matérielle ou intellectuelle, l’homme libre peut choisir ses valeurs. Tels étaient – bel exemple historique – les Français de 1789 : « Ils proclamaient contre le destin, contre la nature, contre toutes les tyrannies. Ils savaient nos fatalités et que la nature se moque de cette justice qui n’est qu’au fond de nous. Mais si la nature défait à chaque instant ce que nous faisons, la liberté, l’égalité, la fraternité, d’autant plus faut-il le refaire par notre volonté, par des lois, et opposer au désordre naturel l’ordre humain » p.49. Hymne à l’humanisme d’un ancien du Front populaire.
Passe ici exactement l’écart qui sépare la gauche de la droite. La première est volontariste, profondément politique : il s’agit de corriger par des lois librement débattues et décidées, le désordre naturel, la loi du plus fort et le hasard des chances. La seconde considère que l’ordre de la nature est le meilleur, qu’il faut laisser faire, qu’une pesanteur, voire une fatalité extra humaine s’impose, contre laquelle il est vain de lutter. Le tempérament de droite collaborera, le tempérament de gauche résistera, bien que ce soit moins simple dans les âmes. Il s’agit de tendances de l’esprit, puisque dans les faits, droite et gauche se recomposeront, chacun apportant des hommes à la Résistance, mais ce que dit Guéhenno est assez bien vu. « La culture est une tradition et une espérance. Nous resterons fidèles à l’une et à l’autre. Un homme d’Occident est cette conscience, cet individu dont Socrate a défini la valeur morale, pour lequel Jésus est mort, à qui Descartes a enseigné les moyens de sa puissance, que la révolution du XVIIIe siècle a établi dans ses devoirs et ses droits. Trois mille ans de raison et de courage ont définitivement orienté le ‘chemin de l’homme’ » p.170. On le voit, l’humanisme français s’enracine dans toute une tradition universelle. Montaigne, La Rochefoucauld, Voltaire : « les valeurs humaines n’étaient à leurs yeux que des valeurs de raison et d’usage. D’un long, très long usage. Elles s’établissent, se clarifient et se purifient à travers des milliers d’essais et erreurs. Tout le monde travaille et collabore. L’homme finira par être l’homme, c’est une suffisante espérance. Et la folie commence pour les individus et les peuples quand ils s’arrogent le privilège d’on ne sait quelle surhumanité » p.408.
Les dangers viennent de l’époque et de ses dérives. La morale se perd dans l’inculture, dans l’abaissement, dans la ratiocination, dans la gloriole. « Un grand homme des époques civilisées était grand précisément par ce qui le distinguait de la masse, l’intelligence, la volonté, la culture, la finesse de l’esprit ou du cœur. Ces nouveaux grands hommes [Lénine, Staline, Hitler] sont grands par ce qui les fait semblables à elle, et ce peut être un assez grossier bon sens, la brutalité, l’inculture » p.138. En ce milieu de XXe siècle, l’honneur est bafoué. Or, « je veux pouvoir regarder tous les hommes comme mes frères. Mais celui-là n’est pas mon frère dont le premier regard cherche cruellement en moi et triomphe d’y découvrir la faiblesse, le besoin, le malheur qui lui garantira ma soumission. Je ne peux aimer que ceux qui espèrent en mon courage et ma fierté » p.153.
Danger du milieu intellectuel : « Il y a en tout bon khâgneux, en même temps qu’un esprit capable de le vouer aux recherches nobles et désintéressées, une habileté dialectique dangereuse dont il est toujours tenté de tirer profit. La pratique du logos rend apte à tout, au service du mensonge aussi bien que de la vérité » p.209.
Danger de la raison : « Une des plus grandes habiletés de l’Action française fut de créer une sorte de snobisme de l’intelligence. Maurras s’était donné pour son unique défenseur, chacun de ses partisans avait tout lieu de se croire le plus fin et le plus subtil des hommes après lui » p.230.
Danger de la religion : « Le peuple s’en moque. Elle n’est plus que l’opium de la bourgeoisie (…) à présent débordée et ne sachant plus à quoi se vouer, tâche de trouver dans les patenôtres et une religion d’habitude, la tranquillité et le sommeil » p.224.
Danger de l’enseignement : « On forme dans le meilleur des cas des rats de bibliothèque, on les habitue des leur vingtième année à un tiroir, on les dresse à compiler. On cultive en eux une vanité mesquine. La science ne consistera jamais pour eux qu’à ajouter une fiche à leurs fichiers, comme un gramme à un kilo. Elle les distraira de leur vie qu’elle devrait enrichir et dominer. Leur petite curiosité les dispensera de la grande. Sans critique, sans goût, sans ardeur, chercheurs médiocres, plus mauvais professeurs, ils ne peuvent qu’entretenir notre société de la quantité dans l’illusion vaniteuse qu’elle a d’être une civilisation » p.235.
Danger de la gloriole : « La France commença d’être malade peut-être quand on commença à parler tant de ses héros, quand la dignité naïve des combattants se mua en la gloriole intéressée des anciens combattants. L’enflure des paroles dispensa de la solidité des pensées. Il y eu trop de médailles, trop de pensions aussi, un petit commerce avilissant de vanité » p.378.
Tous ces dangers ont préparé la génération de 1940 à la défaite et, pire, à la collaboration avec l’anti France, les ennemis germaniques mais aussi ceux qui n’avaient jamais accepté l’humanisme ni l’héritage de 1789.
D’où les trahisons – nombreuses. Des « hommes avilis par la peur, l’intérêt, la vanité : le maire ne veut pas manquer sa Légion d’honneur ; l’instituteur a peur de perdre sa place ; les présidents sont toujours fiers de défiler ; tel vieil homme malade s’était mis du cortège de crainte que le pharmacien, à la prochaine crise, ne le laissât mourir. C’est sur ces beaux sentiments que se fonde le nouveau pouvoir » p.284. Prenons exemple sur Renan : « Il faut une merveilleuse force de l’esprit pour concevoir et chercher la vérité contre le milieu où l’on a grandi, les influences que l’on a subies, les facilités de l’habitude et du bonheur, contre le courant, envers et contre tout » p.334. Car « la sottise et l’hypocrisie triomphent, l’ordre moral, la vertu des riches. Les bourgeois jubilent » p.28.
Un exemple, flamboyant, qui relève l’honneur et donne de l’espoir : « Une seule chose demeure intacte. C’est la foi dans la probité, la fidélité intransigeante du général De Gaulle. Que cela lui soit un hommage. Il n’en peut recevoir de plus pur, le plus marqué par l’angoisse et l’espérance » p.392. Une leçon lancée au futur comme une bouteille à la mer.
Jean Guéhenno, Journal des années noires 1940-1944, 1947, Folio 2014, 544 pages, €9.00

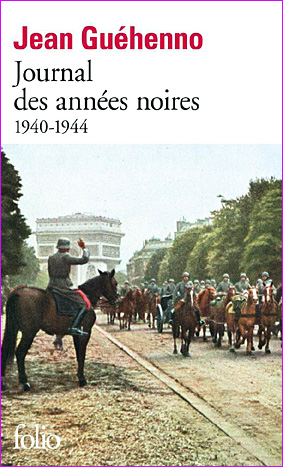
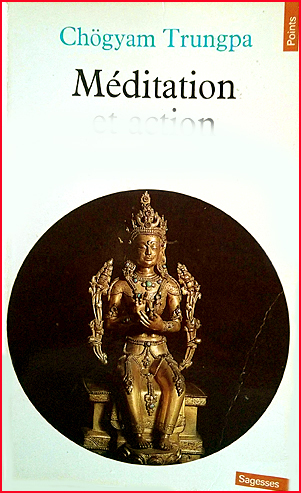



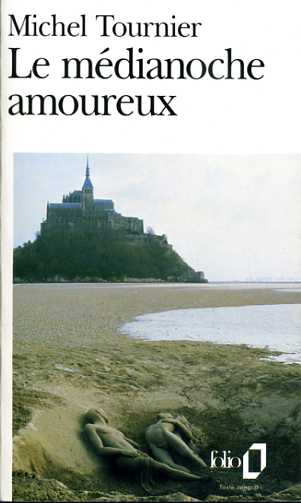



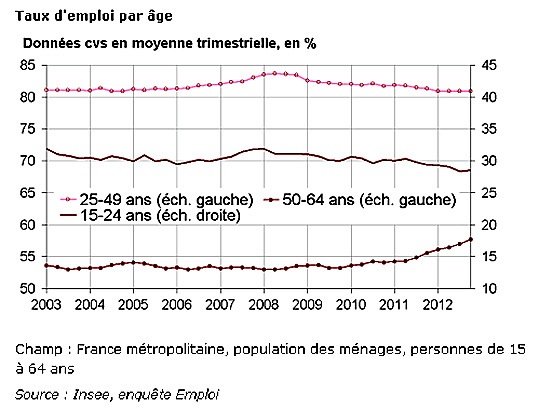



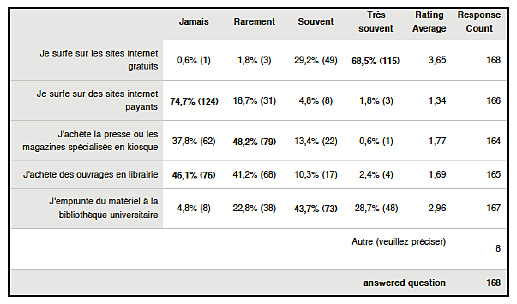

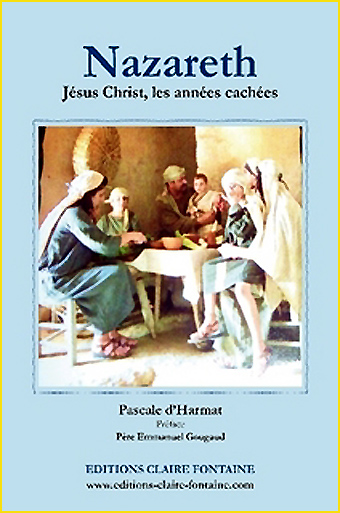





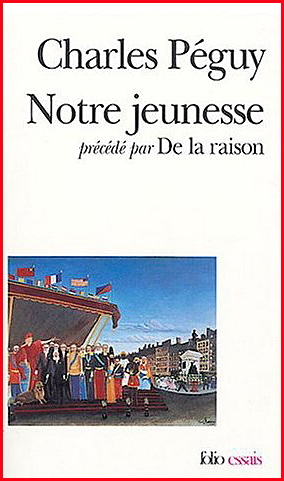


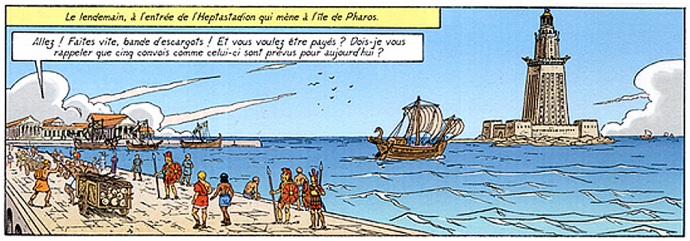
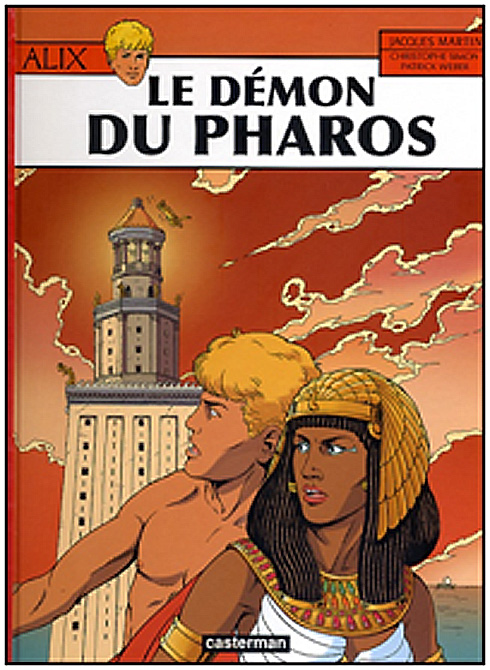
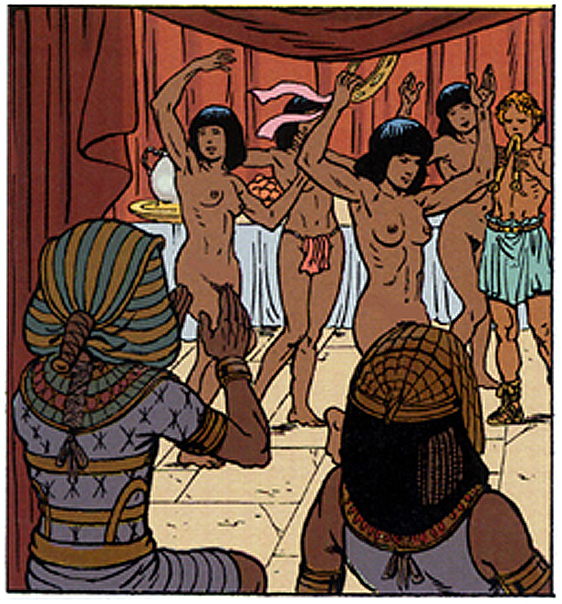

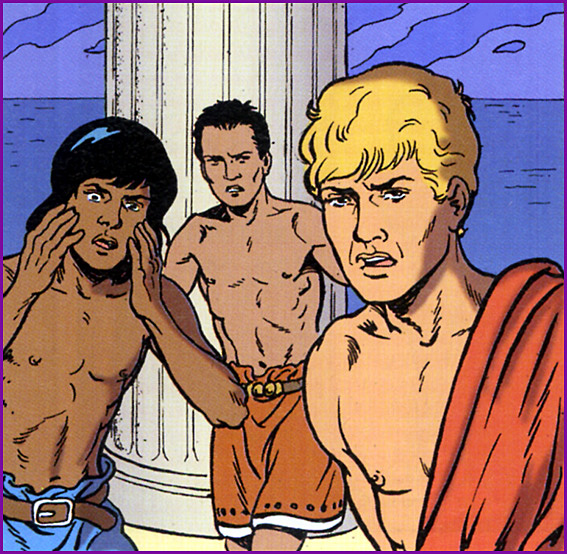
Commentaires récents