Le Costa Rica est réputé être le paradis des animaux.
Nous visitons en face du restaurant un jardin de colibris où de petits vases à embouchure étroite les attirent parce qu’ils contiennent de l’eau sucrée. Mais ce n’est pas le moment où les colibris vont boire, d’ailleurs difficiles à saisir en photo tant ils sont vifs. Dans le sous-bois s’étale un jardin de mousse naturelle. L’eau, le soleil et l’absence de saison, plus l’altitude, donnent un paysage luxuriant et très vert. Il ressemble à l’intérieur de l’île de Tahiti mais à une altitude plus élevée.
Un peu plus haut se dresse une boutique de souvenirs peinte aux couleurs vives et crues des hippies. Le terme « pura vida » est écrit en lettres formées de branches d’arbres courbées qui servent de barrières. Adrian nous dit que la boutique est tenue par deux Américaines « libérales » (au sens yankee de gauchistes) venues s’installer ici dans les années soixante-dix.
Sur la route, nous croisons un coati ; il est de la famille du raton-laveur et se laisse prendre en photo avec complaisance, la queue dressée toute droite comme un chat.
Une cascade, dans un virage, est l’occasion de nous dégourdir les jambes.
Nous voyons aussi l’iguane dont une Canadienne a voulu faire l’élevage – mais les contraintes administratives du pays ont fini par la faire renoncer. Un cafetier en a gardé un couple dans un « sanctuaire » pour attirer les touristes. Ils mangent de la salade et ne sont pas farouches.
Dans ce café à l’orée d’un pont, nous prenons une glace « à la figue de barbarie » nous dit Adrian ; c’est en fait le fruit du dragon (pitaya) et la glace est d’une belle couleur violette au goût acidulé.
Sous le pont, des caïmans se prélassent dans le fleuve boueux.
Cette journée est en bus avec beaucoup de paroles de la part d’Adrian. Le chauffeur se nomme Luis Angel mais tout le monde l’appelle Tita. Nous nous acclimatons, goûtons des boules de coco et des bananes séchées achetées au bord de la route. Les villes portent tous des noms importés : Marseille, Venise, Firenze, Monterey… Ecoliers et collégiens sont tous en uniforme. Ici, les manières sont notées, même la discipline (comportement, tenue, assiduité). L’école a lieu en deux horaires : 7 h-12h30 (avec cantine gratuite) et 12h30–17 h. Des bus scolaires emmènent les enfants. Le pays ne comprend pas d’armée depuis la guerre civile de 1948, c’est sa particularité. Il comprend aussi peu d’impôts, sauf la TVA et l’impôt foncier. Il attire donc tous les ultralibéraux des États-Unis et d’Europe. Le régime est présidentiel et, malgré l’épisode de dictature du général Federico Tinoco Granados de 1868 à 1931, le régime reste républicain et présidentiel. Le président élu est à la fois chef de l’État et du gouvernement. Le parlement élu pour quatre ans au suffrage universel comprend 57 députés, vote le budget et fait les lois. La plus haute instance judiciaire est la Cour suprême. Le président depuis le 8 mai 2018 est un journaliste et écrivain, Carlos Alvarado.
Notre hôtel-lodge de ce soir est à l’écart de la ville. Il est constitué de pavillons séparés pour deux personnes avec salle de bain dans un jardin. Son nom ? Hôtel Arenal Montechiari. Il a plu ces jours derniers mais nous avons du soleil aujourd’hui. Les animaux sortent et c’est la fête.
Près d’un supermarché nous pouvons observer des paresseux, au bord de la route des singes hurleurs. Dans les prés des vaches Holstein sont dites « du pauvre » car en noir et blanc comme les anciennes télévisions. Elles donnent moins de lait mais il est plus gras.
Nous partons à pied pour le restaurant à 18h30. Il est situé dans la ville et s’appelle La mancaderia del coyote (la boucherie du coyote). Il est clairement pour étrangers, avec musique obligatoire, même si nous assimiler à des chiens de prairie est un peu méprisant. Un jeune homme talentueux joue de la guitare et chante, reprenant des tubes américains. Mais cette ambiance trop bruyante tue toute conversation autre que celle avec ses voisins immédiats. Je fais connaissance de Zizi au surnom plutôt raide qui lui va bien, elle vend d’ailleurs de longs téléobjectifs photo. Mon vis-à-vis est Rice, en année sabbatique.













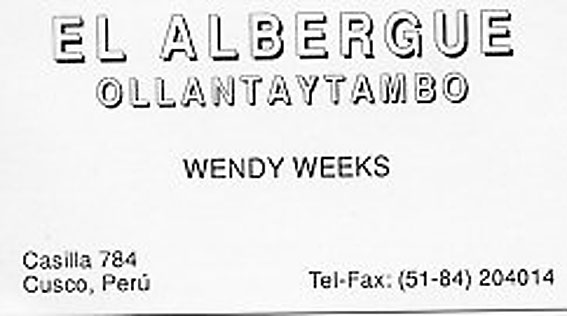


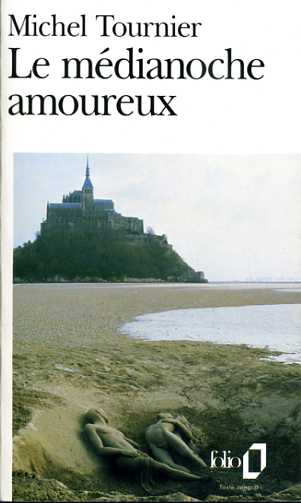








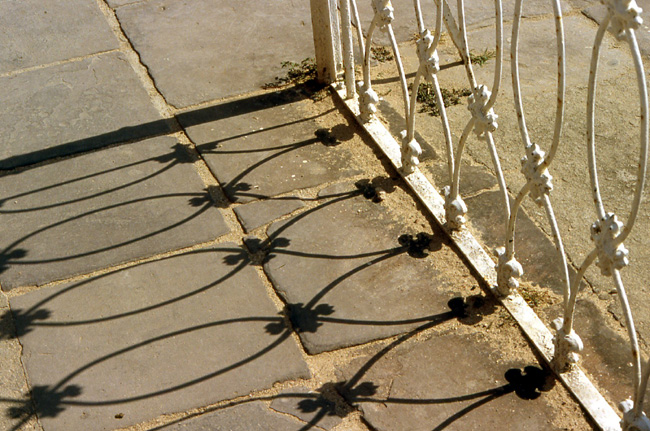














Commentaires récents