Le camp est établi près de la rivière, à Schaklaga, dans un chaos de rochers. Les chevaux s’y trouvent en longe, en large et en travers. Aussitôt, « caporal Biture » éructe les « règles de sécurité » dont elle veut se débarrasser au plus vite. A retenir : toujours monter par la gauche, ne jamais crier ni frapper sur la tête de la bête (shocking suprême pour un Mongol !), conserver des gestes mesurés mais faire clairement comprendre ce que l’on veut, parler au cheval et même le caresser pour l’apprivoiser (certains n’aiment pas les caresses). Pour le reste, pas de chapeau sans attache, pas de sac à dos ballotant, pas de cape qui flotte ni de coupe-vent crissant – tout cela pourrait faire peur aux chevaux et entraîner des emballements impromptus. « Allez » se dit « tchou ! » en mongol, « stop » se roule en « brrrr ! ». Il faut seulement prendre l’accent.

Nous montons les tentes igloo avant d’aller faire connaissance avec nos montures « pour qu’elles s’habituent à nous ». C’est réciproque, je n’ai pas l’habitude de ces grandes bêtes bizarres qui sont censées me porter et m’obéir. Leur robe est pour la plupart dans les tons de bruns ou de beige, deux ou trois brun foncé et un tacheté de blanc appelé par une précédente cavalière « Petit Tonnerre » en référence à la bande dessinée Yakari. Ce sont, par rapport aux nôtres, de petits chevaux. Ils sont proches des tarpans ou chevaux de Prjevalski directement issus de la race préhistorique peinte sur les parois de Lascaux. Ils pèsent 350 kg, font 1,30 à 1,40 m au garrot. Ils ont une paire de chromosomes de plus que leurs cousins actuels. Les chevaux que nous allons monter sont des croisements car le cheval de Prjevaslki ne se montait pas, trop sauvage pour cela.

Nikolaï Prjevalski était fils de cosaque zaporogue, ce qui aurait plu à Alexis. Officier et zoologue, explorateur, il a découvert des chevaux sauvages de Mongolie en 1879 et on leur a donné son nom. Selon Michel Jan, auteur du Réveil des Tartares, récit de son expédition collective en Mongolie lors de l’ouverture, en 1990 (publié chez Payot en 1998), ces chevaux mongols ont aussi peu de points communs avec les nôtres « qu’en ont un lévrier et un basset » (page 40). C’est dire ! Selon diverses sources, un cheval coûterait dans les 150 $, soit 6 mois de salaire moyen mongol, l’équivalent du prix d’une automobile chez nous.
Nous apprivoisons les chevaux une quarantaine de minutes à la longe, les promenant, les laissant brouter là où l’herbe les tente le plus. Le mien est un bai – robe brune, crinière noire – dont on voit les côtes et qui a une plaie mal cicatrisée à l’épaule droite. C’est Tserendorj qui m’a mis d’office sa longe dans les mains, me faisant comprendre qu’il me convenait tout à fait. Nous n’étions que deux à nous déclarer tout à fait novices en chevalerie. Les autres – et c’est bien français aussi – ne voulaient pas « avoir l’air », leur sens aigu de la hiérarchie faisant qu’avoir monté une heure un cheval il y a des années leur suffisait pour ne plus se sentir déclassés parmi les « débutants ». Francis m’avouera même, dans l’un de ses quarts d’heures vivables, que lui-même n’était monté qu’une fois une heure, à l’âge de 15 ans.

C’est ensuite l’heure de « l’apéritif », rituel en général agréable mais ici rendu « obligatoire » par la redoutable stalino-alcoolique qui réclame de suite 10 $ par personne pour financer la vodka, le vin bulgare, la bière ou – même ! – le jus d’orange, destiné à ceux qui « ne boivent pas ». Ils n’auront ainsi aucune excuse pour éviter de participer au financement des réserves d’alcool. La vodka est fabriquée en Mongolie et n’est pas mauvaise. Biture en boira tout un litre en cette première soirée collective, déguisée en une demi-bouteille « d’eau minérale » dérisoire. Je me suis mépris au début sur le contenu, empruntant la bouteille pour prendre une gorgée d’eau. Je suis tombé sur de l’eau de feu ! Le mystère était éventé.
Elle nous parle un peu de la langue mongole qui est riche en voyelles et pauvre en consonnes. L’harmonie vocalique et les déclinaisons donnent le sens de la phrase. Ce n’est pas aisé à apprendre pour nous, occidentaux, car elle fait partie de ces langues agglutinantes comme le turc. Elles ont des marques grammaticales et une base mais les principes qui président à la formation des mots et des séquences ne sont pas rigides. Les mots sont constitués en joignant à la racine un ou des suffixes appropriés auxquels est ajoutée une désinence. Le verbe termine la phrase et lui donne son sens. L’Encyclopaedia Universalis complète : « En fait, le mongol apparaît au XIVe siècle comme une langue beaucoup moins évoluée que le turc du VIIIe siècle ; son évolution a été beaucoup plus lente. D’autre part, il semble bien que le mongol et le turc ne sont pas issus, comme le voulait Vladimircov, d’un ancêtre commun ; ce sont deux langues qui ont évolué sur place à partir d’un fonds commun plus ou moins proche, mais qui remonte certainement très haut ; ces deux langues ont évolué en étroite connexion s’empruntant l’une à l’autre ce qui paraît être commun, et empruntant à l’indo-européen un nombre important d’éléments, qu’il s’agisse de suffixes ou de mots. C’est seulement à partir de l’époque des Türk que le turc a fait de nouveaux emprunts aux langues de civilisations qui l’entouraient, de la Chine jusqu’à l’Asie centrale. Le mongol, en dehors des emprunts anciens, s’enrichit considérablement grâce à l’ouïgour à l’époque mongole (XIIIe et XIVe siècles). »

Cruella et Biture font ce soir un duo en faveur de la Mongolie, au repas. Elles monopolisent la conversation. Vodka aidant, cela devient dithyrambique. Cruella est ici comme un parasite, s’étant entendue directement avec Biture sans passer par l’agence de voyage française, mais utilisant sans vergogne les suppléments et la logistique. Elle ressert en « eau » Biture à chaque fois que son verre est vide, l’encourageant dans son vice pour se faire bien voir. Le dîner est composé de salade de tomates, concombres et oignons (tant qu’il y a des légumes frais) et de mouton aux spaghettis. Ce ne sera pas une randonnée « gastronomique », c’était écrit sur le programme. Le dessert est une confiserie russe sous papier d’aluminium. Le ciel, en revanche, est rempli d’étoiles au point que plusieurs naïfs, trompés, par la douceur du soir et qui ne se sentent pas à 1600 m d’altitude, veulent coucher dehors pour les regarder. Ils rentreront dare dare à 4 h du matin, quand le froid mordant fustigera leur imprévoyance.

Le jour de gloire finit par arriver. Nous nous levons « à 8 heures », même si les horaires, avec la dipsomane qui nous sert de chaperon, sont plutôt élastiques. Nous nous en apercevrons. Biture a elle-même prévenue « ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas au petit-déjeuner ». Nous nous ferons aux « lever 9 h », suivis d’un départ en général vers 11 h et d’un « déjeuner » vers 16 h, tous les jours que nous serons à cheval. Les lendemains de beuveries ne sauraient être riants. Le petit-déjeuner n’est pas mongol (soupe au gras et mouton bouilli) mais bien occidental : thé, café, jus d’orange, yaourts aux fruits, pain ou croissant artisanal, Vache-qui-Rit. Nous démontons nos tentes et rangeons nos affaires. Francis, en ce premier jour, a encore l’excuse d’être seul sous sa tente et de devoir la ranger sans aide. Mais son retard deviendra systématique, suivant en bon collabo le rythme du chef. Cela prendra des allures de je-m’en-foutisme et d’irrespect complet pour les autres. Qui est allé alors lui dire ? Val, je crois. Il est bien le seul. Les Français aiment à critiquer par derrière mais répugnent à dire en face quoi que ce soit, même en y mettant les formes. Ce n’est pas être « bien vu » et craindre, comme me le dira S., de « ne pas être suivi par les autres ».

Le jeu, chaque matin, est de reconnaître chacun son cheval. Contrairement aux autres groupes, à ce que nous dira Biture dans un de ses bons jours, nous n’avons pas de problèmes à cet égard. Le mien est un bai à double tache blanche sur le chanfrein et une marque en fleur à la cuisse. Il a une crinière en brosse et une selle russe en métal et cuir, plus confortable que les selles mongoles en bois aux bosselures métalliques, très relevées à l’avant et à l’arrière, permettant à l’origine de ne se tenir que sur une cuisse pour tirer à l’arc au galop. Togo règle les étriers une fois que chacun est monté. Les Mongols ont tendance à les régler haut, ce qui est dû à l’inconfort de leur selle qui les fait mettre debout très souvent ou en équilibre sur une cuisse. Nous sommes moins habitués à avoir les genoux remontés, ce qui engendre un certain inconfort.

Ma première impression est d’être assis sur un ver de terre qui se tortille sous mes fesses. Je m’y fais avec le temps. Le cheval obéit au moindre changement des rênes, du moment qu’ils sont tendus. Mais le mien a le pas lent et il est très difficile de le faire aller plus vite à la voix. Il faut le fouetter nettement et l’on sent que, de toute façon, ce n’est que partie remise ; après un temps de trot sec et court, il reprend son pas de sénateur. Peut-être ne suis-je pas assez directif ou assez convaincu ? Le caporalisme n’a jamais été mon fort, au contraire de la plupart des amateurs de chevaux qui aiment la sensation de puissance donnée par le commandement d’une demi-tonne de muscles sous les cuisses. Toujours est-il que mon cheval est manœuvrant mais pas rapide. Tserendorj ou Gawa, l’un des aides, passeront leur journée à fustiger la croupe de ma rosse ou à le tirer à la longe pour qu’il rejoigne le gros du troupeau. Au pas je tiens l’assiette, mais au petit trot, sautillement particulier de ces chevaux mongols selon Michel Jan, je suis assez mal, n’ayant aucune pratique. Or, la lenteur de ma bête, dont le pas est plus lent que le pas des autres, doit être rattrapée de temps à autre au grand dam de mes fesses ! J’aurais aimé quelques conseils sur la façon de me tenir ou de me faire obéir, mais le mot d’ordre est « démmerde-toi ! » A quoi sert d’avoir une « accompagnatrice française » et d’ouvrir cette randonnée aux « débutants » si c’est pour être laissé à soi-même ? Bo, l’autre débutant, s’en tire mieux mais son cheval doit le trouver trop lourd car, à deux reprises, il se couche carrément par terre, les deux pattes sous lui !
Nous partons sans sac sur le dos, ceux-ci suivent dans l’un des tout-terrains qui nous rejoint à chaque pause. Nous allons au pas de balade au travers des étendues. La steppe s’étend dans toute sa grandeur d’herbes et de collines rases. L’Orkhon est traversée à gué.














































































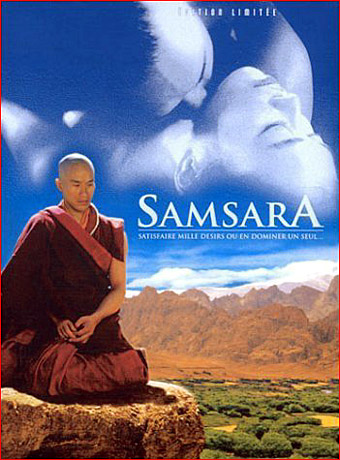


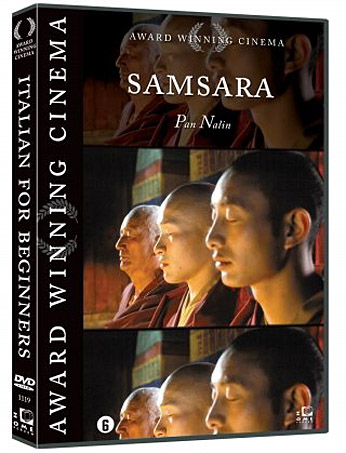







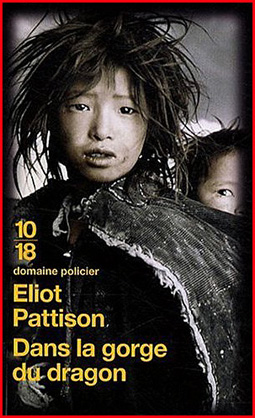






































































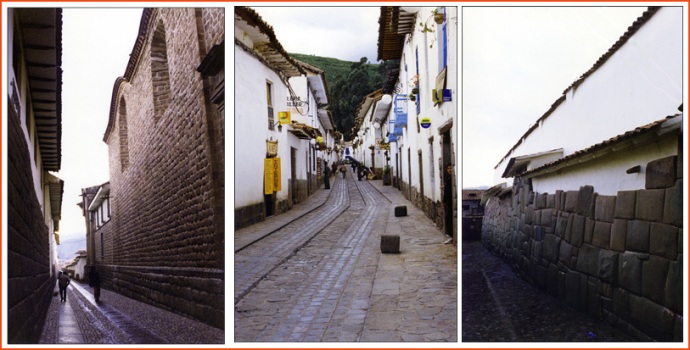










Commentaires récents