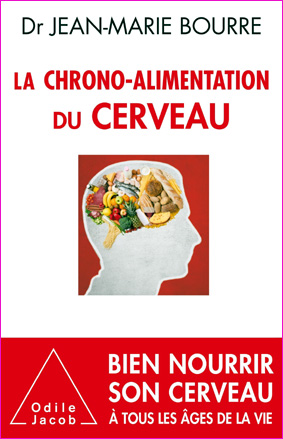
Il existe d’innombrables « livres de santé », dont la majorité sont écrits par des charlatans ou des journalistes qui répètent sans savoir ni vérifier. Il existe quelques ouvrages écrits par des professionnels. Celui-ci en est un, par un neuropharmacologue membre de l’Académie de médecine et de l’Académie d’agriculture, chef d’unités de l’Inserm dans la biochimie du cerveau. Il a rédigé sa thèse sur les oméga-3 et a publié en 1990 La diététique du cerveau, réédité en 2000. Il revient sur le sujet vingt-cinq ans plus tard pour l’actualiser.
Le cerveau est un prétexte pour évoquer l’alimentation en général et la bonne façon de l’ingurgiter. Trois parties : le cerveau et l’art de manger, que manger pour nourrir le cerveau, manger et boire : rythmes et circonstances particulières.
En bref, pour être bien dans sa tête, il faut bien manger. Suffisamment – de tout – et régulièrement. Le jeûne n’apporte rien mais affaiblit (ce qui rend les âmes plus malléables aux supérieurs ou aux maîtres). Il faut apporter au corps, donc principalement au cerveau, 13 vitamines, 15 minéraux et oligo-éléments, 8 à 10 acides animés, 1 oméga-6 et 2 oméga-3. La science va contre les « régimes » qui sont soit punitifs, soit nocifs, et n’ont de sens que dans des cas très particuliers.
L’être humain est omnivore par sélection de l’Evolution depuis trois millions d’années ; pour notre sous-espèce il est demeuré chasseur-cueilleur durant 100 000 ans, adonné aux plantes et à la viande. Ce n’est que depuis le néolithique, il y a moins de 10 000 ans, qu’il s’est habitué aux céréales cultivées et aux produits laitiers de l’élevage. Nous sommes donc programmés pour manger de tout, notamment de la viande et des laitages, ce pourquoi les régimes vegan et végétaliens sont plus des modes suicidaires issus de gourous qui veulent vendre leur méthode ou leur livre que de la diététique. Les grossesses vegan aboutissent à du rachitisme et à un retard d’intelligence des bébés, des exemples à l’hôpital sont nombreux.
Cela ne signifie pas qu’il faut s’empiffrer de viande ou se goinfrer de fromages mais qu’il faut de tout un peu, et rien de trop comme le disaient fort justement les Antiques.

Trois repas par jour évitent coups de pompes et fringales, donc stress et risques cardiaques ; un goûter peut être ajouté pour les enfants, adolescents et vieillards, les premiers parce qu’ils ont plus de besoins et dépensent plus d’énergie, les derniers parce qu’ils mangent trop peu à chaque repas (et n’ont jamais soif) – le rituel du « thé » à cinq heures, très anglais mais aussi très vieille France avec le café, est justifié. Garder les mêmes horaires est nécessaire pour un bon rythme biologique car le corps réagit non pas à ce qu’il vient de manger mais à ce qu’il anticipe du prochain repas.
Dans le détail, la viande rouge trois fois la semaine au moins apporte les protéines aisément assimilables, la vitamine B12 et le fer dont la majorité des Français – et surtout les Françaises – sont carencés. Mais pas de produit laitier avec la viande, ni de thé, leur association diminue l’absorption du fer (pas d’escalope de veau à la crème !) ; au contraire, la vitamine C la renforce. Pour le reste, poisson gras pour l’oméga-3, œufs de poules en plein air élevées avec d’autres chose qu’uniquement des céréales, les légumes à feuilles pour le transit et les minéraux, les légumineuses et la pomme de terre ou les pâtes pour l’énergie en sucres lents. Mais il est utile d’ajouter à chaque fois un peu de matière grasse (huile de colza, de noix ou d’olive, fromage râpé, crème bio) pour ralentir les sucres et éviter qu’ils n’agissent comme celui des pâtisseries. Ce pourquoi d’ailleurs, la tradition qui veut que l’on prenne le dessert à la fin a du bon. Les fruits de mer sont excellents pour les éléments rares tels que l’iode (dont l’absence donne le goître ou fait naître des crétins des Alpes) ou le zinc. Et les carottes râpées réclament de l’huile pour donner tout leur bêta-carotène et la lutéine utile à la vision.
La cuisson donne du goût et rend plus assimilable, même si elle réduit certaines vitamines. Mais par exemple l’œuf cru est une hérésie car plus de la moitié de sa valeur nutritive n’est alors pas assimilable. De même la pomme de terre ou le manioc sont des poisons s’ils ne passent pas par la cuisson préalable. La présentation compte autant que les couleurs, pour donner de l’appétit, l’ambiance, la conversation et même la musique (douce) augmente le plaisir et permet de mâcher plus et plus lentement. Bâfrer en ado avide est en effet contre-indiqué et rend obèse. Boire de l’eau est encore le meilleur, les « minérales » ne sont guère utiles, un peu de vin (rouge) peut aider le cœur (l’alcool reste un poison mais les tanins du vin son bénéfiques).
Il y a bien d’autres conseils – détaillés – sur la chrono-alimentation, le contenu des trois repas par jour, les éléments indispensables au bébé avant et après naissance, mais aussi sur les excès qui engendrent les « maladies de civilisation » que sont le cancer et les diverses pathologies cardiovasculaires. Encore une fois, nous sommes des animaux humains, programmé comme nos ancêtres à faire de l’exercice, manger de tout, sans rien de trop.
Un bon livre de scientifique, parfois un brin bavard mais que l’on prend plaisir à consulter après lecture sur un point de détail. Il réhabilite les plats traditionnels, si variés et aux associations heureuses (cassoulet, paella, couscous garni, pot-au-feu, choucroute de la mer, salade césar) ; il écarte avec de vrais arguments les injonctions punitives sur la nourriture qui sont nocives pour la santé ; il redonne le plaisir de manger du bon, du varié, du sain. Ce n’est pas si courant.
Dr Jean-Marie Bourre, La chrono-alimentation du cerveau, 2016, Odile Jacob, 349 pages, €13.80 e-book Kindle €18.99






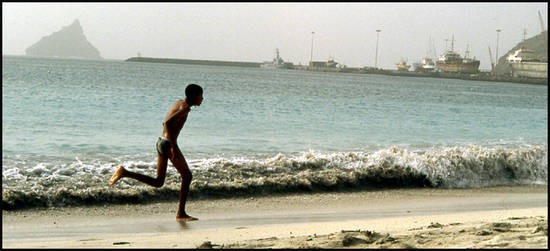
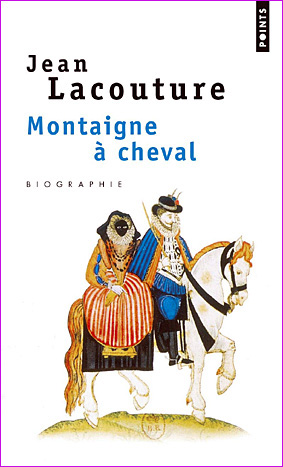

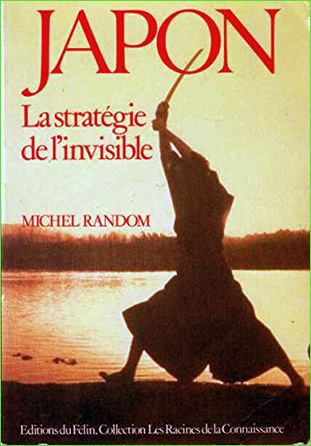







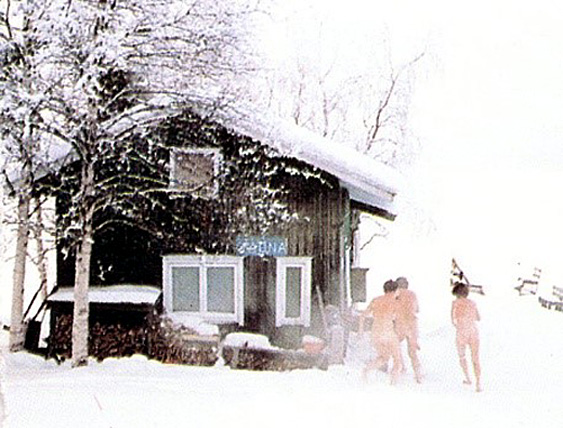
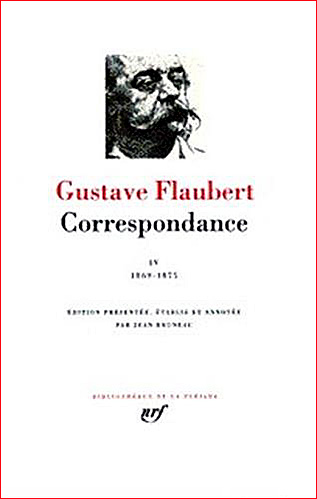

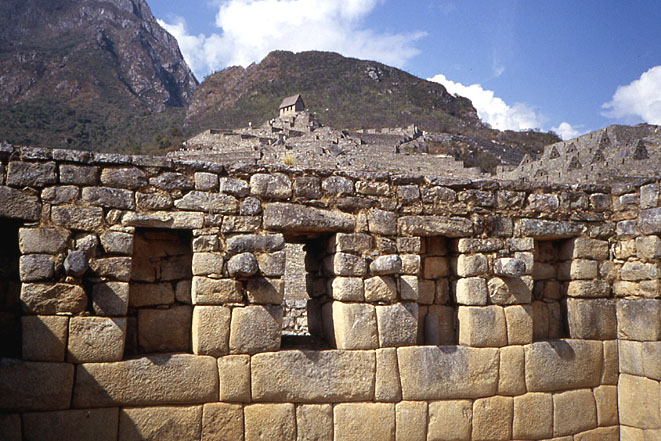


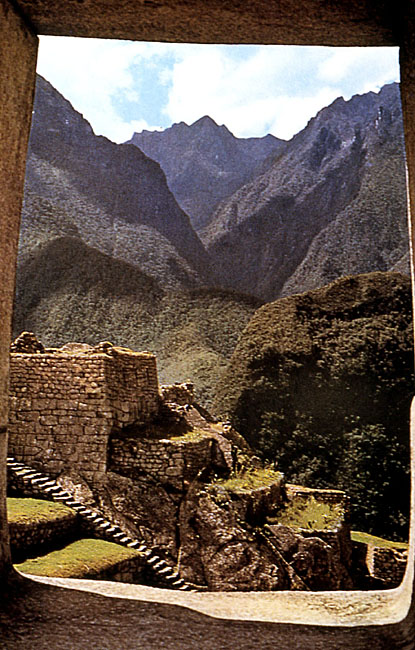





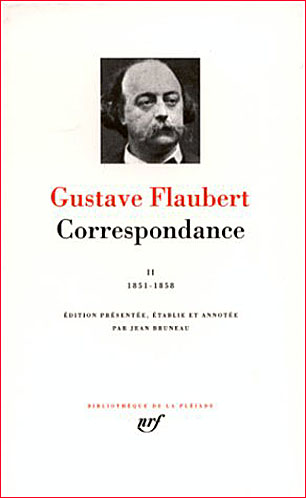

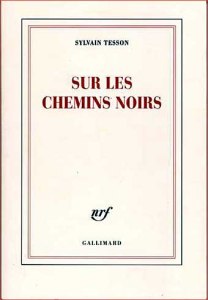





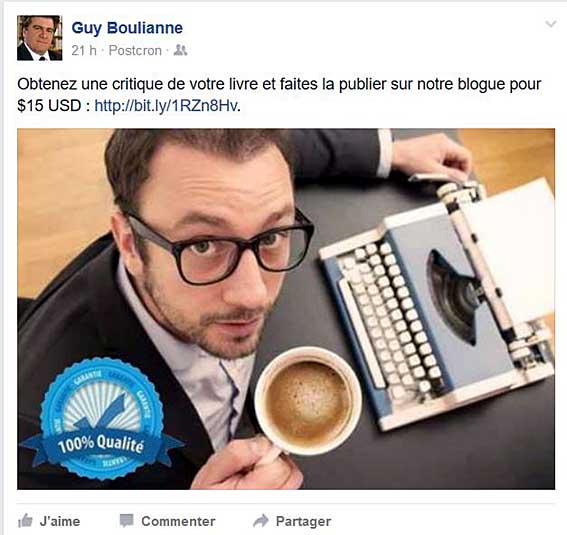



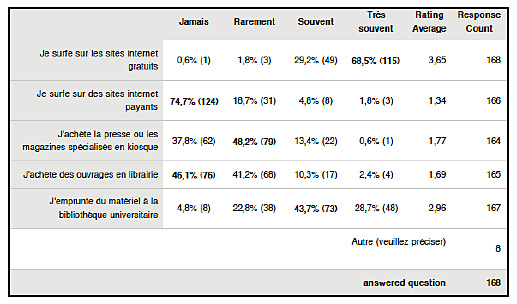








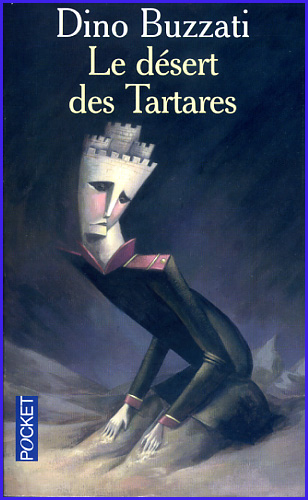





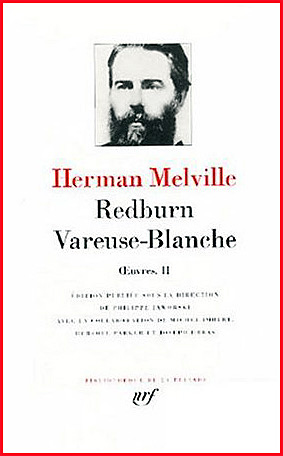

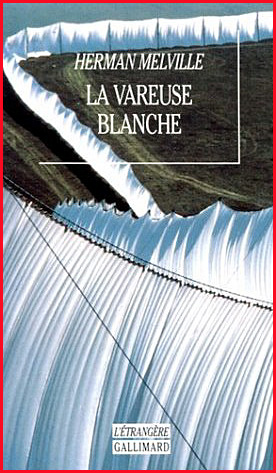
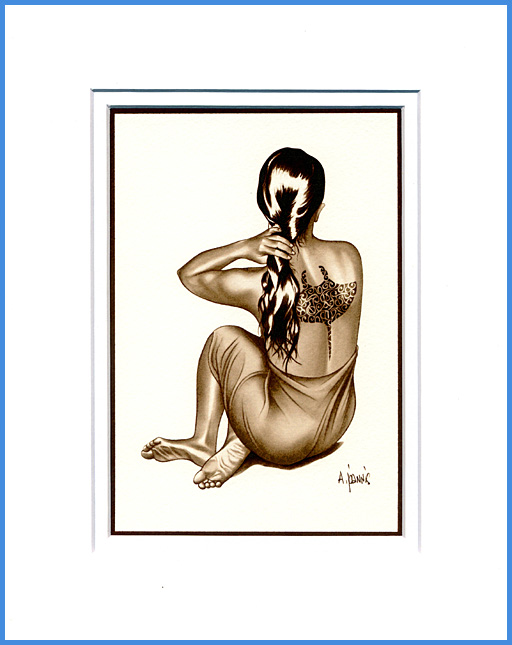



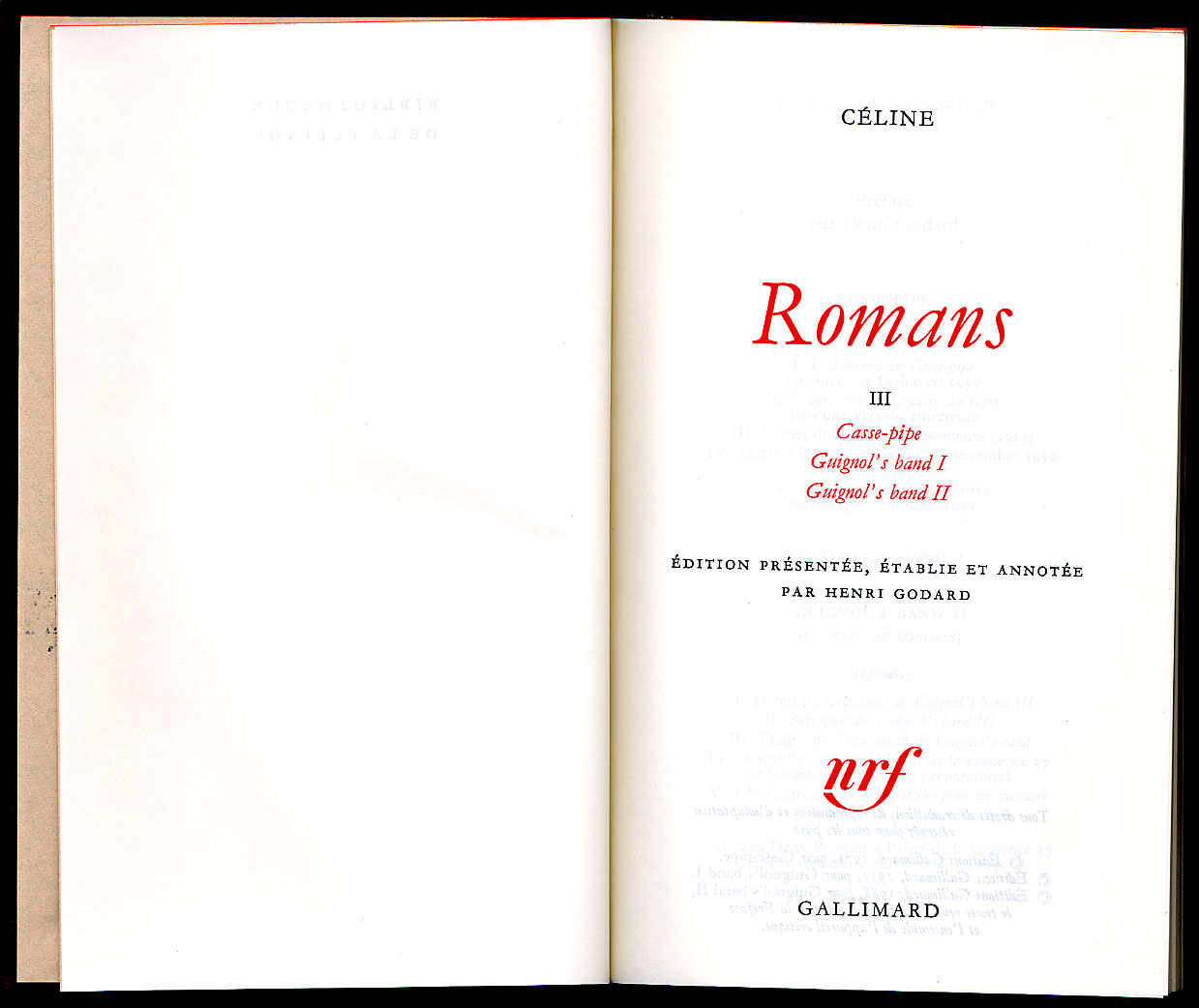


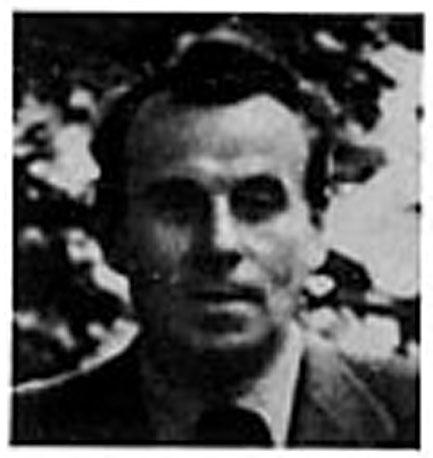
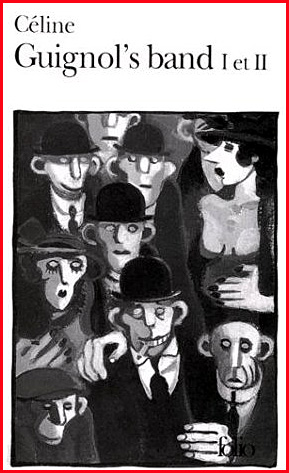




Commentaires récents