Voici novembre, le neuvième mois. Le paysage se liquéfie sous le ciel bas ; le vent abat des rafales de pluie sur les vitres. L’eau tombe, insistante, inexorable, monotone. Les arbres dénudés frissonnent, tordant leurs branches comme des doigts désespérés vers le plafond des nuages. La forêt est brune et rousse, les feuilles rougies des châtaigniers lancent des lueurs tristes.
 L’automne est là brusquement, humide, molle, alanguie. La végétation fond pour devenir couleur de terre et se confondre peu à peu avec elle, humus pourrissant, liquide sale. Voici le temps des morts.
L’automne est là brusquement, humide, molle, alanguie. La végétation fond pour devenir couleur de terre et se confondre peu à peu avec elle, humus pourrissant, liquide sale. Voici le temps des morts.
Les fusils claquent dans les bois et sur les champs vides. Le gibier fuit ou s’envole, roux comme les feuilles tombées, dérisoire tentative de camouflage. Sur le fond grisâtre de l’horizon passent des vols de corbeaux noirs.
Le marcheur a froid, la pluie coule dans son cou et son dos, l’humidité s’insinue jusqu’à son cœur et ses os. Dans la pénombre des arbres, sur l’étendue des champs, tout est nettoyé, uniforme, décoloré. Les grillons se sont tu, les oiseaux se cachent, le vent gémit. Le voyageur serre son manteau et relève son col. Il pense à la maison douillette où brûle la lumière, aux sourires de ses proches, à l’alcool âpre qui fait chanter l’esprit près de la cheminée, au livre amical qui parle d’autres pays, aux disques qui révèlent un autre monde.
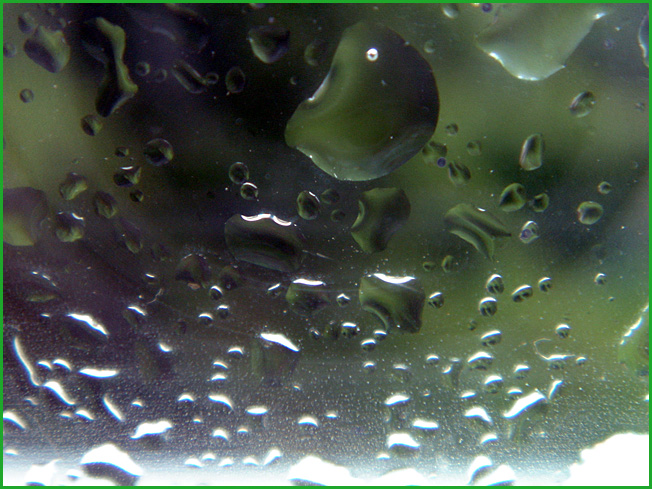 Face aux éléments hostiles, l’homme est pareil à l’ours. Il aspire à sa tanière et à s’y enfermer pour hiberner. Au centre de son monde calme et clos, où se perpétue un peu de la chaleur d’été, il prend le temps de penser à lui-même, à ses petits et à tous ceux qui ne sont plus.
Face aux éléments hostiles, l’homme est pareil à l’ours. Il aspire à sa tanière et à s’y enfermer pour hiberner. Au centre de son monde calme et clos, où se perpétue un peu de la chaleur d’été, il prend le temps de penser à lui-même, à ses petits et à tous ceux qui ne sont plus.
Novembre, mois des morts et des chasses sauvages.
L’automne, comme le printemps, est une saison instable, une saison qui devient. Elle n’a pas cette plénitude de l’été ou de l’hiver, elle ne dure pas, elle hésite entre regret d’été et prémisses d’hiver. L’automne n’a ni un climat, ni des couleurs, ni des odeurs constants pour en faire une saison. C’est un passage, transition d’une fin d’été à un début d’hiver. L’automne n’est ni la nature morte ou endormie, ni la nature vive et éveillée : en nos pays elle s’endort peu à peu.
Novembre, mois des proches qui sont morts et qui s’effacent lentement du souvenir pour que la vie se perpétue sans le poids du passé.
 Il est des hommes rudes que le froid revigore et exalte. L’humidité envahissante de l’automne les stimule et les incite à réagir contre la mollesse du paysage, la liquéfaction du végétal et le pourrissement des fruits. Leur vitalité refuse l’idée de mourir. Non pas l’idée de la mort, qui est inéluctable du seul fait de naître, mais ce passage graduel de la vivacité à la fatigue, la mort lente par la paresse, la vieillesse et la décrépitude. Les guerriers préfèrent quitter la vie les armes à la main, avec brusquerie et courage. C’est pourquoi l’automne, saison langoureuse et lasse, mélancolique et propice aux débordements de sentimentalité, leur déplaît. Ils n’aiment point les transitions, préfèrent ce qui tranche.
Il est des hommes rudes que le froid revigore et exalte. L’humidité envahissante de l’automne les stimule et les incite à réagir contre la mollesse du paysage, la liquéfaction du végétal et le pourrissement des fruits. Leur vitalité refuse l’idée de mourir. Non pas l’idée de la mort, qui est inéluctable du seul fait de naître, mais ce passage graduel de la vivacité à la fatigue, la mort lente par la paresse, la vieillesse et la décrépitude. Les guerriers préfèrent quitter la vie les armes à la main, avec brusquerie et courage. C’est pourquoi l’automne, saison langoureuse et lasse, mélancolique et propice aux débordements de sentimentalité, leur déplaît. Ils n’aiment point les transitions, préfèrent ce qui tranche.
Novembre était pour les Celtes Samhain, la fête de la grande bataille des dieux, dont les Chrétiens ont fait la fête de tous les saints.
C’est une vérité d’expérience que le monde extérieur agit sur le tempérament des hommes. Fait-il beau, nous sommes joyeux ; fait-il sombre, le gris du ciel fait lever en nous la tristesse par sympathie. Notre rythme hormonal, notre climat émotionnel, nos états d’âme, semblent suivre ceux de la nature en ses saisons : enthousiaste au printemps, mélancolique en automne, joyeux en été comme en hiver grâce au soleil ou à la neige. Est-ce pour cela que nous revient la pensée profonde de Renan ? « L’histoire du monde n’est que l’histoire du soleil. »





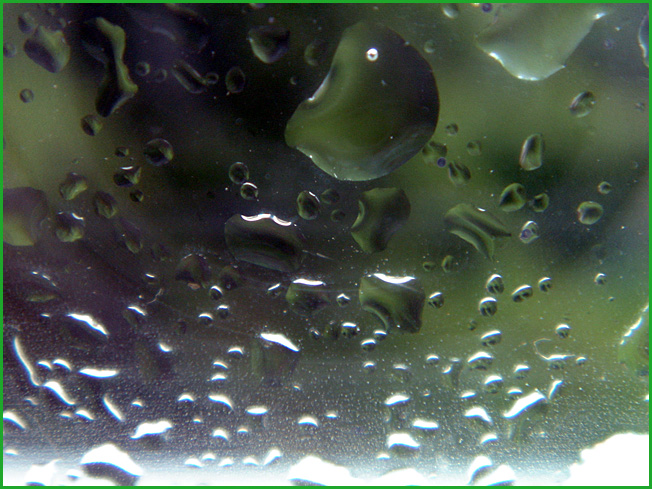

Commentaires récents