
L’auteur célèbre du ‘Da Vinci Code’ revient avec une énigme symbolique, l’attrait d’occultes maîtres du monde et l’outil très efficace du thriller. Chapitres courts, intrigue haletante, poursuites dans des lieux mythiques dont est révélée la face cachée, exploration des arcanes ésotériques ou des sciences avancées, tous les ingrédients sont là. Et ça marche. ‘Le symbole perdu’ est un roman : il raconte une histoire, la situe en décors connus mais renouvelés, il maintient l’attention jusqu’au bout.
Un roman n’est pas vrai, seulement vraisemblable. Ce qui est écrit n’est pas la réalité mais une fiction. C’est le jeu du marketing que de faire prendre des vessies pour des lanternes en jouant sur les mots. Formellement, il est vrai que « toutes les organisations et institutions citées dans ce roman existent réellement », comme dit l’en-tête du livre. Mais sous le titre il est bien écrit « roman » et non récit ou enquête historique. Affirmer qu’« en 1991, un document secret fut enfermé dans le coffre-fort du directeur de la CIA » ne fait que nous allécher sans rien affirmer de véridique. Pas plus que lorsqu’on dit que les gagnants ont tous été choisis parmi ceux qui ont tenté leurs chances… La franc-maçonnerie existe, la noétique existe, la Bible aussi, de même que Washington et son plan dessiné par L’Enfant.
Mais toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé n’est que purement fortuite. Le roman fonctionne comme un jeu de pistes pour ados scouts, ce en quoi il rappelle aux cinquantenaires leur enfance bien loin d’Internet, de Twitter et des jeux vidéo – et même de la télé. Le romancier distille avec talent les informations cryptées qu’il révèle peu à peu, dans les codes antiques recensés sur Wikipédia (ainsi le code maçonnique). L’auteur se moque à plusieurs reprises des geeks naïfs, tenant de la théorie du complot, qui croient en un cercle restreint d’initiés (en général juifs, financiers, américains et maçons) maîtres du monde.
Ce roman est donc un bon « roman » comme l’artisan Brown sait en composer, selon Larousse, « une œuvre d’imagination, récit en prose d’aventures inventées ou transformées que l’auteur a combinées pour intéresser le lecteur. » Imagination, aventures, combinaisons, intérêt – le livre a tous les symptômes requis. Ce que je trouve dommage, en tant qu’Européen critique, est cependant cet hymne candide à l’Amérique phare du monde, pointe avancée de l’humanité, dont le rôle est d’éclairer l’avenir… Il agite tous les poncifs yankees : la Bible comme unique réceptacle de la sagesse des Anciens, le peuple élu de Dieu pour le révéler au monde entier, l’hymne à l’individualisme, la lutte incessante du bien et du mal, la beauté du diable, l’esbroufe hollywoodienne des accessoires de la CIA, la toute-puissance de la liberté informatique. Il écorne à peine le mythe américain par sa peinture d’une éducation pourrie par le fric malgré l’amour, par sa description d’une initiation spirituelle pourrie par le fric malgré les rites sociaux, par sa caricature du népotisme pourri par le fric malgré les institutions démocratiques.
Une fois le livre refermé, le lecteur a passé de bons moments. Son imaginaire s’est excité, son adrénaline est montée, il s’est attaché aux personnages – en bref, il a vécu une autre vie durant quelque temps. Mais, intellectuellement, il ne peut s’empêcher de se dire : « tout ça pour ça ? » Ces clés à rassembler, ces énigmes à décrypter, ces lieux à explorer, ces menaces et ces secrets, ils ne révèlent que… ça ? Car, au bout du livre, vous aurez les clés de l’énigme. Et vous la trouverez dérisoire.
Que cela ne vous empêche pas de passer quelques heures agréables à sa lecture. Goûter est d’un autre ordre que décortiquer les ressorts ; ils ne se confondent pas. Vous pouvez aimer sans être dupe. C’en est même meilleur car vous ne risquez pas d’être déçu !
Dan Brown, Le symbole perdu (The Lost Symbol), 2009, Livre de poche 2011, 736 pages, €8.90 e-book Kindle €8.49


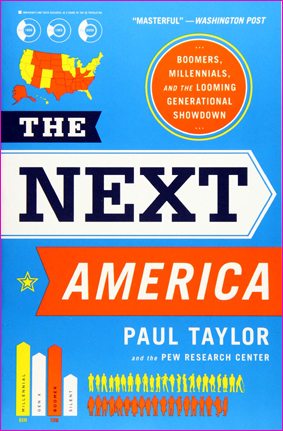

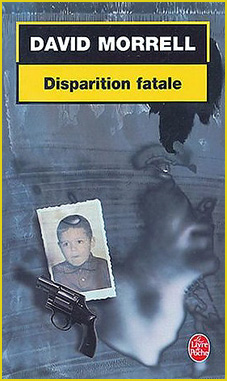
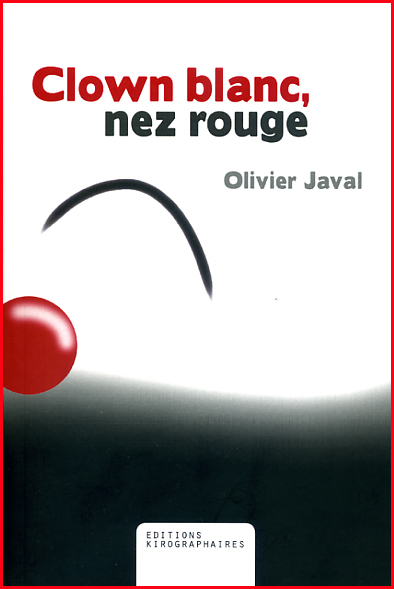

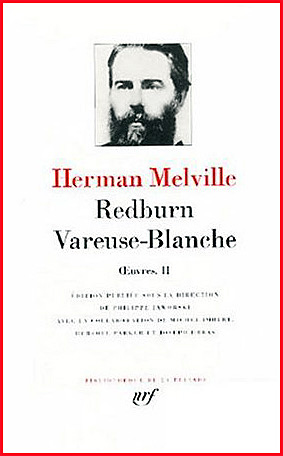

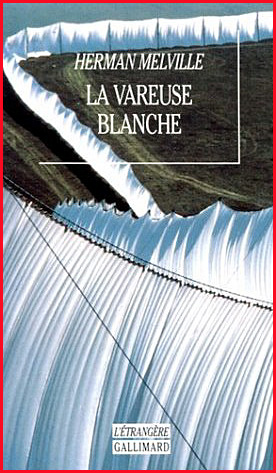
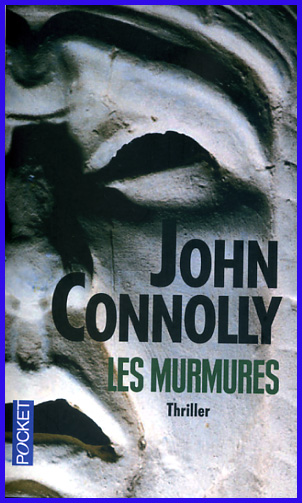


Commentaires récents