Le Japon, cette contrée étrange, s’éloigne à mesure qu’on l’approche. D’où l’exigence d’une pensée complexe qui multiplie les points de vue, laisse ouvertes toutes les portes et compare à tout moment nous et eux. « Toute réalité a toujours et instantanément plusieurs niveaux, et tout état d’être est par définition inexprimable », écrit l’auteur p.21. Il est l’invisible : continu, présent, impermanent. La réalité n’a pas besoin de définition car, si elle en a une, elle n’est plus alors réalité mais seulement définition. Le concept cache le réel derrière sa caricature.
La stratégie consiste à considérer l’humain comme image du tout, microcosme du macrocosme. Elle est au Japon une foi, analogue à celle qui bâtit jadis chez nous les cathédrales. « L’harmonie est elle-même le résultat d’une alchimie cohérente qui allie les forces contraires pour les manifester dans leur stabilité créatrice » p.28. Si l’occident réduit ce qui arrive aux causes et aux effets, fragmente pour analyser et schématise le réel pour le synthétiser en « lois » quasi immuables, l’orient conserve les formes globales, les rythmes et les proportions en relation avec l’humain. Nous disons révolution, travail en miettes, idées toutes faites ; ils disent que les mots sont une prison et qu’il faut laisser être les choses, intégrées, homogènes, globales.
L’harmonie japonaise est une tension des contraires, pas une eau tiède où se laisser jouir. Kokoro est à la fois cœur, volonté et esprit, l’esprit est dans le cœur, le pragmatique côtoie l’irrationnel, l’individualisme n’a sa place que dans l’esprit de groupe. « Au Japon, l’individualisme signifie que le groupe reconnait en lui le meilleur. Il est alors le maître, le sensei » p. 54. La dureté féodale des rapports sociaux protège une nature sensible et sentimentale ; le féminin est dans le masculin et réciproquement ; l’impermanence exige le devoir. D’où ce sentiment d’étrangeté que nous avons face à un Japonais en son pays. Chacun reste ce qu’il est mais s’ouvre à l’autre par respect.
Nous sommes loin des gijau français qui sévissent de nos jours – uniquement le samedi – ces petits moi en uniforme de gilet jaune, produits à la fois de l’égoïsme moral et de l’inculture de masse brassée par la démission enseignante. Le détour japonais nous aide à le comprendre : « L’individualisme occidental est un mal épidermique de récriminations sans fin au nom des intérêts particuliers des individus et de leurs strictes défenses corporatives. Tous les intérêts particuliers s’opposent en bloc à l’intérêt général » p.54. Dans ce combat de sourds où chacun est méconnu pour ce qu’il est, tant les autres ne voient qu’eux-mêmes, le plus faible est inéluctablement écrasé par le plus fort, le plus raisonnable par le plus braillard, le plus démocrate par le plus fasciste. Le non-conformisme occidental produit ce conformisme bourgeois de « la manif », étalage navrant d’impuissance et d’anarchie qui ne sait pas ce qu’il veut, ne sait pas où il va et n’arrive qu’à détruire sans construire.
L’individualisme japonais s’est incarné dans la figure du samouraï, notamment le ronin sans maître, à la fois très libre et très discipliné – l’un n’allant pas sans l’autre. L’auteur évoque Miyamoto Musashi (1594-1645), qui errait par souci de liberté en cherchant la voie droite, attaché à aucun bien, pas même à la vie. Il n’enseignait qu’à de rares élus sa science du combat, ceux qu’il considérait comme digne de s’épanouir dans cette voie. Sur la route, tout arrive, et cela oblige à la vigilance au présent. Il a gagné son premier combat victorieux à 13 ans mais il tente sa vie durant de transformer sa virtuosité naturelle en sagesse. « La grande simplicité est toujours le résultat d’une harmonie, celle-ci d’une présence à soi et le tout d’une conscience qui ne se laisse capter ni par la distraction ni par la concentration. Travailler avec ce qui est signifie intégrer toutes les qualités physiques, psychiques et spirituelles pour les rendre aussi efficaces et légères qu’un souffle. Le grand art est à ce prix » p.76.
La stratégie n’est pas d’additionner les points forts et les points faibles pour prendre une décision, mais de considérer qui est en présence et quel est le moment. La décision n’est donc pas prise abstraitement, selon des schémas pseudo « rationnels », mais relativement aux esprits en présence qui animent le moment. La conscience que nous avons du mouvement des choses donne le rythme de la décision – or, contrôler le rythme, c’est contrôler l’adversaire : être maître des horloges, dit-on en Europe. Le kendo est l’art du sabre (un bambou à l’entraînement) qui donne aux enfants japonais dès leur plus jeune âge cette aisance du moment, en même temps que l’habitude de mobiliser toutes leurs énergies physique et mentale en un même point, en un seul moment. Ce qui n’est pas le cas du foot, sport populaire européen, où les individualités ont peine à fusionner en équipe et les énergies à converger sur le moment.
« L’esprit du zen enseigne que, si l’homme fait ce pourquoi la vie le désigne, s’il le fait aussi bien que possible, et s’il est libre de toute crainte, alors l’infini est réalité en lui » p.140. Conscience de soi est alors vraie nature. « Eveiller l’âme, donner le goût et la saveur des choses, tel est le sens de l’art japonais » p.154. Il s’agit d’être intensément présent au monde, de sentir les choses dans leur nature même : le thé, la cuisine, la calligraphie, le sabre… Et nom de célébrer le Dieu caché ou d’illustrer l’histoire sainte, comme ce fut trop longtemps le cas en occident.
Cette civilisation japonaise proche de nature est probablement celle qui convient à notre siècle : il s’agit de penser global, en harmonie avec la nature des choses, de goûter la planète au lieu de l’exploiter et de la détruire. Le mental n’est pas impérieux mais paisible comme un objet flottant, jusqu’au moment de l’action. Bien loin des sons de trompe, feux de pneus et autres braillements d’inaptes et d’impuissants.
Michel Random, Japon – la stratégie de l’invisible, 1985, éditions du Félin, occasion €1.90 ou e-book Kindle 2015 €6.99


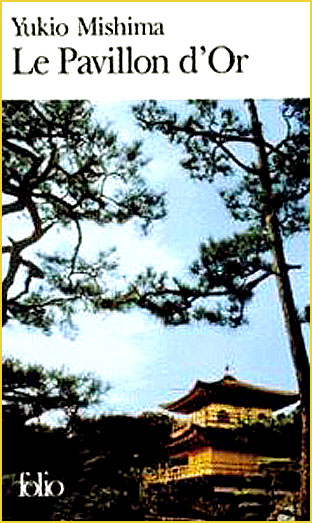

Commentaires récents