La société japonaise est pour nous étrange et familière, comme un à-côté auquel nous avons par miracle échappés. Décentrer notre regard trop français vers l’étranger est une façon de revenir à soi pour observer notre propre société d’un œil différent. Le psychothérapeute Takeo Doï a étudié la matrice culturelle et affective dans laquelle il a baigné et il en retire le concept de dépendance affective, « amae », qui engendre une attente d’indulgence en société.
Il s’agit d’un modèle de relations sociales fondé sur les relations mère-enfant, fusionnelles. Elles sont plus importantes au Japon qu’ailleurs étant donné que le mari et père part chaque matin à 7 h pour ne rentrer que vers 21 h, passant le reste du temps avec ses collègues et ses chefs dans l’entreprise où il travaille.
« A mon avis, c’est dans la mentalité d’amae que, depuis deux millénaires, les Japonais ont puisé les forces émotionnelles qui ont eu un rôle fondamental dans leur développement, qui leur ont donné l’élan nécessaire. Or, apparemment, il a fallu la défaite de la Seconde guerre mondiale pour qu’on s’avise du fait que cette mentalité est d’essence infantile » p.63.
Le Japon est une île, donc porté à l’isolement. Le pays est essentiellement montagneux, séparant les villages dans d’étroites vallées, donc porté à la communauté. La maison est le cocon de la famille, où règne la grand-mère, ce qui resserre les liens entre les jeunes et les matriarches. Le zen même engendre l’idée que sujet et objet ne font qu’un. Le respect fonde un statut sécurisant, l’individu se fond dans le groupe que mène le chef qui, lui-même, dépend de ses vassaux. Le chef ne décide pas, il est le porte-parole de l’unanimité du groupe.
« C’est celui qui incarne la dépendance infantile sous sa forme la plus pure qui est le plus qualifié pour se tenir au sommet de la société japonaise » p.46. Exemple l’empereur, les grands patrons de firmes – mais aussi les enfants et les vieillards qui ont droit à plus d’indulgence que les autres parce qu’ils sont plus dépendants.
La soumission affective aux réactions des autres engendre une attente d’indulgence qui fonde le giri : le devoir, les obligations parents-enfants, maîtres-élèves, chef-troupe, amis et voisins. Cette dépendance exalte le ninjo, le sentiment humain de compassion que vante le bouddhisme et que promeut le zen.
Le revers est la honte. « Le sens de la honte, qui porte avec soi une impression d’imperfection, d’inaptitude, d’insuffisance de sa propre personne, est plus fondamental. Celui qui éprouve de la honte doit nécessairement souffrir de son désir d’amae, exposé aux regards d’autrui » p.44. D’où le taux de suicides mâles élevé au Japon, plus qu’ailleurs. La honte est impardonnable à ses propres yeux.
A l’inverse, quiconque n’a aucun lien avec soi, ni de parenté ni d’obligations, est géré par le tanin : cette indifférente froideur qui frappe dès que l’on débarque au Japon. « Les autres » ne sont pas du cercle d’indulgence réciproque et l’on se conduit autrement avec eux.
La pathologie d’amae, selon l’auteur, est l’obsession et l’immaturité. On a besoin d’apparaître parfait aux yeux des autres parce que l’on dépend d’eux pour sa propre image. La figure de l’autre est crainte. D’où la perpétuelle insatisfaction qui, en contrepartie, motive le zèle au travail. D’où aussi la propension à se comparer, à admirer meilleur que soi, à s’égaler au miroir de l’autre. Ce qui engendre des sentiments homoérotiques vers ceux qui vous ressemblent. Il s’agit moins de pulsions sexuelles, encore que le sexe ne soit ni tabou ni péché, que de narcissisme. L’intimité entre hommes se traduit par la révérence envers le sensei, le maître, le désir étant jeune d’avoir l’air mignon, touchant, digne de protection par les autres (hommes ou femmes).
L’Eglise catholique avait quelque tendance à susciter ces mêmes comportements issus de la dépendance affective. La Vierge Marie étant la Mère à qui l’on son confiait et le curé un Protecteur qui avait une relation directe avec Dieu – et qui pouvait donc se « permettre » des comportements affectifs à la limite du sexe. Ce n’est plus admissible aujourd’hui que la société a évolué, mais peut-être faut-il chercher dans cette dépendance affective longtemps couvée en serre par la bourgeoisie conservatrice catholique ces enfermements affectifs du patronage, des scouts, des collèges et pensions ou couvents.
Un autre trait de ce sentiment d’amae est la mélancolie, l’apitoiement sur un héros défunt. Nous l’avons eu en Occident dans le romantisme comme dans la pratique religieuse où le Christ martyr suscitait des émois empathiques au point d’attraper les stigmates de ses plaies. Ce sentiment victimaire est proche du sentiment d’injustice, d’être en butte aux persécutions, surtout à l’adolescence (voir L’enfant de Jules Vallès, Poil de carotte de Jules Renard, et Vipère au poing d’Hervé Bazin).
Le moi n’est pas construit mais malléable au groupe ; au Japon il ne se construit pas. L’enfant parle de lui à la troisième personne, s’identifiant à un héros imaginaire ou à un être persécuté, se complaisant vers la puberté dans les tortures fantasmées et la mort théâtrale. Le moi n’émerge que par le groupe, sans le groupe l’individu est comme un escargot sans coquille, nu et fragile, croqué par le premier prédateur qui passe.
D’où la recherche éperdue de consensus, qui nous étonne dès que l’on s’immerge dans la société japonaise, mais qui arrive comme une vague dans nos contrées avec les réseaux sociaux, surtout à cette période immature de l’adolescence. « Être d’accord » est le mantra de tous ; la hantise de devoir penser par soi-même et s’affirmer, même gentiment, contre les autres apparaît insupportable.
L’amae ne permet jamais d’être adulte, mûr et responsable de soi et des autres. Les Japonais sont dépendants de leurs familles, connaissances et supérieurs ; les Français sont dépendant de l’Etat-providence qui les materne (trop) et a remplacé l’Eglise pour les empêcher une fois de plus de se prendre en main.
Takeo Doï, Le jeu de l’indulgence, 1973, L’Asiathèque 1991, €23.85

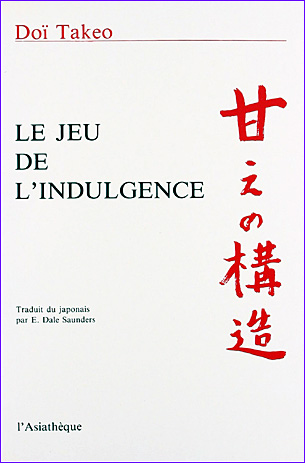

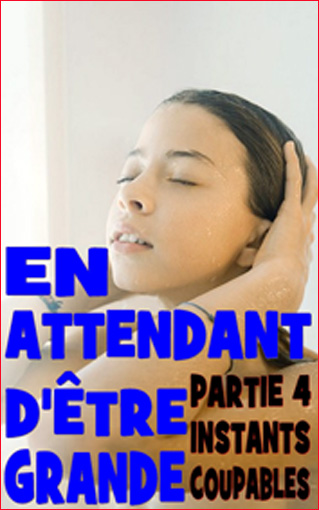


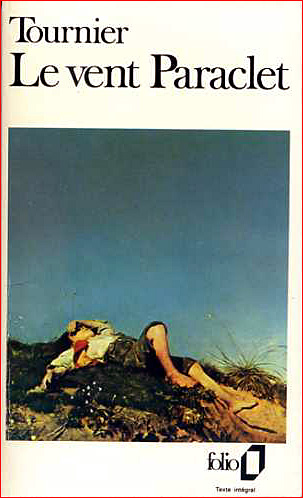
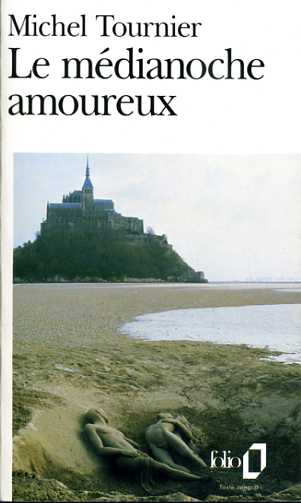
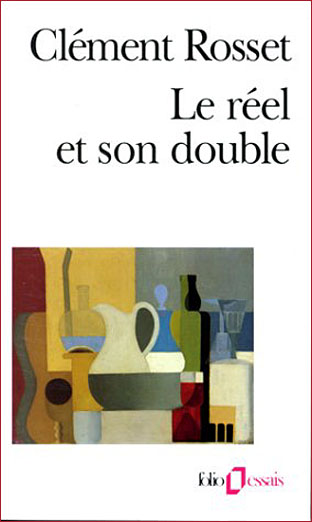
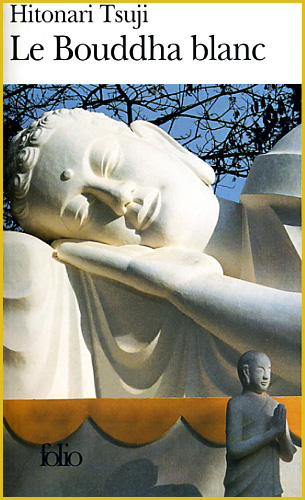

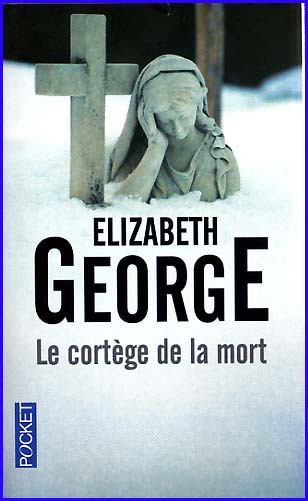

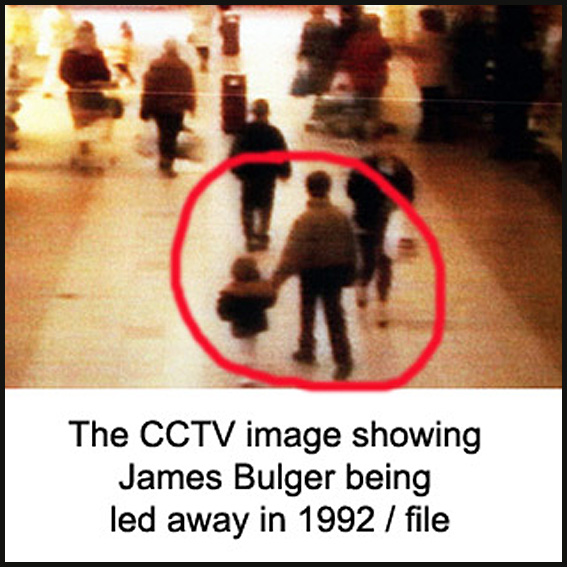


Commentaires récents