Soixante-dix n’arrête pas de s’effacer sous la plume de Jünger, quinze années après celle qui lui a donné son titre. L’auteur va sur ses 90 ans, il écrit de plus en plus d’aphorismes, raconte de plus en plus de rêves, cite de plus en plus des extraits de correspondance. Le lecteur a la nette impression que l’auteur s’assèche et qu’il supplée au manque de vitalité de sa réflexion par une attention minutieuse portée aux détails. Le traducteur parle de « transparence » du grand âge. Le terme est joli, plutôt gentil. En fait, c’est la personnalité qui s’efface devant ce qui advient.
En vieillissant, Jünger intervient de moins en moins. Il n’est plus acteur mais spectateur de son existence. Il rejoint le zen dans son attitude de laisser-être. Les choses sont ce qu’elles sont et, à leur égard, il passe du dynamique au descriptif. Ses références de prédilection sont pour l’immuable : le minéral, le botanique, l’insecte. En ce qui concerne l’humain, il préfère les mythes ou la divination. Le présent ne l’intéresse plus que comme clé pour comprendre l’éternité. « Le pôle opposé au rire, ce sont les mathématiques » p.14. « Je suis l’ami des gens à part qui, dans les situations désagréables, par exemple au feu, se préoccupent de questions accessoires » p.37. La vieillesse est un nouveau feu, un combat : « ce n’est pas la capacité – c’est la libido qui régresse » p.122. L’élan vital se ralentit.
La perception change, on aspire au repos : « On atteint un état de bien-être total lorsqu’on ne sent plus ni son corps ni l’environnement. On l’observe plus souvent chez les animaux que chez les hommes : ils vivent de façon plus naturelle que nous » p.223.
La conscience se focalise sur les grands rythmes, comme si elle voulait se mettre au diapason des mouvements cosmiques. « En tant que résidence de la vie, la terre constitue une exception dans notre système, et peut-être uniquement en lui. Le fait que les anciens considéraient le flux et le reflux comme la respiration de Gaïa ne doit pas être tenue pour une erreur mais pour une autre manière de voir » p.124. De même, « le sens indestructible de l’astrologie ne réside pas dans l’interprétation des destins individuels mais dans le fait qu’elle libère le regard du premier plan historique pour le tourner vers la marche de l’horloge cosmique » p.101. Pareillement pour les dieux : « il ne faut pas considérer les dieux comme des idées – des créations poétiques, ce serait plus juste. En tant que tels, ils atteignent une plus grande crédibilité, également sous forme d’apparitions. Ce sont eux, en fait, qui donnent forme à l’histoire » p.335. D’ailleurs, « le 22 octobre 362, le temple d’Apollon à Antioche disparut dans les flammes. L’incendie criminel, dirigée contre l’empereur Julien, signifia la fin du monde des dieux antiques » p.462.
Aujourd’hui est encore une période de grands bouleversements : « De nouveau, ce sont les modifications géologiques et atmosphériques, la destruction de certaines espèces animales, la menace qui pèse sur notre propre survie. Cela indique une répétition qui s’effectue au sein de cycles très amples. D’où aussi l’impression que nous avons déserté le cadre de l’histoire du monde pour tomber sous le coup des mouvements de l’histoire de la terre » p.129. Nous passerions de l’humain au cosmique parce que notre cycle, celui des titans, s’achève. Le prochain cycle sera plus spirituel, plus soucieux d’être en phase avec le cosmos. « La force d’attraction croissante des œuvres d’art est un symptôme des années que nous vivons – d’une part elle témoigne d’un manque de la force créatrice, de l’autre d’une soif de la rencontrer » p.521.
Il nous faut retrouver l’enfance, la source de vitalité humaine : « je tiens l’enfant pour génial – ce qui signifie : vivant dans un état de nature inaltérée –, au sens de la Genèse, encore intact vis avis de la connaissance. À tout âge, la force créatrice doit revenir puiser à cette source » p.492.
Retour à l’anarque, la grande création d’Ernst Jünger, une biographie faite concept où l’anarchiste est monarque et non bête du troupeau anar. Il explique : « la vérité et l’efficacité ne coïncident que par hasard. La vérité est essentielle, l’efficacité accidentelle. La vérité peut rester inefficace ou même provoquer son contraire. Les âges d’or sont ceux où la vérité et l’efficacité concordent » p.54. Lorsqu’ils ne concordent pas, nait l’anarque. « L’anarque évitera la rencontre avec l’homme borné, mais il ne le heurtera pas de front, car celui-ci tient les choses en main » p.76. On a toujours tort de s’engager car on ne peut rien tout seul contre la physique des masses. On ne peut que se mettre dans un courant. Quand il n’en est pas de sérieux, « le mieux est l’anonymat – on n’a absolument rien à voir à l’affaire – ni pour, ni contre. La prudence s’impose alors, mais seulement comme s’il s’agissait d’un phénomène naturel, par exemple un gros orage pendant lequel il n’est pas recommandé d’aller faire un tour dans la rue (…). La masse n’est ni bonne ni mauvaise, mais tout simplement bête. On peut s’en tirer avec elle à condition de ne pas entrer en concurrence » p.368.
À l’opposé de l’anarchiste et du nihiliste, « l’anarque est un optimiste persuadé de sa propre puissance mais qui connaît ses limites. Il va aussi loin que le permettent l’époque et les circonstances, mais pas plus loin. Il est foncièrement normal ; sa seule particularité est qu’il reconnaît la norme comme sa loi. Il accorde cela à n’importe qui d’autre. En tant que citoyen, il vivra généralement de manière effacée, s’abstiendra de critiquer et son enthousiasmera difficilement. Cela n’exclut pas un rapport bienveillant à l’autorité, fondée sur sa supériorité intérieure » p.422. Le chien est social et conforme, « le chat est anarque – s’il cherche le contact avec nous, c’est dans son intérêt. Il conclut alors avec nous, selon les termes de Stirner, une « association » qu’il peut dénoncer quand il le souhaite » p.476.
Sur le rôle de l’auteur de livres : « Il faut souligner que l’auteur élève son lecteur à un niveau supérieur à la morale du temps. Ainsi le lecteur, sans approuver pour autant la polygamie ni l’esclavage, pourra se transformer l’espace d’une nuit en un Aladin qui commande à des eunuques et des esprits serviteurs, et prend plaisir à son harem. C’est de cette liberté absolue que vit la grande littérature, et en particulier la tragédie » p.353.
Quant à écrire un journal, il est un témoignage, une borne dans le temps : « Tout journal a pour perspective d’être publié, s’il atteint l’âge nécessaire. Après cent ans passés, il acquiert déjà une dimension historique qui s’accroît de plus en plus. Ce qui serait précieux dans un autre sens que celui du compte-rendu personnel, ce serait de fixer, décennie après décennie, le déroulement d’une journée. En ce domaine, les événements habituels sont plus importants que les événements inhabituels, et les faits plus importants que les opinions » p.322.
Message pour un lecteur qui lui écrit et lui demande ce qu’il est nécessaire de lire : « Lisez Hésiode et l’Edda, ainsi que l’Apocalypse, Isaïe et Jérémie – ils sont actuels » p.390.
Ernst Jünger, Soixante-dix s’efface 1981–1985, tome 3, Gallimard 1996, 579 pages, €29.40

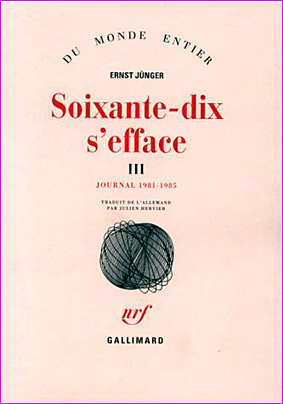
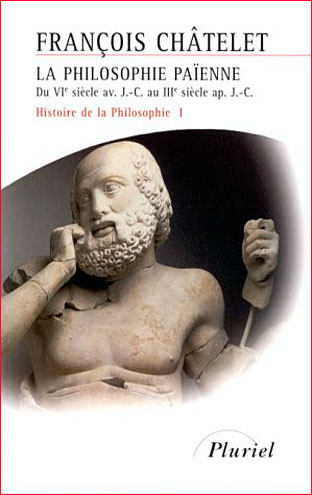
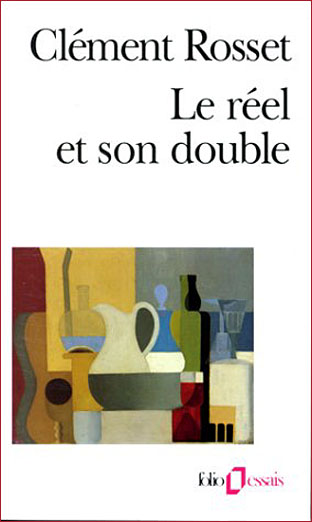
Commentaires récents