Vaste programme ! Le livre du professeur honoraire de 73 ans Guy Vallancien est une gageure. Son auteur est chirurgien urologue et pionnier de la robotique chirurgicale en France, membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie, fondateur de la Convention on Health Analysis and Management et de l’École européenne de chirurgie, membre de l’Office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Beaucoup d’éminent titres pour un ambitieux essai qui ne vise – pas moins – qu’à retracer la lignée, des particules subatomiques à la conscience compassionnelle humaine.
L’être humain n’est qu’un maillon d’une chaîne et évolue par mutations pour s’adapter sans cesse à l’univers qui change. Sa visée est la vie, tout simplement, l’élan qui pousse sans raison, juste parce que le vital est ainsi fait. Ceux qui croient peuvent aller au-delà, pas le scientifique qui se limite à constater ce qui est. La vie se développe et se répand par autonomie, fraternité et auto-organisation. C’est ainsi de la cellule à l’homme, et l’animal sapiens ne fait exception que parce qu’il va encore plus loin, ajoutant la compassion.
Notre état de conscience supérieur nous permet d’être méchant gratuitement, mais aussi plus sociable que les espèces animales, dépassant la « loi naturelle » (concept humain) qui fait du plus apte le survivant par excellence. Notons cette réflexion qui nous vient à la lecture du livre : les Américains en sont restés à la loi du plus fort, ce qui rend leur égoïsme implacable et puissant ; mais les Européens sont peut-être en avance dans l’Evolution de la conscience, puisqu’ils donnent à la compassion et à l’entraide une valeur supérieure. L’auteur ne le dit pas car son essai manque de clarté. Il veut trop embrasser et mal étreint. Ses huit chapitres sont inégaux, les premiers utiles en ce qu’ils retracent brillamment la genèse de l’éclosion humaine depuis les origines de l’univers, avec forces références et exemples, les suivants touffus et parfois inutilement polémiques.
La robotique et ladite « intelligence » artificielle (qui n’apparaît que comme la programmation intelligente des concepteurs humains) viennent comme un cheveu sur la soupe et l’auteur ferraille avec les admirateurs et autres croyants de l’humanité « augmentée ». Faut-il « repenser » notre nature humaine comme il le prône ? Notre savant retrouve benoitement les trois étages de l’humain que les Antiques, puis Pascal (les trois ordres) et Nietzsche (chameau, lion, enfant) entre autres, distinguaient déjà : les sensations, les émotions, la raison – avec la charité (Guy Vallancien dit la compassion) en supplément d’âme ou comme propriété émergente de la raison sociale.
S’agit-il d’un essai polémique contre l’IA et les néo-croyants du Transformisme ? S’agit-il d’un essai de scientifique pour tracer une philosophie de l’évolution humaine ? On ne sait trop. Les propos rigoureux, étayés d’exemples de recherches, voisinent avec des raccourcis critiques sur l’actualité et un chapitre 7 incongru sur la bêtise en réseau. « Que reste-t-il dont j’aurais la certitude ? Pas grand-chose ! » avoue-t-il p.233 dans son trop délayé « Point d’orgue » en guise de conclusion. Le livre n’est pas abouti et c’est dommage, car le lecteur est frappé par d’excellentes remarques ici ou là.
Tel le « séquençage de centaines de jeunes Chinois ‘surdoués’ au QI de plus de 130 pour y rechercher le secret d’une intelligence dite supérieure à transmettre aux autres (chinois, bien-sûr), comme semble y travailler l’équipe du Beijing Genomic Institute de Shenzhen ? Course absurde au toujours plus. Quand on aura mesuré le QI des cons à 120, les QI moyens seront à 180 et les supérieurs à 250. Qu’aurons-nous gagné ? Une augmentation du nombre d’individus atteints du syndrome d’Asperger, une forme d’autisme qui se caractérise par des difficultés significatives dans les interactions sociales » p.103. Sans compter que « le QI » ne mesure que la conformité des esprits au formatage des tests et ne préjuge en rien de « l’intelligence » au sens global de la faculté à s’adapter à tout ce qui survient.
Quant à « la conscience », dont les religions du Livre font un souffle de Dieu, elle « serait consubstantielle à la matière depuis l’origine de l’Univers, l’esprit émergeant progressivement des appariements particulaires, du bouillonnement moléculaire, des interactions chimiques et des collaborations biologiques » p.146. L’humain apparaît donc comme un être émergeant de la masse vivante, pas un dieu tombé sur la terre ; nous sommes fils des étoiles et non d’un Être mythique, projection machiste du Père et Mâle dominant, élu maître et possesseur de tout ce qui vit et pousse sur la planète. Les Idées pures platoniciennes ne sont qu’une image mentale et le « je pense donc je suis » cartésien doit être remplacé par le « je ressens donc je deviens » pour se sublimer en « j’aime donc je suis » – qui forme un meilleur titre que le trop pesant A l’origine des…
Car par la génétique, la physiologie et la culture, nous, être humains, sommes avant tout « des êtres d’émotion, d’attention et de collaboration, depuis les éléments galactiques les plus lointains jusque dans les plus petits recoins de notre anatomie… » p.248. Ce qu’aucun algorithme ne pourra jamais devenir.
Guy Vallancien, A l’origine des sensations, des émotions et de la raison – J’aime donc je suis, L’Harmattan 2019, 248 pages, €25.00 e-book Kindle €18.99
Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

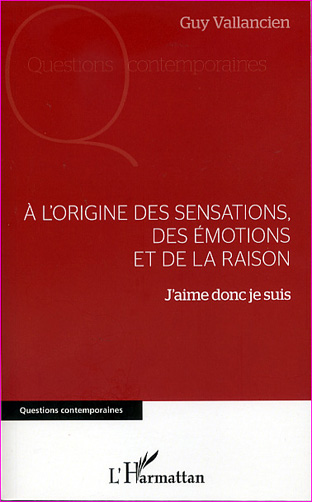
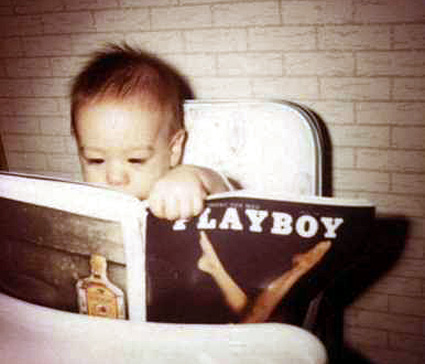
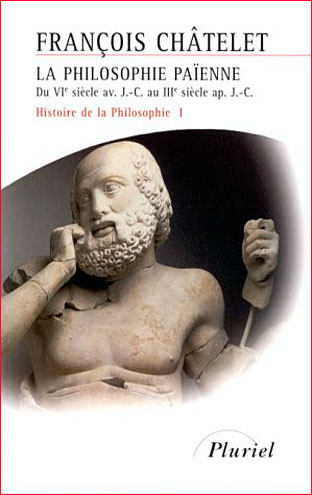



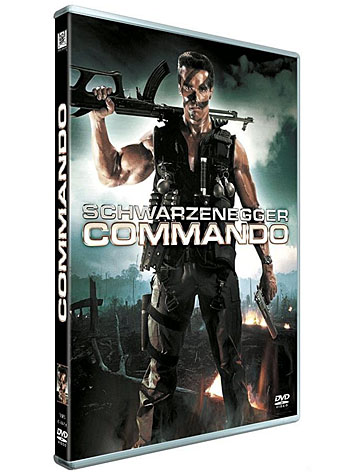



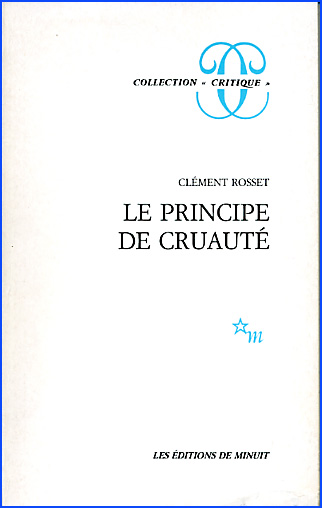

Commentaires récents