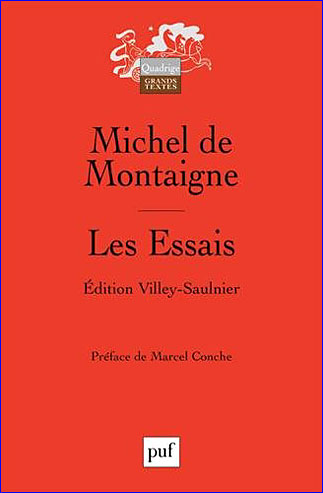
Montaigne était un auteur du programme de français au lycée. On l’étudiait par fragments en seconde, un peu rebuté par son vocabulaire archaïque à un âge où l’on pense à autre chose. J’en garde le souvenir d’un auteur à la sagesse sympathique mais peu philosophe et peu actuel. Ô combien j’avais tort ! A 15 ans, j’étais plus préoccupé par les amours. Il faut laisser passer les années pour découvrir Montaigne.
Il est mort le 3 septembre 1592 et cet anniversaire de quatre siècles a suscité quelques commémorations. Une émission sur France-Culture, un quart d’heure au réveil chaque matin du mois d’août 1992, m’a donné le goût de le relire. Elle était réalisée par André Comte-Sponville, un philosophe à peu près de mon âge duquel je me sentais proche. Avant de plonger dans le texte brut, une fois n’est pas coutume, j’ai désiré me mettre l’eau à la bouche en lisant quelques textes accumulés dans ma bibliothèque sur cet auteur tout d’affinités : Montaigne d’Elie Faure (1923), Montaigne par Stefan Zweig (1942), Montaigne par lui-même de Francis Jeanson (1951), Montaigne ou la philosophie vivante dans Une éducation philosophique d’André Comte-Sponville (1989).
C’était vingt ans après l’avoir rébarbativement « étudié » au lycée. J’ai retrouvé sa sagesse sympathique mais, contrairement à mes 15 ans, j’ai considéré qu’il est un maître en philosophie, moins théoricien qu’adepte de la vie bonne, et qu’il est éminemment actuel – ou plus précisément inactuel, de tous les temps.
Montaigne est un philosophe né d’une époque de troubles. Fils d’un anobli de fraîche date, ex-marchand de poissons bordelais, aux origines peut-être en partie anglaise par son père et juive par sa mère issue de courtiers convertis venus d’Espagne, il passe sa vie en pleine guerre civile pour la religion, au moment où l’Amérique vient d’être découverte. Tout cela pouvait le forcer à choisir son camp et à le servir par conformisme, mimétisme ou fidélité. Il n’en a rien été. Il s’est plutôt retiré de la scène, préférant la curiosité, la tolérance, la modération. Il a servi son roi mais en gardant son quant-à-soi, catholique de raison mais guère de foi.
Il a été aimé dans son enfance par un père attentif à le bien éduquer, sans forcer son désir. Il a connu l’amour des femmes dès sa plus tendre puberté puis, jeune homme, le bonheur d’une amitié rare avec La Boétie. L’humeur mélancolique venue de la mort trop jeune de son ami lui a « mis en tête cette rêverie de se mêler d’écrire ». Comme tout homme solitaire et de faible mémoire des noms, lieux et dates, l’écriture a tenu le rôle d’amie, à la fois confidente et miroir, mémoire et chronique d’une vie. « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Ce sont moins les faits qui comptent que la manière de les penser et de les vivre. Le style est inimitable parce qu’éminemment personnel. Les Essais sont exemplaires, matrice des journaux et carnets des auteurs à venir.

Les spécialistes distinguent trois périodes chez Montaigne : 1/ la connaissance de soi, l’étape stoïcienne ; 2/ la connaissance de l’homme, le doute sceptique ; 3/ la pratique de soi, l’amour de la vie.
La période stoïcienne est celle où Montaigne commente les auteurs anciens. Ils sont hautains, inaccessibles, c’est une « exagération de sagesse ». Les superbes philosophies et les comportements surhumains sont illusions. Montaigne décrit son moi et il n’est pas d’un surhomme mais d’un homme simple. De même son style ne plane pas dans les hauteurs du jargon : « Le parler que j’aime, c’est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu’à la bouche ; un parler succulent et nerveux, court et serré, non tant délicat et peigné comme véhément et brusque ». Le style, c’est l’homme même. Et son style est sa philosophie. Il « écarte de lui les idoles capitales de la vérité, de l’immortalité et du bonheur qui permettent au commun des hommes de vivre sans réfléchir, et de maudire la souffrance plutôt que de tenter d’apprendre à s’en servir », dit Elie Faure. Ce que Montaigne retient de la sagesse antique est la force que procure la liberté intérieure. La puissance vitale des passions est germe des vertus – et la plus haute des vertus est celle d’équilibre. « Le vice (…) n’est que faute de mesure ».
La période sceptique est celle où il en vient à récuser tous les dogmes, tous les préjugés, toutes les éducations parce que l’expérience de chaque homme est unique et qu’elle seule vaut pour lui. « La vie n’est de soi ni bien, ni mal ». Les rencontres avec les autres, les lectures, les voyages, aiguisent la faculté de jugement parce qu’ils provoquent la réflexion personnelle. Le spectacle de la diversité engendre la perception de ce qui, en chaque homme, est commun à tous, et de ce qui est unique. La vérité ne peut être que relative, ici et maintenant ; elle peut servir d’exemple, non de dogme. Le doute seul, placé au seuil de la connaissance, peut y introduire le jugement. La science fixée ne travaille « qu’à remplir la mémoire » et laisse « l’entendement et la conscience vides ». La vertu la plus éminente de Montaigne, en cette période est l’exigence de sincérité sur soi. Si une sagesse humaine est possible, elle ne peut se concevoir que dans les limites de l’humaine condition. « Les plus belles vies sont, à mon gré, celles qui se rangent au modèle commun et humain, avec ordre, mais sans miracle et sans extravagance ». Nous ne saurions être dieu ; notre être, dans sa nature profonde, échappe à notre connaissance et notre existence est soumise à ce qui vient de la « fortune » (le hasard). Ce sont les prétentions de notre esprit qui introduisent en notre vie incertitude et discorde. Notre existence est rendue absurde par l’illusion de pouvoir découvrir quelques valeurs transcendantes. Dès lors, « nous pensons toujours ailleurs », nous ne vivons jamais « à propos ». « A quoi faire ces pointes élevées de la philosophie sur lesquelles aucun être humain ne peut rasseoir, et ces règles qui excèdent notre usage et notre force ? » La nature commande, le sage l’accepte. Nous qui ne sommes qu’humain, vivons en humain – ni ange, ni bête. Le corps comporte en lui-même sa sagesse, qui est amour du plaisir et de la joie. Le secret du bonheur est simple : « étendre la joie » et « retrancher autant qu’on peut la tristesse ». Voilà tout Montaigne désormais : « La plus expresse marque de la sagesse, c’est une éjouissance constante ; son état est comme des choses au-dessus de la lune : toujours serein ».
En son ultime période, il est lui-même. Il aime la vie, parfait à la bâtir en acceptant sa « folie ». Il aime les êtres comme ils sont, avec respect, lucidité, acceptation légère, joyeuse. « La plus grande chose au monde est de savoir être à soi ». Elie Faure résume cette sagesse avec lyrisme : « L’essentiel est de ne pas perdre de vue qu’il y a en nous une forme supérieure de nous qu’il n’est pas impossible d’effleurer de temps à autre, ne pas ‘feindre une vérité’ qui n’est pas notre vérité, de connaître que nous sommes faibles pour épier notre faiblesse et éviter ses traquenards. Laissez les livres et les mots, regardez-vous, cultivez-vous. Que votre fermeté devant le néant et la vie ne vienne pas des recettes que vous recevez d’autrui mais des réalités d’enthousiasme à la vivre et d’imagination à le peupler qui n’appartiennent qu’à vous ». Nulle morale mais une éthique, c’est-à-dire une conscience personnelle qui n’ignore pas la morale commune de son temps et de son peuple, mais qui la juge et la pèse, la filtre à sa propre expérience et la rend relative. Il faut régler sa vie avec intelligence, ordre, mesure, authenticité, lucidité, tolérance. « Nature est un doux guide, mais non pas plus doux que prudent et juste ». Pour saisir la vie à chaque instant, il faut être en pleine adéquation avec elle. Il faut être « juste » comme sonne un accord musical, en harmonie avec l’existence. C’est pourquoi la vérité est toujours préférable au mensonge ; elle rend libre parce qu’elle met en accord l’être et le monde. « Nous sommes partout vent », et vent est sagesse, ou plutôt sage est le vent parce qu’il est mouvement, qu’il passe et emporte.
Cela est un « savoir vivre ». « Il n’est rien si beau et légitime que de faire bien l’homme et dûment, ni science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie ». La sagesse de chacun n’est issue que de la vie même de chacun ; celle de Montaigne est un exemple à suivre. Comme tout maître, il faut le quitter pour devenir soi.
« J’ai mis tous mes efforts à former ma vie. Voilà mon métier et mon ouvrage. Je suis moins faiseur de livres que de nulle autre besogne. » La mort viendra, mais elle est une fin, non un but. « La vie doit être elle-même à soi sa visée, son dessein ». Michel de Montaigne est un maître en art de vivre ; il se donne tout entier à ce qu’il fait, en son présent. Car le temps passe et l’existence nous est limitée. « Je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie ».
Faisons comme lui, imitons-le en sa sagesse humaine : « Ma philosophie est en action, en usage naturel et présent, peu en fantaisie ».
Montaigne, Les Essais, édition Villey-Saulnier avec préface de Marcel Conche, notes et explication sur les termes et expressions de l’époque, d’une chronologie sur la vie et l’œuvre, d’un appendice sur l’influence des Essais, d’un index et de la liste des inscriptions portées sur les murs de la librairie, PUF Quadrige 2004, 1504 pages, €46.00
Montaigne, Les Essais, Folio 2009 coffret 3 volumes, 2208 pages, €25.00
Montaigne textes choisis et commentés par Marie-Madeleine Fragonard, professeur de littérature française à l’université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), Pocket 2009, 544 pages, €5.50
Montaigne, Les Essais, Gallimard Pléiade 2007, édition Jean Balsamo, 2080 pages, €80.50,






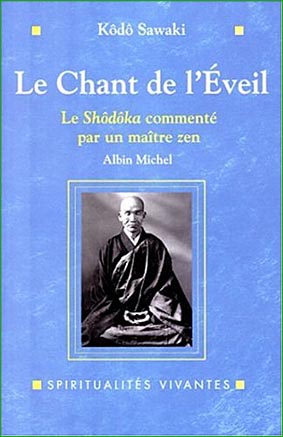
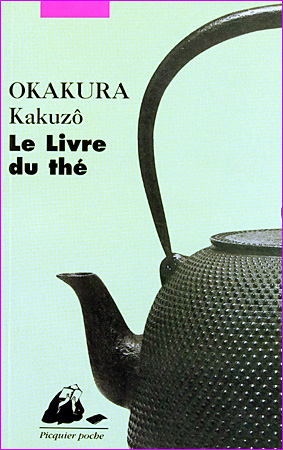
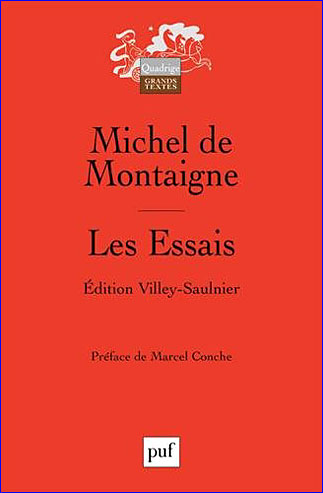






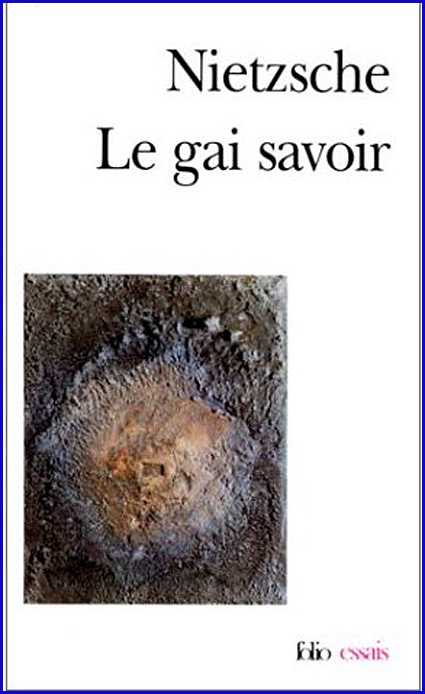

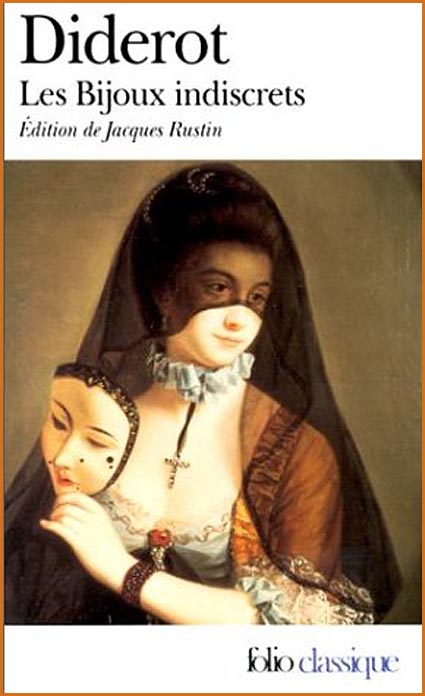

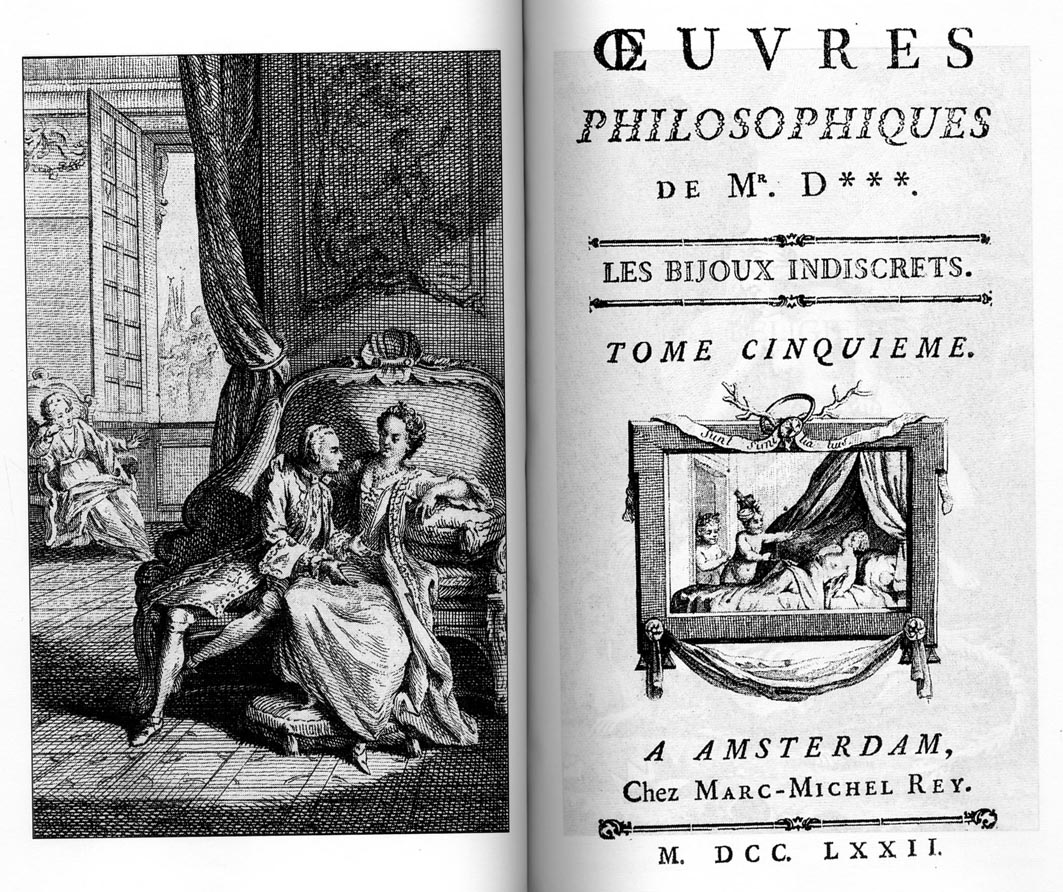




Commentaires récents