Forgé par l’amalgame de bossu et voussure, le terme « boussu » désigne aussi une commune francophone de Belgique dont l’étymologie latine signifierait ‘riche en buis’. Mais le mot choisi par les auteurs décrit une mutation génétique qui affecte deux vertèbres cervicales, courbant la tête vers la terre. Ces mutants mal vus de par leur silhouette connotée servile dans l’imaginaire, représentent désormais près de 5% de la population ; ils augmentent lentement sans que l’on sache pourquoi, et risquent d’atteindre un tiers des naissances d’ici 50 ans. D’où la question : comment faut-il traiter ces déviants dans une société « normale » ?
Le bal de la bonne conscience de gauche se tortille en règlements administratifs alors que les rangs serrés des « civistes » adeptes du sang et du sol se déchaînent en pressions politiques et milices armées. La majorité silencieuse évidemment se tait, bien aise de voir régler le problème par des mesures réglementaires.
Les auteurs emmènent le lecteur dans un autre univers, parallèle au nôtre et qui en est un futur possible. Ils rejouent Orwell en le situant – on peut le supposer – vers 2024 (2084 serait trop éloigné). La fable montre combien la frilosité et le repli sur soi, enrobés de contorsions moralement correctes, peut faire dériver notre société.
Dans le premier tome de ce qui s’annonce comme une saga, le personnage de Téléman, médecin fonctionnaire à la Direction territoriale de prévention (aucun rapport évident avec le musicien), se trouve confronté à un nouveau décret en application d’une loi générale « d’orientation sur les personnes génétiquement différentes » votée par un Parlement préoccupé par l’évolution de la société. Faut-il discriminer ? Noyer les Boussus dans la masse des handicapés ? Assurer des quotas ? Soigner le mal à la racine par un dépistage systématique ? Le temps que les politiciens discutent, que les bonnes consciences se torturent, le terrain s’en mêle. Et voici Téléman embarqué dans une fuite de Résistant à l’Occupation des civistes qui veulent faire un sort au couple voisin, Harold et Ariane, tous deux Boussus.
Nous sommes entre Amiens (Ambiène), Abbeville (Hâble-Vil), Saint-Valéry (Saint-Yvarel) et Le Crotoy (le Croc-Droit), dans cette baie de Somme (l’Osmose) de la région de Picardie (Pluie-Cordiale), à une époque où le réchauffement climatique (l’ère Chaud) a changé le paysage. On se salue d’un ‘Soleil à vous’ ou d’une ‘Bonne lune’ tandis que tout à l’air d’être pour nous normal. Même la technique n’a guère évolué.
Si la qualité d’un roman, même d’anticipation, ou d’une fable morale, se mesure par son action, sa psychologie, son histoire et son style, celui-ci mérite la moyenne. Il manque de rebondissements, les personnages aimant par trop étaler leurs états d’âme d’intellectuels dépressifs ; il manque d’approfondissement psychologique, seuls Téléman le célibataire et Ariane la future mère sont un peu plus fouillés. Mais l’histoire est originale, décalque la réalité présente dans un univers proche, et promet pour la suite. Quant au style, il reste assez plat, seuls les jeux de mots sont agréables aux oreilles françaises, mais exigent une carte pour ceux qui connaissent mal l’Hexagone (il y en a même à l’ENA !) et restent à peu près incompréhensible aux étrangers.
La retransmission de la novlangue administrative et de la stratégie politiquement correcte est cependant un délice pour tous ceux qui ont pénétré un jour les arcanes de l’Administration : l’art de traduire les exigences hiérarchiques par le découpage de l’action requise en mesurettes acceptables, en enveloppant le tout de grands mot-valise ou de jargon médical, en donnant à chaque exécutant une tâche à sa portée selon ses convictions.
Les Boussus sont considérés comme des handicapés, voire des bougnoules ; le parti civiste ressemble furieusement au Front national version nervis ; les politiciens 2009 (date de la parution du livre) agissent comme celui qui deviendra Normal Premier – c’est-à-dire sans projet autre que de suivre l’opinion, de bavarder sur rien avec un éternel sourire, de faire passer des réformes ni faites ni à faire en déclarant que tout va bien. Du grand art.
Mais le lecteur est alléché par ce qui sourd peu à peu du roman : le Boussu est moins vil et niais qu’il n’y paraît. Ne serait-il pas une nouvelle espèce humaine mutante, analogue à l’homo sapiens face à l’homo neandertalensis ? Même courbé vers la terre, en attitude apparente de soumission, le Boussu pense, et même collectivement grâce à la télépathie. Il est plus fort parce que relié en réseau mental, il connait plus de choses parce qu’il partage sans gadget de communications, il est plus solide parce que l’empathie de ses semblables l’entoure. On le dit stérile, les grossesses s’interrompant en général vers le cinquième mois. Mais est-ce la pleine réalité ? Est-ce une infirmité provisoire en train d’évoluer ?
Tout le suggère… pour la suite. Dans une prochaine chronique.
Pierre Thellier et Jacques Vallerand, BoussuS – Première époque : Le fils d’Ariane, 2009, édition Les soleils bleus, 222 pages, €8.93
Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 balustradecommunication@yahoo.com

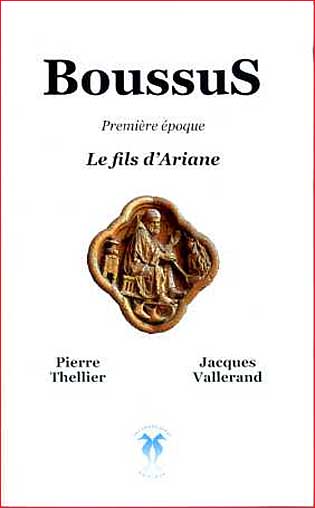
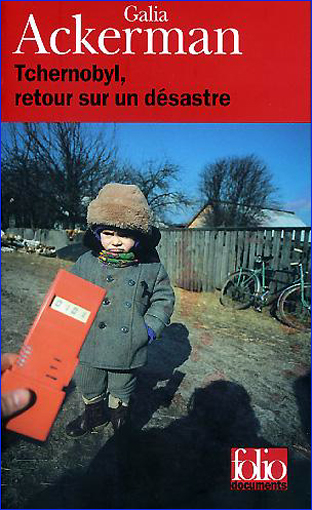


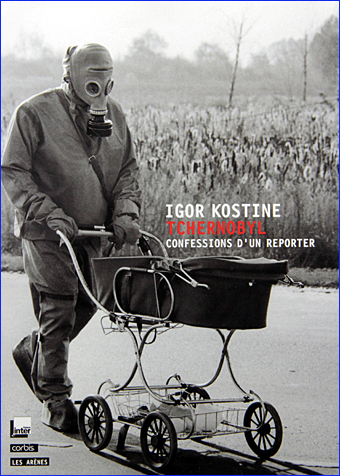
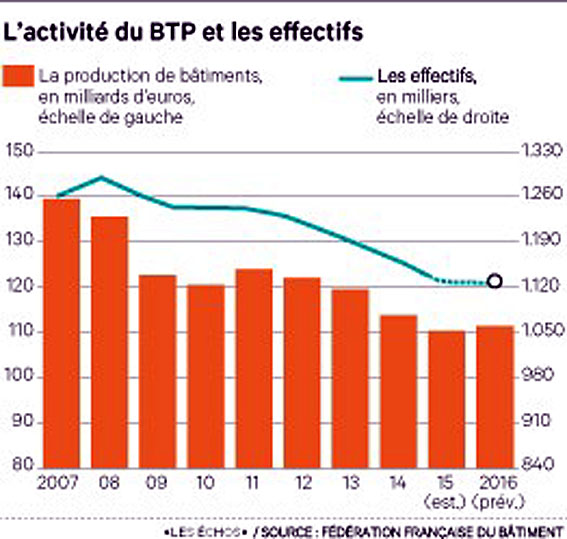
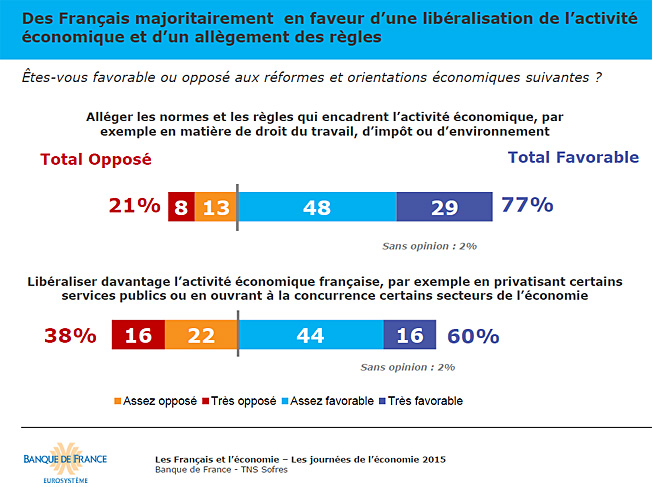
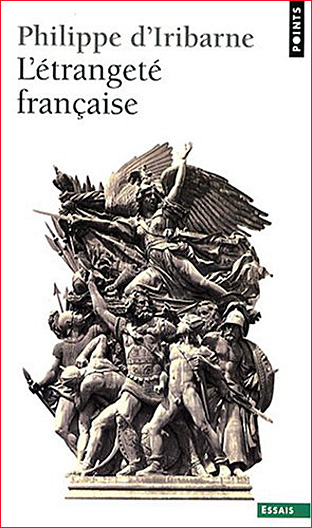


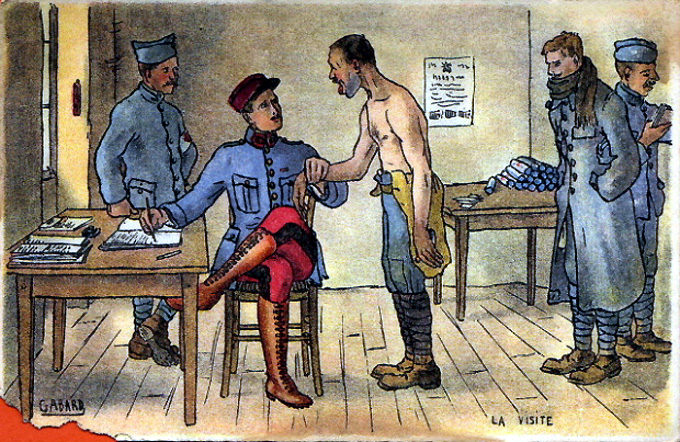
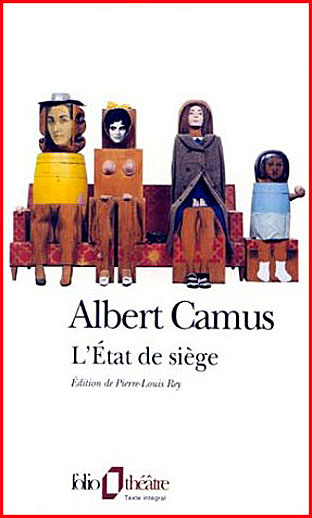





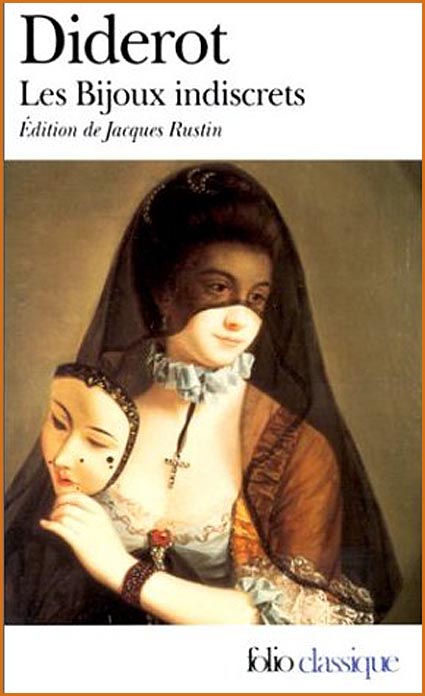

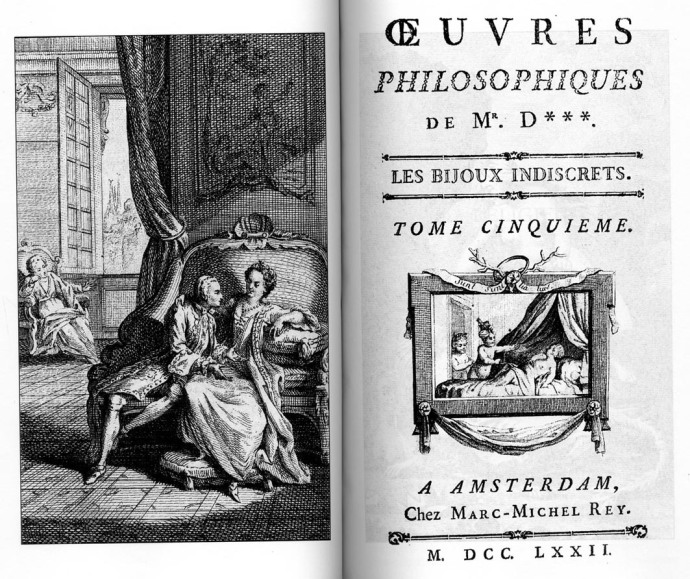
Commentaires récents