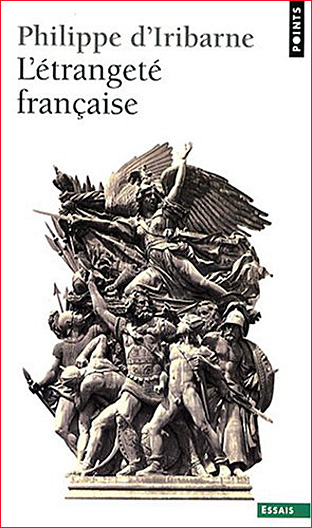
Philippe d’Iribarne est ingénieur général du corps des mines, Polytechnicien et Science Po, directeur de recherche au CNRS. Il dirige depuis 1972 le centre de recherche sur le bien-être devenu Gestion et société. Ses travaux, dans la suite de La logique de l’honneur (1989) ont donné en 2006 ce second livre. L’auteur identifie en premier lieu « l’univers mythique » propre aux Français avant d’examiner le « modèle social en crise », puis de traiter de diverses « questions de société » (l’école, les immigrés, « notre » modernité).
La liberté se décline en France différemment des autres pays. Le monde anglo-saxon la voit dans la figure du propriétaire dans les bornes de la loi. La liberté allemande est d’avoir voix au chapitre dans une communauté. La liberté française est obnubilée par l’univers d’Ancien régime, liant la liberté à la noblesse et à l’honneur. « Cette vision (…) est porteuse d’une sensibilité exacerbée à ce qui est facteur d’humiliation ou au contraire source de grandeur » p.40. Ne sommes-nous pas bizarres ?
« On trouve en France la conception de la grandeur propre à une caste attachée à son rang, qui ressent comme une atteinte insupportable toute demande d’effectuer des actions indignes de celui-ci » p.49. Citons pêle-mêle les cheminots qui se sentent investis d’une mission de « protéger » le rail et les trains de quiconque (de « la direction » comme « des usagers »), les conservateurs de musées qui se sentent quasi « propriétaires » des œuvres confiées à leur garde, l’artisan qui « sait » mieux que le client ce qu’il lui faut, l’élite jalouse de « l’information » qui est son privilège de pouvoir…
Cette façon de voir apparaît ridicule aux yeux des Allemands pour qui les Français sont ainsi soumis au regard social, au conformisme de caste, et ridicule aux yeux des Anglais pour qui les règles de la liberté comptent plus que la « noblesse de métier ».
D’où cette curieuse façon de la société française qui s’organise en ghettos d’habitat, en écoles privées, en Grandes écoles fermées, et à qui s’opposent les réactions des humiliés qui dégradent leurs HLM, brûlent les écoles et caillassent les pompiers. « C’est que, quand il est question de ce qui est déclaré ‘bas’, ‘vil’, ‘dégradant’, on n’est pas seulement dans le registre des intérêts ou du pouvoir. On pénètre dans celui de l’impureté, du rejet qu’elle suscite, de l’indignité qui lui est associée » p.57.
Proust notait ce snobisme social : l’art sacralisé sort des contingences de ce bas monde, la gloire des œuvres durables et des lignées (ou des ancêtres) est vénérée. Tout comme Bourdieu dans La Distinction oppose ‘distingué’ et ‘vulgaire’ : « l’ouvrage laisse voir, animant les diverses stratégies de ‘distinction’, la recherche d’une manière d’être ‘pur’ qu’il est difficile de réduire à une utilisation stratégique des diverses formes de capital, économique, social ou culturel, que chacun possède » p.71. A l’inverse, « aux États-Unis l’attachement à ce qui est noble, sous ses diverses facettes, non seulement ne constitue pas un repère partagé mais est considéré comme incompatible avec les idéaux démocratiques » p.78. Pan sur notre arrogance ‘progressiste’ !
La caste ‘à la française’ ne recouvre pas seulement la hiérarchie du pouvoir et de l’argent mais tout ce qui est considéré comme ‘grand’ opposé à tout ce qui est considéré comme ‘bas’. « Non seulement la Révolution française n’a pas balayé la conception aristocratique de ce qui est noble, mais celle-ci a prospéré dans la France républicaine » p.86. Et surtout socialiste !
Des exemples ? « Ainsi, au sein de l’école, la référence à ‘l’élitisme républicain’ est toujours vivante. Dans le monde du travail chacun, professeur, conducteur du métro, membre du Conseil d’État ou autre, se conçoit comme membre d’un corps dont il partage les privilèges et est prêt à assumer les devoirs. L’attachement à un statut garanti par la loi, loin d’être l’apanage des plus favorisés, a pénétré le corps social dans ses profondeurs » p.87. Alors que la Suède, loin d’être « libérale » pourtant, a supprimé le statut garanti à vie de la fonction publique…
Le discours égalitaire bute sur ce fait tout simple qu’il existe des sans-travail, des précaires, des sans-statuts. Dans la conception française, ils sont « naturellement » méprisés, comme entachés d’une tare ‘diabolique’ ou ‘héréditaire’, puisque dans l’ordre du non-noble – donc de l’ignoble. D’où l’excès du militant généreux qui en rajoute pour se faire pardonner sa ‘distinction’. « Dans une sorte de symbiose conflictuelle entre le désir de grandeur et l’idéal d’égalité, la France d’aujourd’hui vit dans une contradiction permanente. D’un côté, dans un registre juridique et politique, elle a proclamé solennellement que la notion de noblesse n’a plus cours et que tout citoyen est l’égal de tout autre. Mais, simultanément, dans un registre social pour lequel il existe un abîme entre ce qui est noble et ce qui est bas, cette égalité est quotidiennement bafouée » p.91.
D’où la crise du modèle français. Clients et supérieurs « sont rejetés sans ménagement » p.96, « les responsabilités dont (le travailleur) s’estime investi ont leur source dans son métier, dans le fait qu’il est ‘technicien’ », p.97 « avoir un métier c’est appartenir à un corps, s’inscrire dans la grandeur d’une tradition porteuse d’une forme d’honorabilité que l’on a le devoir de maintenir, à la fois en en étant digne, et en s’opposant à ce qu’on manque de respect à son égard » p.98.
- Toujours cette idée d’exception et de privilège, qui était le propre de l’Ancien Régime…
- Toujours ce mépris à peine voilé pour « le client » (qui n’a qu’à prendre ce qu’on lui donne) et pour « la direction » (qui se croit maître alors qu’elle ne « sait » rien de ce qu’il faut).
- Toujours cette « humiliation » passionnelle dès que l’un ou l’autre, ou l’étranger, remet en cause ce qui est perçu chez nous comme « noblesse » mais qui est perçu à l’étranger comme une arrogance au regard du monde qui bouge et de la technique qui va.
En Suisse, en Allemagne, on cause beaucoup mais on recherche un accord entre pairs, dans le rationnel ; en Angleterre, aux États-Unis, chacun agit selon les règles et l’employé se voit fixer des objectifs qu’il négocie. Pas en France où « mettre son point de vue dans sa poche sans le défendre jusqu’au bout, ne serait-ce que dans une sorte de ‘baroud d’honneur’ si on est sûr que son avis ne sera pas suivi, est facilement perçu (…) comme le signe d’un manque singulier de conviction » p.108. Aux États-Unis, pour le client c’est le résultat qui compte, en France la beauté du raisonnement – un vrai choc culturel ! D’où « l’échec de Paris face à Londres dans sa candidature à l’organisation des jeux Olympiques » p.118. Savoir vendre ses avantages sans faire confiance a priori à la qualité de son produit est quelque chose que les Français ont du mal à apprendre.
A l’inverse, « ne pas avoir à obéir à un patron, n’avoir pas besoin de se vendre à un client, n’être au service que de l’intérêt général, c’est-à-dire en quelque sorte avoir une mission reçue d’en haut, pouvoir faire bénéficier de sa bienveillance ceux en faveur de qui on agit, sans avoir à tendre la main pour qu’ils vous rétribuent, autant d’éléments d’un service éminemment noble » – celui du service public p.122. Surtout pour ceux qui n’ont ni « vrai métier » reconnu, ni « noblesse scolaire » significative, les définitivement ‘moyens’, le service public donne une « noblesse » de rang qui valorise, tout en assurant divers « privilèges » qui donnent le sentiment d’être « quelqu’un ». Cela, certes, est respectable, mais combien conservateur, immature !
Ne pas dépendre signifie le plus souvent avoir de fortes difficultés à nouer des relations avec les autres ; ne pas se vendre signifie le plus souvent ne pas communiquer ses atouts et ses qualités en attendant que Sirius les reconnaisse tout seul ; ne pas s’adapter à la demande, aux exigences du monde, signifie le plus souvent ne rien créer, se contenter de la routine, s’enfermer dans ses procédures et règlements. Pas très efficace dans le monde ouvert qui devient le nôtre…
Au contraire, « c’est en libérant l’économique de mille entraves que fait peser sur lui une vision archaïque du social que l’on réunira les conditions nécessaires pour mener des politiques sociales dignes de ce nom, tournées vers la construction de l’avenir et non vers la conservation du passé » p.173. Mais point de fatalisme ! « La lucidité est un obstacle au rêve, elle ne l’est pas à l’action. » p.188
Échapper au cercle vicieux français suppose de renoncer à sacraliser le statut, mais aussi le marché. Chaque pays est libre de trouver sa propre cohérence entre la gestion efficace de l’économie et sa politique sociale volontaire. Il faut pour cela que le Politique reprenne sa prérogative qui est l’intérêt général : l’économie est le levier de la puissance, le nerf de la guerre ; avec ce levier, on applique la politique que l’on veut aux catégories qui en ont le plus besoin.
Sans l’économie, au contraire, on ne peut rien – que discourir à l’infini en n’émettant que du vent !
Philippe d’Iribarne, L’étrangeté française, 2006, Points essais 2008, 289 pages, €9.10






Commentaires récents