Le chapitre VIII du Livre III des Essais est aussi long et ardu que les précédents. Plus il vieillit, plus l’esprit de Montaigne est brouillon, ajoutant des paroles là où faudrait élaguer. Dans le chapitre « De l’art de conférer » – qui veut dire converser, il prend la défense des contradictions. Loin de lui nuire, elles lui sont au contraire bénéfiques. Il n’y a que les gens stupides qui n’apprennent pas des autres, ni ne révisent ou confortent leurs propres opinions selon celles d’autrui.
« On ne corrige pas celui qu’on pend, on corrige les autres par lui. Je fais de même », dit Montaigne. Sans aller jusqu’à cette extrémité, « publiant et accusant mes imperfections, quelqu’un apprendra de les craindre ». Ce pourquoi il écrit. Lui « [s’]instruit mieux par contrariété que par exemple, et par fuite que par suite. » Observer les autres, les écouter, entendre leurs arguments, apprend plus que lire un texte. Car la conversation est alternance d’arguments ; la bonne conversation, s’entend, pas le monologue du faux-savant ni la fatuité du bien en cour. Mais, entre gens de bonne compagnie, deviser fait progresser. « Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c’est à mon gré à la conversation. (…) L’étude des livres, c’est un mouvement languissant et faible qui n’échauffe point : là où la conférence apprend et exerce en un coup. Si je confère avec une âme forte et un roide jouteur, il me presse les flancs, me pique à gauche et à dextre, ses imaginations élancent les miennes ; la jalousie, la gloire, la contention me poussent et rehaussent au-dessus de moi-même… » Ne l’avons-nous pas tous expérimenté ? Ce pourquoi les ados adorent « discuter » plutôt que lire.
Le mauvais exemple fait suivre le bon. « Tous les jours la sotte contenance d’un autre m’avertit et m’avise. » Ainsi les Spartiates amenaient leurs enfants regarder les hilotes ivres – pour qu’ils ne tombent jamais aussi bas. Notre époque semble faire l’inverse, à se complaire dans le vil et le sordide, à magnifier « le peuple » en ce qu’il a de populacier, badaud, crédule, lyncheur – tous les bas instincts lâchés sans retenue. Étonnez-vous après que des collégiens s’entretuent au couteau à la sortie de l’école, ou que des père-la-vertu de 14 ans tabassent « la pute » qui prend des manières de liberté. Comme on fait son lit, on se couche. « Comme notre esprit se fortifie par la communication des esprits vigoureux et réglés, il ne se peut dire combien il perd et s’abâtardit par le continuel commerce et fréquentation que nous avons avec les esprits bas et maladifs. Il n’est contagion qui s’épande comme celle-là. » Les prêcheurs de religion falsifiée, les intellos misérabilistes sur les réseaux et les journalistes de médias en mal d’émotionnel qui fait l’audience, sont bien coupables du dérèglement des mœurs.

Montaigne avoue détester la sottise et ne pouvoir la supporter (nous non plus). Il aime à disputer, sans entrer en colère quand on n’est pas d’accord avec lui, mais bataillant ferme argument après argument. « Nulles propositions m’étonnent, nulle créance me blesse, quelque contrariété qu’elle ait à la mienne. Il n’est si frivole et si extravagante fantaisie qui ne me semblent bien sortable à la production de l’esprit humain. » Être contredit le ravit car cela l’éveille et l’exerce. Lui ne joue pas les « offensés » comme les esprits faibles de notre temps, quand il rencontre une opinion autre que la sienne ! « J’aime, entre les galants hommes, qu’on s’exprime courageusement, que les mots aillent où va la pensée. » La société n’a pas d’intérêt si elle n’est pas directe et vraie, et « n’est pas assez vigoureuse et généreuse si elle n’est querelleuse, si elle est civilisée et artiste, si elle craint le heurt et a ses allures contraintes. (Ici une citation de Cicéron) Quand on me contrarie, on éveille mon attention, non pas ma colère ; je m’avance vers celui qui me contredit qui m’instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune à l’un et à l’autre. » Cela est sagesse, mais qui connaît encore la sagesse de nos jours ?
« Je festoie et caresse la vérité en quelque main que je la trouve, et m’y rends allègrement, et lui tends mes armes vaincues de loin que je la vois approcher. » La vérité est comme une femme et l’approche de Montaigne est quasi sexuelle : il jouit de la sensualité qui le prend pour elle. Les hommes de son temps font plus de manières et répugnent à contredire, par manière de politesse hypocrite. Montaigne le regrette, et il évoque ses écrits. « Mon imagination se contredit elle-même si souvent et condamne, que se m’est tout un qu’un autre le fasse : vu principalement que je ne donne à sa répréhension que l’autorité que je veux. » Encore une fois, Montaigne pense par lui-même et, si les critiques l’exercent, il n’en prend que ce qu’il juge pertinent.
A condition cependant que les objections soient dans l’ordre, qu’elles suivent un raisonnement « On répond toujours trop bien pour moi, si on répond à propos. Mais quand la dispute est trouble et déréglée, je quitte la chose et m’attache à la forme avec dépit et indiscrétion, et me jette à une façon de débattre têtue, malicieuse et impérieuse, de quoi j’ai à rougir après. Il est impossible de traiter de bonne foi avec un sot. » Aussi ne le faisons point et laissons les sots à leur sottise : jamais un argument de raison ne percera la carapace obtuse des croyants. « La sottise et dérèglement de sens n’est pas chose guérissable par un trait d’avertissement. »
Sots sont d’ailleurs les faux-savants, ceux qui croient savoir et vous assomment de leur érudition. « Pour être plus savants, il n’en sont pas moins ineptes. » Mieux vaut celui qui pense par lui-même, qui cherche et se corrige, qui affine et traque les sources. « Tout homme peut dire véritablement ; mais dire ordonnément, prudemment et suffisamment, peu d’hommes le peuvent », constate Montaigne. «D’une souche, il n’y a rien à espérer », ajoute malicieusement le philosophe.
La suite du texte digresse verbeusement en diverses matières, qui sont l’argument d’autorité ou l’impuissance à corriger le faux qui va ; que tout raisonnement n’empêche pas le hasard ; que les bons mots ou les sentences fortes ne sont peut-être pas de celui qui parle mais repris d’auteurs ou de grands hommes ; que certains livres instruisent plus que d’autres, ainsi l’Histoire de Tacite. Mais que tous les propos doivent être tenus pour critiquables, évaluables selon la raison de qui les lit. « Moi qui suis roi de la matière que je traite, et qui n’en dois compte à personne, ne m’en crois pourtant pas du tout ; je hasarde souvent des boutades de mon esprit, desquelles je me défie, et certaines finesses verbales, de quoi je secoue les oreilles. » Il faut faire pareil avec tous les livres, même ceux d’auteurs réputés et célèbres.
Et de conclure : «Tous jugements en gros sont lâches et imparfaits. »
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
(mes commentaires sont libres, seuls les loiens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Montaigne sur ce blog



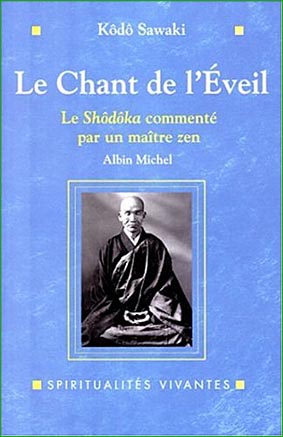
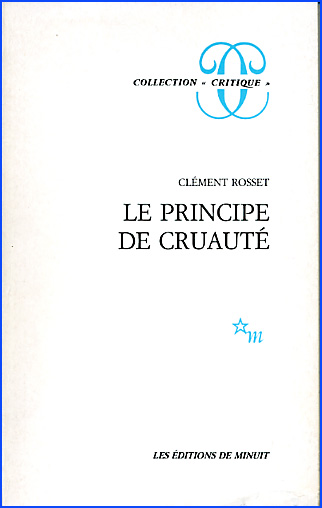

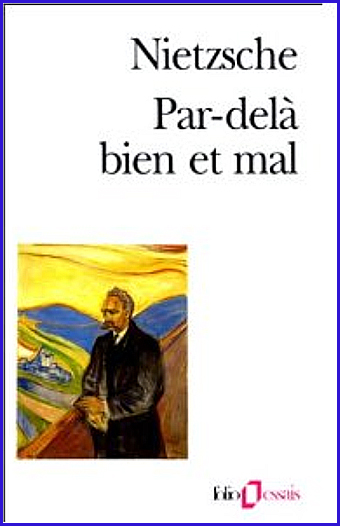





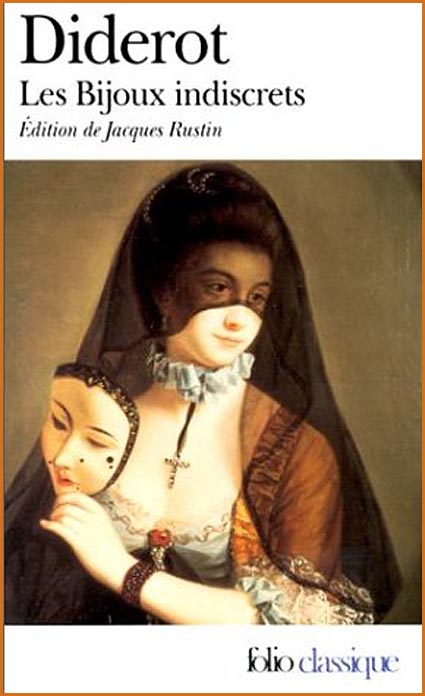

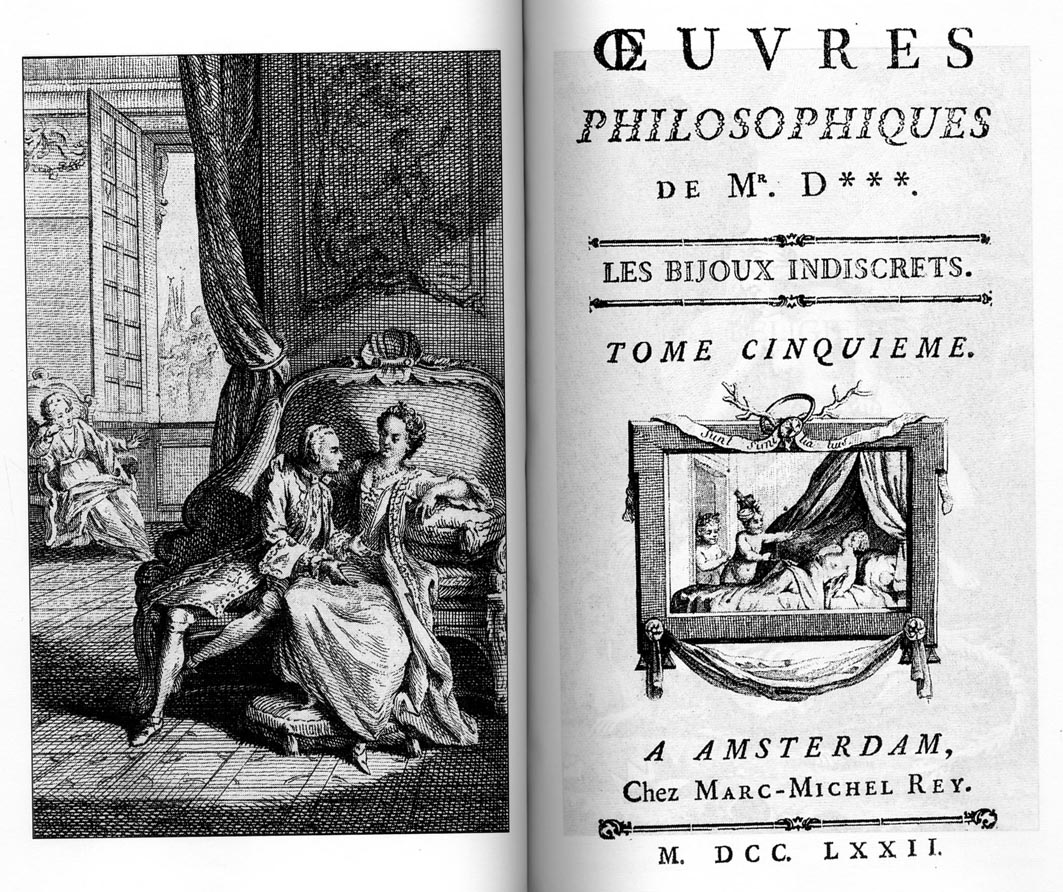



Commentaires récents