Les enfants ont ému Jean-Marie Gustave Le Clézio et il fait de cette émotion de la littérature. L’image de ces petits princes, filles et garçons, livrés en ces huit contes, est celle de la liberté, de la découverte de la vie malgré les contraintes, des sensations : la mer jusqu’au ventre, le soleil sur sa peau, le vent dans les cheveux ébouriffés.
Pareillement purs, émerveillés, poètes, ces petits princes transcrits en littérature sont la quintessence de l’enfance, cet état d’inachevé et de disponible qui est perdu à l’âge adulte. Ils sont solitaires et accordés aux éléments. On ne peut être enfant dans la ville car les contraintes tuent le rêve. Pour vivre son enfance avec plénitude, il faut vivre au naturel, c’est-à-dire selon les météores. Ainsi les enfants de Le Clézio sont-ils souverains.
Par-delà leur âge, ils sont éternels en ce qu’ils ont de plus humain : ils sont ceux qui écoutent et deviennent, ouverts aux autres, aux bêtes, aux végétaux, aux matières. Celui qui est dans le monde est, à ce stade de son développement, encore malléable, impressionnable au sens photographique, prêt à tous les rêves, à toutes les amitiés, à toutes les découvertes. Il est un premier mouvement pour tous les possibles.
Une ville au bord de la mer, un début d’été. Dans ces avenues ouvertes sur le large, erre Mondo, 10 ans, les yeux noirs obliques, les cheveux bruns cendrés selon la lumière, la peau cuivrée sous le jean et le T-shirt vert trop grand. Il est léger, silencieux, assuré. Il vient de nulle part, éternel présent. A ceux qui lui plaisent, il demande : « est-ce que vous voulez m’adopter ? » Dans le monde ordinaire, personne ne répond ; mais qui ne dirait oui, sans hésiter ? Mondo parle avec les humbles, les solitaires, les marginaux, ceux qui savent observer et qui ont la sagesse la plus profonde. Le matin, il regarde le soleil se lever, le laisse chauffer son corps, puis il se met nu et nage longtemps, ami de l’eau. C’est un enfant du Sud.
En Islande, l’enfant du Nord, Jon a 12 ou 13 ans. Il aime le son du vent, l’eau glacée des torrents et la lumière qui entre « en lui par toute la peau de son corps et de son visage (…) comme un liquide chaud » p.126. Ivre de cette lumière, il se roule tout nu « sur le sol humide, en frottant ses jambes et ses bras dans la mousse » qui le couvre de gouttes froides. Puis le soleil lui brûle « le visage, la poitrine et le ventre ». Il ne sait pas ce qu’est le désir sexuel, il en découvre un avant-goût en se vautrant par terre sensuellement comme un ver. Première initiation, qui est charnelle.
La seconde sera spirituelle : il grimpe la montagne de basalte, malgré le vent qui le frappe avec violence. La nature entière le pénètre et le possède. Il faut prendre ces mots au sens fort, quasi érotique. « La lumière gonflait la roche, gonflait le ciel, elle grandissait aussi dans son corps, elle vibrait dans son sang. La musique de la voix du vent emplissait ses oreilles, résonnait dans sa bouche (…) Son cœur battait très fort dans sa poitrine, poussait son sang dans ses tempes et dans son cou » p.130. Comme si la nature lui gonflait toute la chair de son énergie vitale en commençant par le ventre et lui montant irrésistiblement à la tête.
En haut de la montagne, surgit un dieu sous la forme d’un enfant lumineux. Il a le regard changeant, bleu intense ou gris, la voix douce et fragile, il est habillé « comme les bergers » – c’est-à-dire presque pas. Solitaire et gracieux, il aime la musique qui parle au plus profond de l’être, au cœur et à l’esprit, aux fibres peut-être. Jon se met à l’aimer, aussi brusquement et aussi fort que l’on aime à la prime adolescence. Lorsqu’il s’éveille au matin, l’enfant-lumière endormi près de lui a disparu. « Jon ressentit une telle solitude qu’il en eu mal au centre de son corps, à la manière d’un point de côté. » Il redescend mûri, son enfance l’a quitté, il n’est plus ce berger tendre et fragile d’hier. Il a vécu une expérience initiatique.
Dans ce livre, il y a d’autres enfants encore : Llulaby, Juba, Petite-Croix, Alia, Daniel qui n’avait jamais vu la mer, et Gaspar qui partage quelques semaines la vie de quatre enfants bergers d’Afrique du Nord rencontrés par hasard. Mais Mondo et Jon restent mes préférés.
J’ai déjà chroniqué ce livre d’une autre façon sur ce blog
JMG Le Clézio, Mondo et autres histoires, 1978, Folio, 310 pages, €11.72
Tout Le Clézio chroniqué sur ce blog

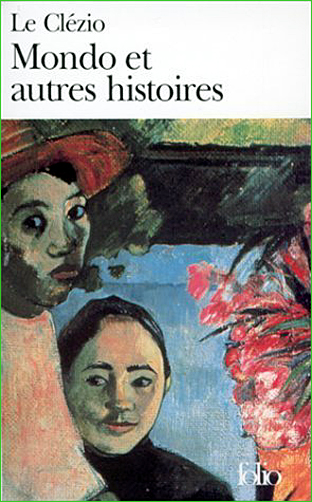
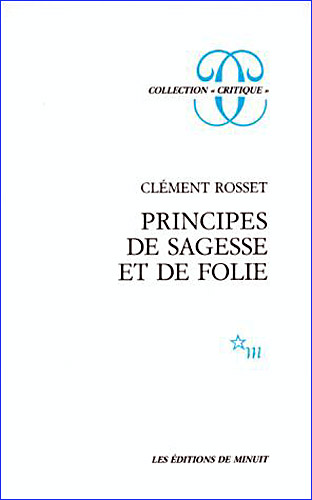


Commentaires récents