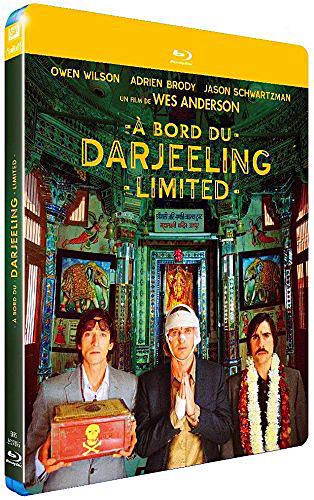
Choc de civilisations entre l’Inde et l’Amérique, choc d’époque entre la postmodernité issue des hippies qui se cherchent et le bouddhisme millénaire établi, choc de psychologie entre l’amour compliqué occidental et l’amour plaisir ou famille des Indiens. Moi, il me plaît, ce film, revu récemment.
Je n’y cherche pas un « progrès de la filmique » ni un faux exotisme ; je suis un spectateur candide qui apprécie ce qu’on lui propose avant de plaquer des jugements a priori du haut de ma supposée Culture – et il se trouve que je suis allé en Inde plusieurs fois et que j’ai retrouvé dans le film (tourné au Rajasthan) des traits réels du pays et de ses façons de vivre.
Les relations entre parents et enfants, entre frères, entre homme et femme, ne sont pas de la même eau en Amérique et en Inde. La famille éclatée ici et la famille traditionnelle là-bas ne vivent pas le même rythme. Décentrer l’action est donc utile pour se considérer autrement. Les trois frères qui, sous la houlette un brin impérieuse de l’aîné Francis (Owen Wilson) se retrouvent pour « une surprise » en Inde, ont été délaissés par leur père et leur mère ; ils en souffrent. Le père était trop préoccupé à faire de l’argent et à bichonner sa Porsche 911 rutilante pour s’occuper de ses garçons ; la mère (Anjelica Huston), trop préoccupée de son confort moral pour faire famille avec les enfants qu’elle a subi. Le premier est mort et enterré (sans la mère) ; la seconde est partie « faire le bien » (comme l’autre « faisait de l’argent ») dans le nord de l’Inde, comme nonne chrétienne.
Chacun des garçons mène une vie compliquée. Francis, l’aîné, a repris les affaires de son père et s’est « volontairement » envoyé en l’air en moto, il arbore des pansements sur tout le visage, façon de se punir d’exister, d’être nul et de désirer les filles tout en ne rêvant qu’à maman dont il imite la direction autoritaire jusqu’à faire planifier par un employé, sous plastique, les activités prévues. Le second, Peter (Adrien Brody) va être père à son tour et fuit la date de l’accouchement du bébé qui sera un garçon ; il ne veut pas voir ça pour ne pas reproduire son propre père – mais il porte ses lunettes solaires, se rase avec son rasoir et a emporté comme fétiche les clés de sa Porsche. Le cadet Jack (Jason Schwartzman) est obsédé de sexe, voulant « posséder » les femmes comme papa du fric, il a des relations détachées avec sa compagne restée en rade en Italie ; il marche toujours pieds nus par rébellion et arbore une moustache de macho malgré des cheveux coiffés adolescent ; il écrit ses histoires au lieu de les vivre, comme s’il était un autre. Ce qui donne quelques scènes de « règles » où chacun promet de tout se dire, flanquées de moments où chacun va séparément téléphoner à sa femme respective.

Le train indien n’attend pas et tous les Occidentaux doivent sans cesse courir après lui, du businessman de la première scène (qu’on ne reverra plus, peut-être comme allégorie initiale du père absent ?) aux trois frères flanqués chacun de deux valises et d’un sac (Vuitton – comme papa). Les Indiens regardent avec détachement et sans intervenir ces hommes pressés qui ne prennent pas le temps de vivre. Le Darjeeling Limited est un train fictif qui rejoint les abords de l’Himalaya depuis les grandes villes internationales de la côte. La vie à bord se déroule en Pullman, avec salon spacieux, couchettes et thé ou citronnade servis à la place. Mais les Américains ne veulent pas se couler dans l’existence indienne : « Allons prendre un verre et fumer une cigarette ! » dit à plusieurs reprises Francis pour entraîner ses frères – alors qu’il est interdit de fumer et que le thé est servi.
La jeune serveuse Rita (Amara Karan) – surnommée par les garçons Citronnette – a pour fiancé le chef de train (Waris Ahluwalia) qui arbore la longue chevelure et la barbe de Sikhs. Elle aime le plaisir et se laisse enfiler à la hussarde dans les toilettes du train par Jack – mais c’est bien elle qui consent, et pas le macho qui la possède : « Merci de m’avoir utilisé », lui dira Jack, enfin conscient, au moment où il quitte le train, « You’re welcome », répondra joliment Rita. L’amour est simple lorsqu’on ne confond pas comme chez les chrétiens yankees plaisir et métaphysique.
Si les trois sont jetés du train, c’est que Peter a acheté un serpent venimeux dans sa boite comme « souvenir ». Le serpent est réputé mort, mais il se réveille et s’échappe dans le compartiment. Le chef de train, pratique, le zigouille (ou du moins le dit, étant Sikh il respecte toutes choses vivantes), et éjecte les Américains empêtrés de mille règles qu’ils se donnent mais ne respectent aucune. En Inde, de mœurs anglaises, on obéit aux règles, un point c’est tout.
Les trois compères se retrouvent dans un paysage désertique. Longeant une rivière rapide, ils voient trois frères (eux-mêmes en plus petits), tenter de traverser la rivière sur un va-et-vient usuel en Inde, où une corde permet de tirer une nacelle d’un bord à l’autre. Las ! le second (l’analogue de Peter) va faire chavirer la nacelle, précipitant les gamins dans l’eau agitée. Peter et Jack vont se jeter à l’eau pour sauver les petits mais l’éternel gaffeur Peter, velléitaire en tout, ne réussira pas à sauver son garçon ; il se noie après que sa tête eut heurté une pierre. Il ramène le corps dans ses bras au village. Ce gosse, c’est lui enfant avec ses frères, et c’est aussi le fils qu’il bientôt avoir. Comme son propre père, il est maladroit et ne sait trop que faire. Tous vont trouver dans ce village pauvre – mais coloré – la simplicité qu’ils étaient plus ou moins venus chercher. La famille est unie, le gamin enterré selon les rites millénaires, la vie continue malgré la tristesse. Leur prétention à trouver la spiritualité dans l’éther et dans les procédés compliqués d’une plume soufflée au vent, se brise sur la simplicité des peuples et de l’existence traditionnels.

Leur mère refusant de les voir, selon un échange par mail assez incongru dans l’Himalaya, les trois frères décident de regagner l’Amérique mais, au pied de la passerelle de l’avion, ils déchirent brusquement les billets et décident d’aller la voir quand même. Elle est ravie de les retrouver mais n’exprime pas plus d’attachement que cela. Le passé est le passé et seul le présent compte, leur fait-elle comprendre. Un tigre qui rôde présentement autour du monastère est plus important que ne pas avoir été aux funérailles de son mari il y a un an. Le lendemain, elle est partie, ayant laissé le petit-déjeuner selon les goûts de chacun. Au fond, ils n’ont plus besoin de maman et sont adultes, non ?
Au retour, chacun accepte donc son existence, rasséréné : Peter ne va pas divorcer de sa femme enceinte, Jack larguer sa compagne restée en Italie et accepter que ce qu’il écrit soit sa propre histoire. On ne sait pas ce que va faire Francis, sinon qu’il ne veut plus tenter de se suicider et compte cicatriser. Lorsqu’il veut rendre les passeports confisqués à ses frères, ceux-ci lui demandent de les garder. A trois, on est plus fort.
Ce film, désopilant et loufoque, est plus subtil qu’il n’y paraît. Il ne plaît pas à la génération bobo des cultureux de Télérama – qui n’y comprennent rien, n’ayant que des « réactions » contre un racisme supposé et un esthétisme qui n’est pas dans leur cadre. Pauvre déculture… Je suis effaré de l’absence totale de sensibilité de ces gens pour cette humanité qui se dégage des scènes. Ce conte léger mérite mieux que les jugements à l’emporte-pièce des bourgeois branchés trop à la poursuite de la mode. Se dépayser pour retrouver les véritables valeurs humaines, est-ce trop leur demander ?
DVD A bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson, 2007, avec Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Amara Karan, Waris Ahluwalia, Anjelica Huston, 20th Century Fox 2014, blu-ray €11.99
DVD The Grand Budapest Hotel + A bord du Darjeeling Limited, Pathé 2015, €8.99
D’autres films de Wes Anderson sur ce blog



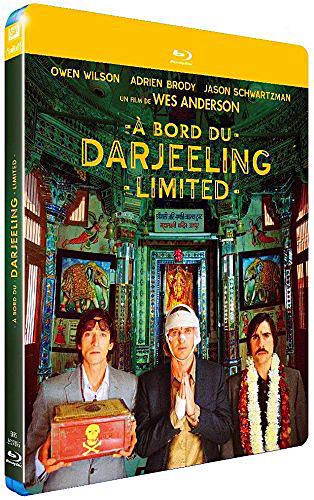


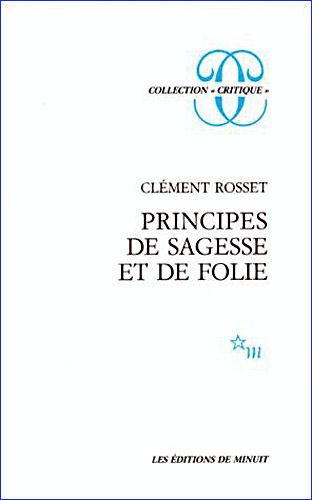


Commentaires récents