Dans un conte pour matelots et pour vieilles femmes, Zarathoustra raconte l’enfer qui leur fait peur. Il a lui-même affronté le « chien de feu » et l’a déstabilisé. Il aboie tant qu’il ne crée rien, car ce n’est pas la fureur (ni le Führer) qui créent en braillant mais les chercheurs de vérité dans le silence.
« Toujours, lorsque j’ai entendu parler les démons de révolte et de rebut, je les ai trouvés semblables à toi, avec ton sel, tes mensonges et ta platitude. Vous vous entendez à hurler et à obscurcir avec des cendres ! Vous êtes les plus grands vantards et vous avez appris en suffisance l’art de faire entrer la fange en ébullition. » Celui qui crie le plus fort n’est fort qu’en parole – on pense à Mélenchon. Les populistes qui mentent au peuple pour mieux le manipuler ne le rendent pas libres, ils accaparent au contraire le pouvoir à leur profit exclusif. Ils ne créent pas de valeurs, ils affirment leur ego. Ils ne donnent pas le bonheur mais asservissent.

« Liberté ! c’est votre cri préféré ; mais j’ai perdu la foi en les ‘grands événements’, dès qu’il y a beaucoup de hurlements et de fumées autour d’eux. » Plus c’est gros, plus ça passe, disait Goebbels en propagande ; plus c’est gros, plus il importe de se méfier. Les événements les plus grands ne s’accomplissent pas dans le fracas et le badaboum, mais en silence. Ainsi de « la Révolution » dont les gogos ne retiennent que la prise de la Bastille alors qu’elle a été un lent glissement préparé des esprits depuis la Renaissance. Ou du fascisme/nazisme qui sont le résultat de plusieurs causes concomitantes qui peuvent se répéter.
Les écolos braillards et violents d’aujourd’hui devraient y réfléchir : c’est desservir leur cause que de marquer le coup dans le bruit et la fureur – bien mieux vaudrait-il proposer des solutions crédibles et socialement acceptables, préparer les esprits au lieu de les choquer. Le choc assourdit, sidère et asservit, il ne libère pas ni ne suscite le consentement. Bien amers ont toujours été les lendemains qui chantent et les promesses à la légère, et bien boursouflées les annonces de catastrophes et d’apocalypses. Les vrais catastrophes avancent à pas de loup et n’ont jamais été prévues.
« Ce n’est pas autour des inventeurs de fracas nouveaux, c’est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que gravite le monde ; il gravite en silence. Et avoue-le donc ! Peu de chose avait été accompli lorsque se dissipait ton fracas et ta fumée ! » De fait : les manifs monstres n’ont jamais accouchées que de souris, de reculs tactiques pour mieux imposer par la suite – on pense aux éternelles réformes des retraites car on ne fait jamais suffisamment et à temps.
Cela signifie-t-il que Nietzsche/Zarathoustra soit un conservateur qui refuse de changer ? Pas du tout, au contraire. Mais ce n’est pas brailler, hurler des slogans, aller aux manifs qui change le monde. C’est en soi-même en premier lieu que s’opère le changement. Peu à peu la société suit et la politique s’y adapte. Pas l’inverse. Seuls les dictateurs et les tyrans croient changer les hommes et l’homme écolo ressemble fort à l’homme nouveau des communistes. Les contemporains déclarent le faire au nom de la « démocratie », mais qu’est-ce qu’une démocratie qui impose la loi de l’ego au lieu de convaincre les esprits ?
« Mais c’est le conseil que je donne aux rois et aux Églises et à tout ce qui s‘est affaibli par l’âge et par la vertu – laissez-vous donc renverser, afin que vous reveniez à la vie et que la vertu vous revienne ! » Car l’âge rend conservateur et « la vertu » est une rigidité de mœurs et de pensée qui inhibe toute invention. Les rois ne sont pas éternels : – qui t’a fait roi ? Les Églises ne sont pas éternelles – elles dépendent de la foi, laquelle est une illusion consolatrice qui se dissipe avec l’émancipation humaine.
La foi écologiste n’est pas différente en fonctionnement de la foi chrétienne ; elle a ses gourous, sa bible, ses prêcheurs, son apocalypse. L’écologie n’est pas l’écologisme ; elle avance au contraire en silence et pas dans le braillement des manifs. Elle est la science, laquelle n’est pas une foi mais une analyse dérivée des observations et dont les hypothèses sont constamment testées. Pas de bible en science, mais une constante remise en question, celle qu’appelle Nietzsche aux rois, aux Églises et aux vertus moralisantes.
« L’État est un chien hypocrite comme toi-même, dit Zarathoustra au chien de feu. Comme toi il aime à parler en fumée et en hurlements pour faire croire, comme toi, que sa parole sort des entrailles des choses. Car l’État veut absolument être la bête la plus importante sur terre ; et on le croit. » Comme le démontrait La Boétie, il suffit de ne plus « croire » pour être libre.
« Il est temps, il est grand temps ! » annonçait déjà Zarathoustra aux matelots. Le temps de faire et pas celui de brailler. Avis aux bêtes stupides qui se croient humaines alors qu’elles se comportent comme des moutons.
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog




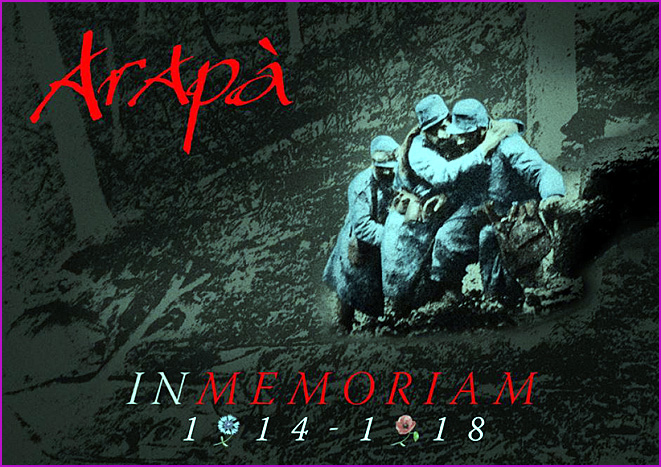

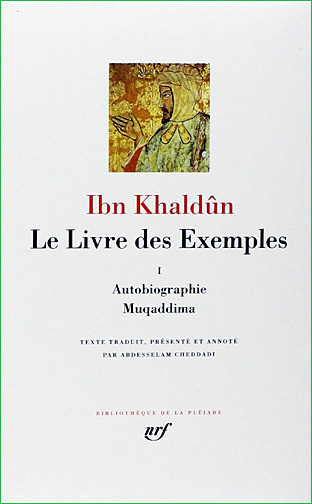
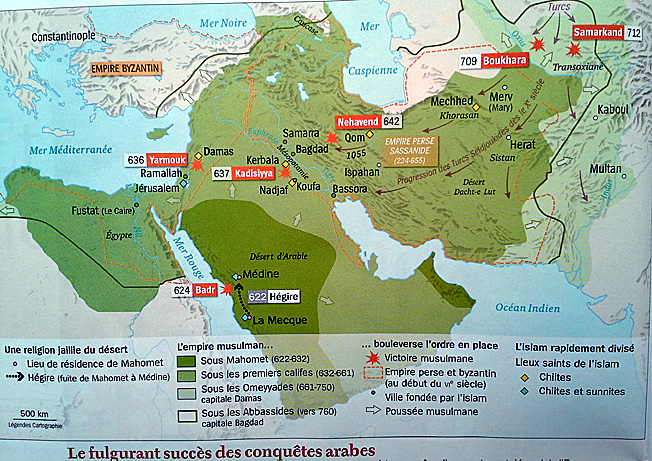




Commentaires récents