
Gilles est le roman le plus connu de Drieu la Rochelle, celui dans lequel il se met tout entier, où son incertitude personnelle comme celle de l’époque, s’exacerbe et se résout. C’est l’heure du choix, tant pour les individus que pour les vieilles démocraties. Je livre si après mes impressions lors de ma première lecture à 42 ans. J’en ai opéré une seconde, parue sur ce blog en 2013.
Trois parties en ce roman, comme les trois coups du destin et les trois moments dialectique. Thèse : le mariage, la situation. Antithèse : le divorce, les tentatives avec les surréalistes, les révolutionnaires, la modernité. Synthèse : la rupture, le ressourcement dans la « force ».
La première partie s’intitule « la permission ». Elle est ringarde et déplaisante. Elle évoque pour notre époque une autre planète, celle où un jeune bourgeois jeté dans la guerre au sortir du collège revient pour prendre la société à l’abordage, par les femmes. Courage et veulerie, intrigue et détachement, sexe et continence, Gilles se vautre dans la richesse et le pouvoir, symbolisés par Myriam la juive laide et faible, rejeton d’un ex-entrepreneur vidé d’énergie. Gilles l’épouse, il hérite, entre au Quai d’Orsay. Il goûte la décadence. Mais la solitude est son lot, comme celui du soldat sous la mitraille. Il réfléchit trop, il exige trop, comme la guerre a exigé de lui. Indiscipliné, dilettante, velléitaire, Gilles est incapable de se fixer, reflet authentique de l’air de ce temps d’entre-deux-guerres où tout s’effiloche.
La seconde partie, « l’Élysée », est dérisoire mais se laisse mieux lire aujourd’hui. Coincé entre ses relations mondaines et politicardes de ses amis, la coterie surréaliste ou les révolutionnaires creux et vantards, Gilles explore. La bourgeoisie le répugne. Il goûte l’austérité libérale dans les bras de Dora l’Américaine. Elle se prête, il se prête : utilité, efficacité, observation neutre du jeu social. Il goûte le cynisme, mais son instabilité le pousse à rompre. Il ne peut se satisfaire du laisser-faire.
La troisième partie, « l’apocalypse », est pour moi la meilleure. Gilles démissionne du Quai, rompt avec ses faux amis, et comprend en février 1934 qu’il faut démolir ce régime où la bourgeoisie au pouvoir a perdu de sa légitimité. Il se ressource au désert, il découvre l’aristocratie, la « vraie » qui vient du peuple. La « force » et la « race » sont un trésor d’antiques vertus. Le peuple, redécouvert dans les tranchées, est resté sain tandis que la bourgeoisie planquée, avilie, débauchée, reste incapable d’un quelconque sursaut d’énergie dans l’après-guerre. Le peuple est personnifié par une troisième femme, Pauline, ex–espagnole, ex–pute, naïve et sauvage mais belle et aimante ; elle lui donne l’espoir d’un fils. Gilles crée un journal critique, indépendant des lobbies, qui prépare un nouveau courant d’idées, « national sans être nationaliste (…) social sans être socialiste » p.537. En bref, un journal anti–bourgeois et populiste. Il est obsédé par la décadence, par les masses contre la civilisation, par les foules qu’il faut dompter et dresser avec « une saine et féconde rencontre sexuelle » (p.556) entre l’orateur et son public. Sur les décombres, Gilles crée du vivant : un gosse, un journal, une action politique. Il retrouve le « sens du tout » en agissant.
Mais la décadence est dans l’époque, dans les mœurs, dans les esprits et dans les corps. Difficile de faire plus noir, d’apparaître plus suicidaire : le cancer tue son enfant encore embryon, puis sa femme la belle plante ; les radicaux tuent les velléités politiques révolutionnaires de son ami Clérences, l’anarchie de la pensée et le pessimisme sabordent son journal. Décidément, tout est pourri, éternelle rengaine de tous les perdants, de tous les réactionnaires qui croient que tout était mieux avant. Le négatif l’emporte : vieillissement, intellectualisme, mandarinat. La jeunesse, la force virile et la discipline deviennent des fantasmes. Le renouveau n’est aiguillé que vers l’inutile et le néfaste : la drogue, l’homosexualité, la peinture abstraite. Il est donc nécessaire de balancer ces élites qui n’en sont plus mais qui verrouillent, de foutre ce régime par terre « avec n’importe qui, à n’importe quelle condition » p.600.
Épilogue : Gilles entre « dans un ordre rigoureux » p.632, « militaire et religieux » p.174 ; il se veut le moine–soldat du « Christ des cathédrales, le grand dieu blanc et viril », pour défendre en Espagne « le catholicisme mâle, celui du Moyen Âge » p.658. Il retrouve au service du fascisme et dans l’action secrète, la fraternité des combattants : « rien ne se fait que dans le sang » p.687. Indifférence au feu, goût de la mort, comme à 20 ans.
Le cynisme du soldat de la Grande guerre, la vanité du petit-bourgeois rancunier de ne rien posséder, le dégoût de la jeunesse mâle pour la femme, simple réceptacle, et pour le bourgeois qui accapare et jouit, parade et verrouille la société – je me demande ce que l’on peut encore trouver d’intéressant à ce personnage de Gilles. Il est le miroir d’une époque révolue, il n’aide en rien à vivre. Il y a en lui toutes les immaturités, toute l’avidité, toute la rancune de Drieu envers la société. Son Gilles méprise et fait souffrir, il baise pour dominer, comme par revanche sur les femmes qui n’ont pas fait la guerre, ou pour profiter des fortunes et ainsi mieux « arriver ».
Ma répugnance est de tempérament. Drieu reste hanté par l’échec, l’impuissance, l’inachèvement. Son goût de la force est suspect, comme sa haine toute personnelle pour une bourgeoisie dévirilisée. Gilles s’efforce de se sentir subjugué par de grandes juments aux épaules de nageuse nordique tandis que Drieu est concrètement fasciné par le prolétaire musclé à grande gueule, Doriot. Cette quête de la force brute m’apparaît comme un manque personnel : manque d’un père, incertitude fondamentale de l’être. Gilles, comme Drieu, se monte la tête, cœur amer et esprit dans lequel il y a rien qu’un immense ressentiment pour sa médiocrité. Lui, le sain parmi les décadents ? Le saint parmi les pécheurs ? Quelle blague ! Ces considérations sur l’essence des femmes ou du Juif, ou du bourgeois, apparaissent aujourd’hui comme de vieilles lunes obsessionnelles. Pour lui, les Latins seraient sentimentaux et cochons tandis que les Nordiques révéreraient la force et la discipline.
Le fascisme apparaît comme la régulation du veule. Être faible, Gilles/Drieu a besoin de recevoir des autres ses structures comme hier le chevalier se revêtait de l’armure : ni les femmes, ni la société, ni les intellectuels de son temps ne les lui offrent. Quant à sa famille, qui aurait dû fonder sa personnalité, elle est évanescente. Drieu est fils de personne, adopté vaguement par un parrain qui paye son collège, tout comme Gilles. Beaucoup vient probablement de là dans sa pathologie adulte, à laquelle l’époque sert de résonance. Gilles/Drieu ne se sent bien qu’à l’armée, où la hiérarchie et l’autorité permettent la liberté morale et des mœurs fraternelles, « égales » entre égaux. Individu de l’ère des masses, déraciné sans père, perdu de solitude, Gilles/Drieu cherche réconfort et idéal dans la fourmilière où l’ordre est une mystique.
Paru l’année où se déclenche la Seconde guerre mondiale, le roman est daté, le personnage frustré, le style sans avenir. Drieu voulait égaler Flaubert ou Céline, il m’apparaît aussi passé qu’Henry Bordeaux. Las ! De gilets jaunes provinciaux aigris en jeunesse délaissant la démocratie pour révérer l’armée, il semble que l’époque de Gilles revienne. Peut-être faut-il relire ce gros roman préfasciste français, afin de mieux comprendre ce qui nous attend ?
Pierre Drieu La Rochelle, Gilles, 1939, Folio 1973, 383 pages, €10.20 e-book Kindle €2.99








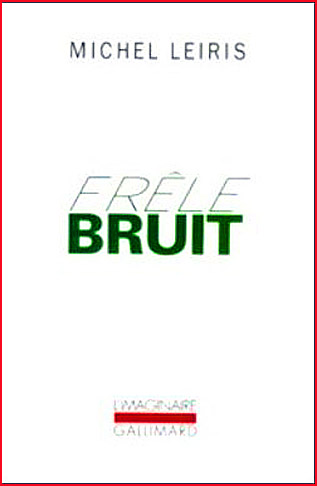


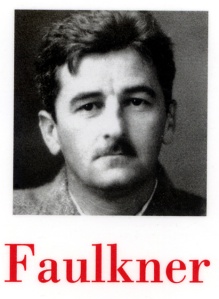
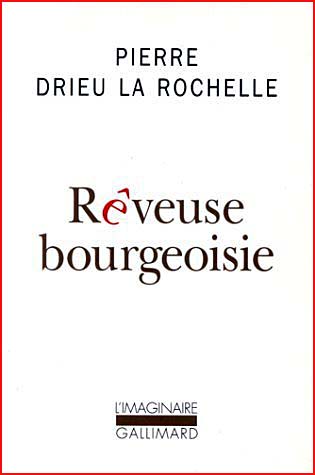




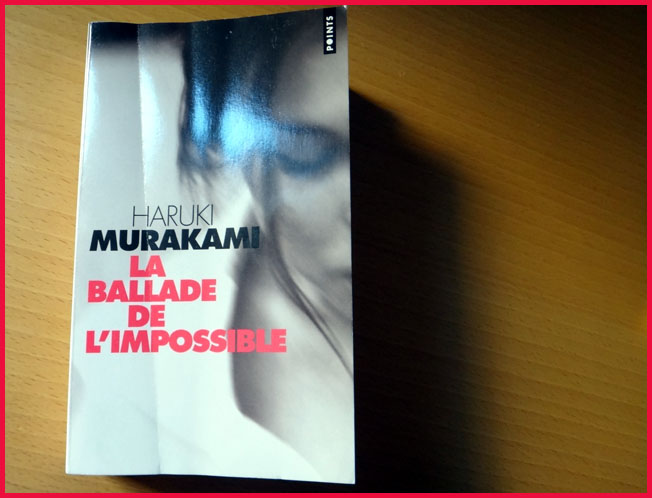



Commentaires récents