
Un été juste avant la déferlante du Sida, durant la queue de comète hédoniste de la libération des mœurs post-68, en 1985, François Ozon avait 19 ans. Il adapte le roman d’Aidan Chambers La Danse du coucou (Dance on My Grave) qu’il avait beaucoup aimé à l’époque (parution 1983 en France) pour en faire une tragédie légère. Cet oxymore résume tout le film, ce pourquoi il a sans doute déconcerté le public, en témoigne le nombre des entrées cinéma.


Il s’agit d’un amour adolescent, puissant, qui submerge l’âme dans une première fois. Mais c’est un amour pour le semblable, fait d’admiration et de désir, un amour fusionnel qui vise à dévorer l’autre. Ce que David (Benjamin Voisin), l’aîné, 18 ans (24 ans au tournage à cause de la loi sur la sexualité des mineurs), rejette de la part d’Alexis (Félix Lefebvre), 16 ans (21 ans au tournage). L’amour homo cherche ou bien le jeu des passades sans lendemain ou bien le couple fusionnel des gémeaux. Rien entre les deux comme avec une femme. D’où le trouble, la tragédie. L’adolescence est changeante parce qu’encore personnalité en devenir. D’où la légèreté, l’humour des situations. Ambiguïté du film. Ajoutez à cette dissonance un repli frileux sur « les valeurs » sûres qui sont celles des religions intolérantes du Livre dans notre époque marquée par la pandémie et la crise économique, et vous obtenez ce malaise social face à l’amour de deux jeunes garçons qui reproduit le modèle des éphèbes grecs, l’aîné et le cadet, le protecteur plus fort et plus musclé et la silhouette gracile au visage d’ange.

Alexis part en dériveur bronzer en mer. Endormi, il est réveillé par un orage qui gronde. Vite, en slip et chemise ouverte, il tente de hisser la grand-voile qu’il a laissée affalée n’importe comment ; la drisse coince, il s’énerve, le dériveur peu stable chavire et le précipite à la baille. Rien de grave mais impossible de remonter sur la coque retournée, trop lisse. A 16 ans, on attend encore les secours des autres plutôt que de se prendre en mains ; Alexis est passif, victime et vulnérable. C’est alors que surgit David son sauveur, le héros vigoureux qui lui conseille rationnellement d’agripper la dérive pour retourner le bateau à l’endroit, avant qu’il le remorque au moteur jusqu’à la plage où il pourra se sécher. David encore qui l’entoure, l’entraîne chez lui où sa mère le materne par un déshabillage de gamin, un bain chaud moussant dans le « sarcophage » de la baignoire, puis un thé brûlant ; David qui lui prête ses propres vêtements pour rentrer chez lui et qui va s’occuper de tout, même de ramener le bateau à son anneau de port. Il n’en fera rien, Alexis l’apprendra plus tard du copain de lycée qui lui a prêté le dériveur, première fissure dans l’image lisse et sculptée de son héros.

Car Alexis voit en David tout ce qu’il voudrait être, lui le fils de docker qui devra peut-être abandonner le lycée pour travailler et aider ses parents. Il n’a pas l’aisance de David, fils de commerçant juif à la mère permissive, son charme sans égal qui séduit tout le monde, profs (Melvil Poupaud qui enseigne le français au lycée), garçons, filles, du moment qu’ils sont jeunes et beaux. Un garçon bourré sauvé (lui aussi) des voitures parce qu’il divague sur la route et qu’il va coucher sur la plage avant de lui peigner tendrement les cheveux. Il couchera avec après avoir quitté Alex et celui-ci l’apprendra aussi plus tard – une lézarde de plus dans son amour inconditionnel.


Alexis, qui veut qu’on l’appelle Alex parce qu’il se sent un autre, plus libéré, plus dans le vent, est aveuglé par ses premiers émois d’adolescent. Il ne mesure pas la fêlure intime de David, fils unique couvé par maman et orphelin récent de père, obligé de reprendre le magasin familial d’articles de mer au Tréport plutôt que de continuer des études. Pour quoi faire ? L’avenir lui semble sans lendemain et il préfère donc vivre son plaisir au jour le jour sans s’attacher puisque tout passe, tout meurt, vite ennuyé par l’amour d’Alex qui veut l’ancrer, arrêter sa course vers la vitesse. Car c’est bien cette vitesse qu’il cherche à rattraper avec sa moto, comme il l’explique drôlement à son jeune compagnon. Il n’y réussira que trop, poussé à l’excès fatal par la révolte d’Alex qui ne comprend pas qu’il l’ignore toute une journée avec la jeune anglaise au pair, Kate (Philippine Velge) qu’il vient de lui présenter sur la plage. Rien de pire qu’un amour bafoué ; rien de pire que de s’en rendre compte et d’avoir dit des mots sur lesquels on ne peut revenir.

La mère de David (Valeria Bruni Tedeschi) est heureuse que son fils tourmenté ait trouvé un ami ; elle ferme les yeux sur le fait qu’il soit devenu un amant car la société n’est pas prête aux amours déviants (elle ne l’est toujours pas). La mère d’Alexis (Isabelle Nanty) est indulgente à ce désir adolescent, voulant elle aussi que son fils soit heureux et trouve sa voie. Un oncle scandaleux, Jacky, était lui-même homosexuel mais c’est le père, ouvrier imprégné des valeurs virilistes de sa classe, qui le refuse. Il n’est pas présenté en négatif dans le film, il se doute que cette amitié brûlante et exclusive cache des désirs inavouables, mais Alexis ramène Kate à la maison, qu’il a rencontré sur la jetée et la psy comme le juge lui-même, croiront à cette fiction d’une dispute des deux amis pour la même fille qui n’en peut mais.


Car Alexis est jugé. Il le raconte en voix off dès le début, encore amoureux d’un cadavre. Il voudrait, comme les anciens Egyptiens, embaumer David son amant pour le conserver à jamais préservé de la mort. Il a d’ailleurs intrigué auprès de Kate pour aller voir son corps nu et froid à la morgue. Mort qui le fascine, il ne sait trop pourquoi, comme un vide abyssal en lui, obscurément conscient que l’énergie vitale a son revers fatal, le désir impossible – le joyeux et cruel Eros.


La scène de boite de nuit où David entraîne Alex pour danser est édifiante : il pose sur les oreilles de son éphèbe un baladeur où est enregistré Sailing, une chanson de Rod Stewart. Ainsi il l’isole, l’enferme pour lui seul, mais ne partage pas car il continue de danser sur la musique de boite. Alexis et David sont ensemble et solitaires, comme est au fond toute existence face au néant qu’est la mort. Alexis est jugé non pas pour avoir tué David, qui s’est crashé tout seul sans casque sur sa moto en allant soi-disant à la poursuite de son ami qui l’avait quitté après une dispute à propos de Kate ; il est jugé pour avoir dansé sur la tombe de son ami mort, tel David devant l’Arche (2 Samuel 6:14), une promesse solennelle qu’il lui avait faite à sa demande – une « profanation » selon la loi. Est-ce « avilir ce qui est sacré » que danser ? L’épouse Mikaïl, dans la Bible, avait déjà « honte » de son époux se livrant à une danse de joie frénétique en simple pagne de lin devant l’Arche d’alliance du Seigneur. Les vieux Juifs de la famille de David comme le juge laïc imprégné de mentalité catholique aussi. Mais David, le roi, assume sa joie et l’expression de son corps : elle est la vie contre la mort, elle célèbre le Créateur et son au-delà. Le David de Normandie a lui-même fait danser son Jonathan d’Alex sur la musique qu’il avait choisie pour lui ; c’est un hommage d’honorer sa promesse par-delà la mort.


Une fois condamné – à 140 heures de travaux d’intérêt général – Alexis, décillé de l’amour absolutiste adolescent, imite David en draguant impunément un garçon sur la plage. Mais pas n’importe quel garçon : celui-là même que David avait sauvé des voitures parce qu’il était bourré et qu’il a probablement baisé d’une heure à quatre heures du matin la nuit où il l’a quitté. Alex deviendra-t-il un cynique comme David ? Un Don Juan garçonnier comme lui, inapte à tout attachement ? Il n’a que 16 ans et le film laisse tout ouvert.

Le spectateur ressent le contraste entre les acteurs qu’il a connu, Melvil Poupaud barbu, lunetté, toujours à cloper et un brin ridé de maturité (47 ans au tournage) ou Isabelle Nanty vieille en mémère (58 ans) – et la jeunesse éclatante des corps des deux garçons qui irradient la vie, le désir, la joie. L’amour apaisé du prof pour ses élèves mâles, des mères pour leurs fils au bord de l’âge adulte, diverge de la soif de caresses et de sensations des jeunes que le plan-plan ennuie. Jusqu’à mourir par excès de tout.
DVD Eté 85, François Ozon, 2020, avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty, Diaphana 2020, 1h36, €9.99 blu-ray €14.99

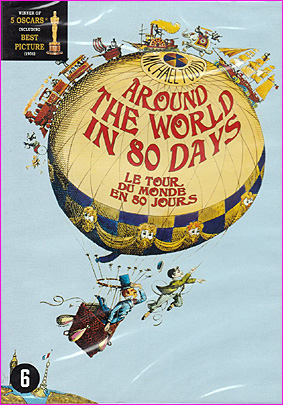






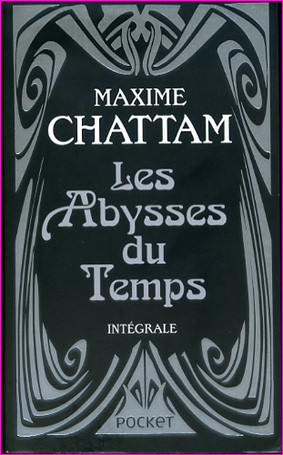








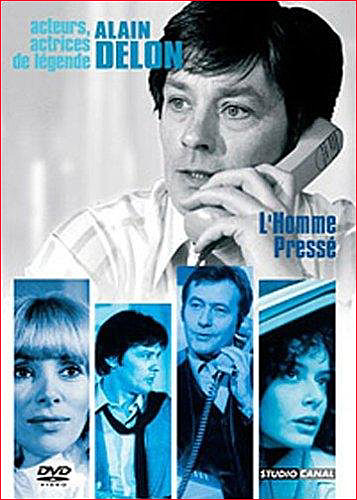




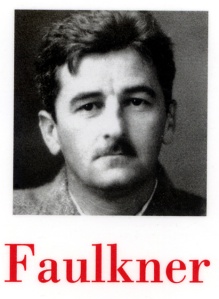
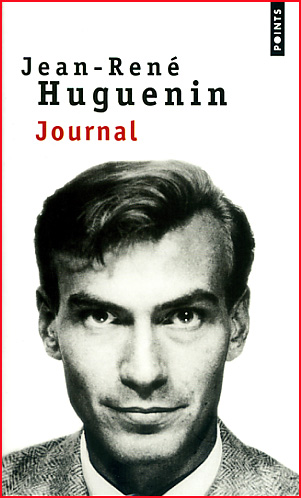

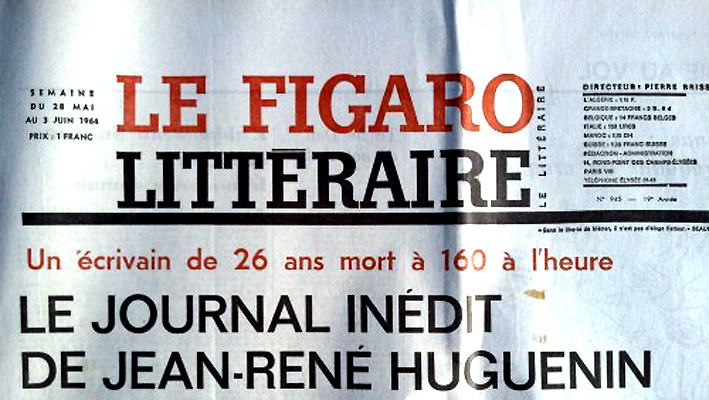
Commentaires récents