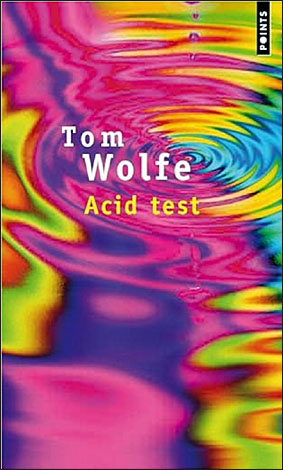
Un document ! Celui de la génération qui a eu 20 ans dans les années soixante en Californie – le laboratoire du siècle. Les États-Unis étaient à leur apogée, vainqueurs incontestés de la Seconde guerre mondiale, ayant contenu le communisme en Corée et tentant de le faire au Vietnam, première puissance militaire et industrielle de la planète. Après les Atomic boys des années cinquante, place aux hippies et aux freaks. Un mélange de mystique et de technologie unique à l’univers américain. La drogue de synthèse LSD, la musique électro et le cinéma se mêlent dans un trip d’enfer pour briser les gaines des conventions sociales et découvrir l’au-delà de la perception.
L’expérience est l’aboutissement des années d’après-guerre américaines, ce sentiment que tout est possible, que tout reste à explorer. « Il n’avaient que 15, 16 ou 17 ans, et portaient des chemises Oxford roses, style haute couture, des pantalons tirés, des ceintures étroites et souples, des chaussures de sport – avec tout ce Straight et ce V8 en poudre dans le coffre et cette splendeur de néons au-dessus. Cela rejoignait les supers-exploits technologiques des jets, de la TV, des sous-marins atomiques, des supersoniques – les banlieues américaines de l’après guerre – un monde merveilleux ! Et merde pour les intellectuels délicats de la civilisation américaine qui dégénère… Ils ne pouvaient comprendre, à moins de lui avoir donné le jour – cette impression – ce que c’était que d’être des Super-Kids » p.43.
Tom Wolfe, décédé à 88 ans en 2018, était un essayiste inventeur du Nouveau journalisme. Il s’agissait d’écrire ses enquêtes comme un roman, tout en conservant la vérité des faits. « L’investigation est un art, laissez-nous juste être des sortes d’artistes », disait-il. Ce pourquoi Acid test est sous-titré « chronique ». « Je me suis efforcé non seulement de raconter l’histoire des Pranksters mais aussi d’en recréer l’atmosphère mentale, la réalité subjective. Je ne crois pas que l’on aurait pu, sinon, comprendre quoi que ce soit à pareille aventure. Tous les événements que je rapporte, tous les dialogues ici consignés, j’en ai été témoin » p.407.
La chronique raconte l’odyssée en 1964 des Merry Pranskters à bord d’un vieux bus scolaire peinturluré psychédélique, comme les hallucinations colorées du LSD. Le personnage principal, sans être « le chef », est l’écrivain Ken Kesey (auteur en 1962 de Vol au-dessus d’un nid de coucou – qui donnera le film avec Jack Nicholson) avec sa femme Faye et leurs quatre petits blonds, ainsi que le célèbre Neal Cassady (héros de Sur la route de Jack Kerouac, bible de la Beat generation publiée en 1957). D’autres suivent, agglomérés à la suite des expériences ddu psychologue Vic Lovell sur les drogues modifiant l’état de conscience. Kesey a été volontaire et a la sensation, avec le LSD, de voir s’étendre son état de conscience. « De fait, comme tout le reste ici, cela ressortit à la même… expérience, celle du LSD. Cet autre monde auquel le LSD ouvrait votre esprit n’existait que dans l’instant – maintenant – et toute tentative de planification, de composition, d’orchestration, d’écriture, ne pouvait que vous le dérober, vous rejeter dans un monde de conditionnement et de routines où l’esprit n’était plus qu’une soupape de sûreté… » p.62.
C’est dès lors un voyage vers « l’Hailleur » (Further) en bus à travers le sud-ouest américain qui commence, dans un déluge de guitares électriques, de sons remixés et de peinture Day-Glo (fluorescente). Il s’agit de coller à l’instant pour le vivre intensément, défoncé donc sans plus aucune contrainte. Un film de quarante heures est tourné sur le vif pour montrer « juste la vie ». Les fondateurs de religion sont tous comme Kesey : tout commence par une Expérience, puis sa communication avec un rituel de chants, danses, liturgie à l’acide pour communier ensemble, donc un sentiment de communauté conduite à l’extase, les êtres synchronisés. Pour convaincre les autres, rien de mieux que le Test de l’acide (Acid test). « Les tests étaient à l’origine du style psychédélique et de pratiquement tout ce qui en était sorti. (…) Les Spectacles complets – il procédaient directement de leur combinaison de lumières, de projections cinématographiques, des stroboscopes, des bandes magnétiques, du rock’n’roll et de la lumière noire mêlée. Le Rock acide – aussi bien Sargent Peppers des Beatles que les vibratos électroniques aigus des Jefferson Airplane, des Mothers of Invention, et de tant d’autres groupes – c’étaient les Grateful Dead (traduit par les Morts reconnaissants) qui avaient tout inventé, au cours de ces Tests » p.246.
Ce voyage aboutira aux Trips festivals de San Francisco et Los Angeles en 1966 après avoir attiré les Beatles et les Hells Angels, et contribué à créer le groupe des Grateful Dead. Ken Kesey voudra « dépasser la drogue » pour aboutir à l’état de conscience augmentée sans LSD. Ce sera le mouvement psychédélique des « acid tests » où les sons et les effets de lumière, les projections d’images sur les murs et au plafond permettront la transe puis l’extase – sans extasy. Quoique… chacun arrive déjà défoncé et le FBI veille.
Une expérience, une impasse mais féconde.
Tom Wolfe, Acid test (The Electric Kool-Aid Acid Test), 1968, Points Seuil 1996, 412 pages, €8,90 (liens sponsorisés Amazon partenaire)

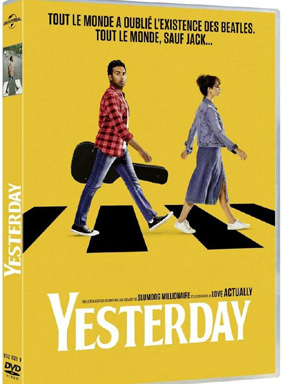





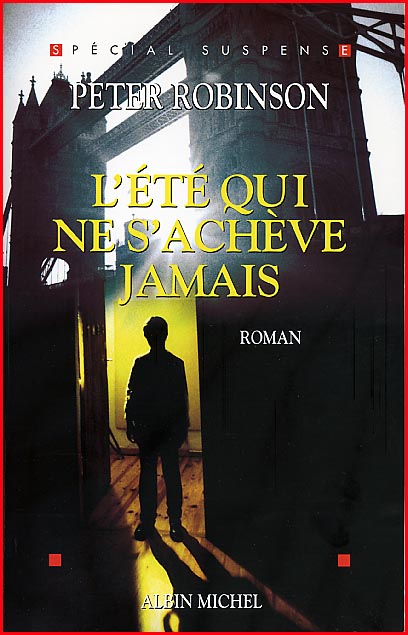

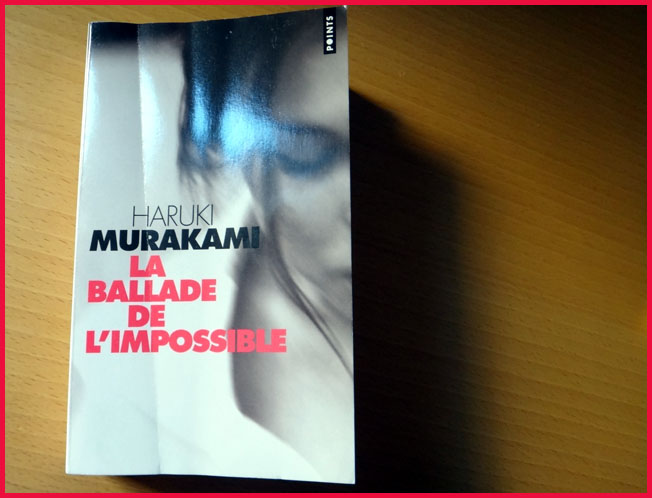

Commentaires récents