Le premier chapitre du Troisième Livre des Essais porte sur la morale : est-il vertueux que la fin justifie les moyens ? Autrement dit, au nom de l’utilité, peut-on envisager tous les procédés, y compris les plus malhonnêtes ? Montaigne répond évidemment non, car ce serait s’avilir soi-même que de consentir aux vices requis par l’objectif.
Il prend pour exemple sa propre expérience de négociateur entre les Grands, dans la guerre civile à prétexte de religions qui sévissait alors au royaume de France. Un constat tout d’abord : « Notre être est cimenté de qualités maladives ; l’ambition, la jalousie, l’envie, la vengeance, la superstition, le désespoir, logent en nous d’une si naturelle possession que l’image s’en reconnaît aussi aux bêtes ; voire et la cruauté, vice si dénaturé ; car au milieu de la compassion, nous sentons au-dedans je ne sais quel aigre-douce pointe de volupté maligne à voir souffrir autrui ; et les enfants le sentent. » Mais céder à ces penchants mauvais « détruirait les fondamentales conditions de notre vie .» Rien ne vaut de sacrifier son honneur et sa conscience, dit Montaigne.
« Le bien public requiert qu’on trahisse et qu’on mente et qu’on massacre ; résignons cette commission à gens plus obéissants et plus souples. » Pas Montaigne. Lui se présente tel qu’il est, franc et ouvert, et dit sa vérité, si cruelle qu’elle soit. « En ce peu que j’ai eu à négocier entre nos princes, en ces divisions et subdivisions qui nous déchirent aujourd’hui, j’ai curieusement évité qu’ils se méprissent en moi et s’enferrassent en mon masque. (…) Moi, je m’offre par mes opinions les plus vives et par la forme plus mienne. »

Trop souvent la passion ou la haine mènent la cause, or, dit Montaigne, « la colère et la haine sont au-delà du devoir de la justice, et sont passions servant seulement à ceux qui ne tiennent pas assez à leurs devoirs par la raison simple ; toutes intentions légitimes et équitables sont d’elles-mêmes égales et tempérées, sinon elles s’altèrent en séditieuses et illégitimes. C’est ce qui me fait marcher partout la tête haute, le visage et le cœur ouverts. » Tout ce qui est excessif est insignifiant. Ce n’est pas la passion qui prouve la justesse de sa cause, mais l’intelligence. Et celle-ci ne peut apparaître que dans la modération, l’argumentation, le débat. Pas dans la colère, ni la haine. Pas comme Mélenchon ou Rousseau Sandrine. Tout peut se défendre, mais en raison.
Cela ne signifie pas « se tenir chancelant ou métis (…) en une division publique », rappelle Montaigne. Métis signifiant entre-deux. Modération ne signifie pas indifférence ou neutralité, refus de choisir ou en même temps. Modération signifie argumentation et raison. « Ce n’est pas prendre un chemin moyen, c’est n’en prendre aucun », disait Tite-Live cité par notre philosophe.
« Mais il ne faut pas appeler devoir (comme nous faisons tous les jours) une aigreur et âpreté intestine qui naît de l’intérêt et passion privée ; ni courage, une conduite traîtresse et malicieuse. Il nomment zèle leur propension vers la malignité et violence ; ce est pas la cause qui les échauffe, c’est leur intérêt ; ils attisent la guerre non parce qu’elle est juste, mais parce que c’est guerre ». Les manifestants violents et les partisans radicaux croient ainsi défendre une cause juste et noble ; ils ne défendent que leur plaisir de provoquer et d’insulter, de casser et de brailler ensemble en se jouant de la police. Leurs arguments ne valent rien s’ils sont des injures ou des barres de fer.
« Rien empêche qu’on ne se puisse comporter commodément entre des hommes qui se sont ennemis, et loyalement ; conduisez-vous-y d’une, sinon partout égale affection (car elle peut souffrir différentes mesures), mais au moins tempérée, et qui ne vous engage tant à l’un qu’il puisse tout requérir de vous. » Si vous en trahissez un, l’autre sera content mais vous considérera comme pratiquant la traîtrise ; il ne vous fera pas confiance. « Je ne dis rien à l’un que je ne puisse dire à l’autre à son heure, l’accent seulement un peu changé ; et ne rapporte que les choses ou indifférentes ou connues, ou qui servent en commun. Il n’y a point d’utilité pour laquelle je me permette de leur mentir. » A ceux qui réclament une obéissance inconditionnelle, Montaigne leur dit ses bornes « car esclave, je ne le dois être que de la raison », leur dit-il. « Et eux aussi ont tort d’exiger d’un homme libre telle sujétion à leur service et telle obligation que de celui qu’ils ont fait et acheté, ou duquel la fortune tient particulièrement et expressément à la leur. » Les obligations sont une sorte d’esclavage et la liberté exige qu’on s’en défasse.
Certaines professions exigent de mentir, notamment les affaires publiques, ce pourquoi Montaigne s’en est détourné dès qu’il l’a pu, « tenant le dos tourné à l’ambition ». Si la tromperie est parfois utile, comme vice légitime, Montaigne lui préfère « la justice en soi, naturelle et universelle ». Il n’est pas naïf ni idéaliste. « Je ne veux pas priver la tromperie de son rang, ce serait mal entendre le monde ; je sais qu’elle a servi souvent profitablement, et qu’elle maintient et nourrit la plupart des professions des hommes. Il y a des vices légitimes, comme plusieurs actions, ou bonnes ou excusables, illégitimes. » Mais, dit-il, « je suis le langage commun, qui fait différence entre les choses utiles et les honnêtes. » Et de prendre plusieurs exemples antiques.
Epaminondas même, que Montaigne met « au premier rang des hommes excellents », estime « que l’intérêt commun ne doit pas tout requérir de tous contre l’intérêt privé. » La justice en soi est plus haute que l’intérêt général, les principes humanistes que les lois des États ou des ordres des dirigeants. « Toutes choses ne sont pas loisibles à un homme de bien pour le service de son roi ni de la cause générale et des lois. »
Car enfreindre cette justice en soi, pour l’utilité de tel dirigeant ou la gloire de telle nation, c’est ouvrir la porte à l’anarchie morale, au droit du seul plus fort, au grand n’importe quoi. Ce qui règne convenons-en, entre les nations, bien loin de la « République universelle » de l’idéaliste romantique Hugo. Au contraire, dit Montaigne, «Ôtons aux méchants naturels et sanguinaires, et traîtres, ce prétexte de raison. » Dénonçons les mensonges de Poutine, la traîtrise manœuvrière d’Erdogan, les intérêts commerciaux américains. Montaigne est pour la lucidité, contre la culture de l’excuse. Nécessité ne fait pas loi, ni l’ignorance, ni une enfance malheureuse. Être victime n’excuse rien, surtout pas la violence.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog

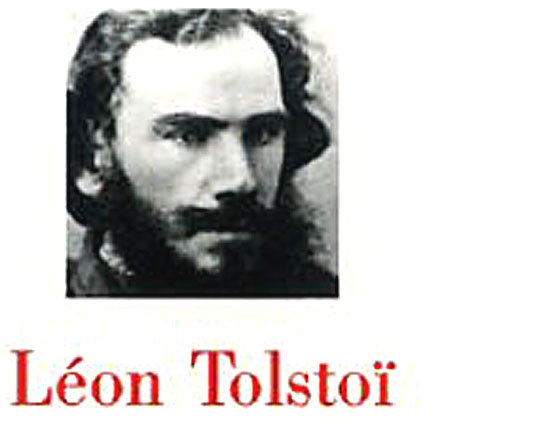

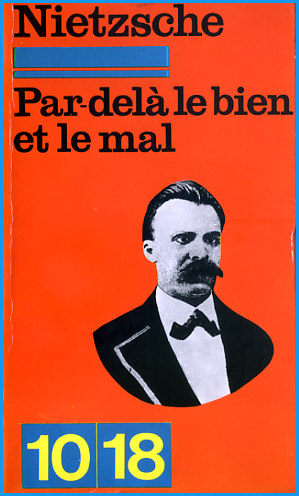

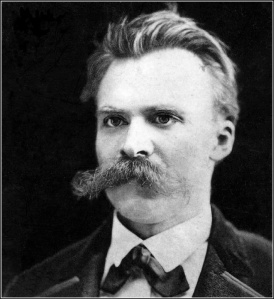
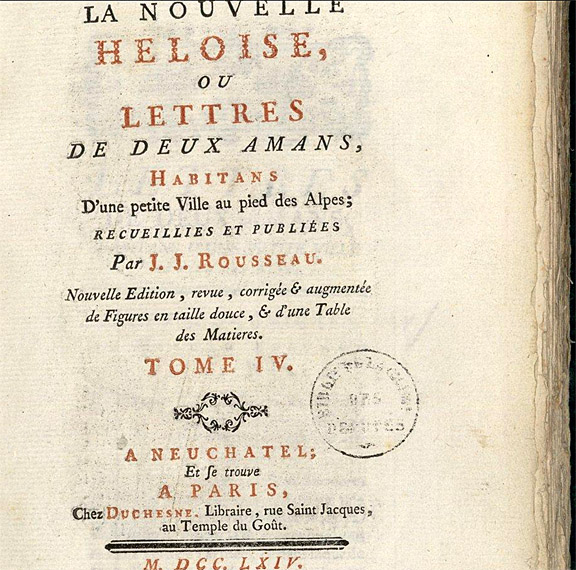

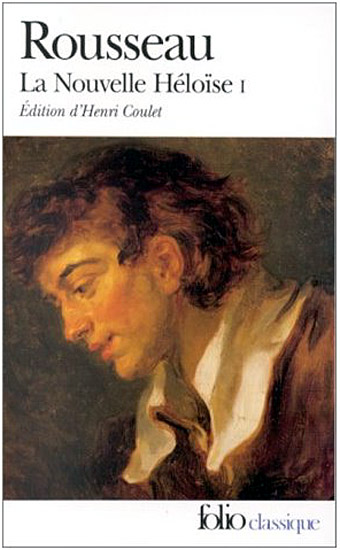

Commentaires récents