
Une Corneille bossue est perchée sur la Racine de La Bruyère et boit l’eau de La Fontaine Molière. Certains lecteurs, formés en un autre temps, auront peut-être reconnu le procédé mnémotechnique conservé des Grecs pour garder une leçon. A l’époque où l’enseignement apprenait à retenir, accumulant ainsi les bases pour réfléchir par soi-même, cette phrase résumait la liste des principaux auteurs de talent du Grand Siècle. De cette liste, je veux tirer un nom que l’on ne lit plus guère – à tort. Jean de La Bruyère, né à Dourdan (Essonne) en 1645, qui fut baptisé dans l’île de la Cité à Paris avant de mourir à Versailles.
Il est l’auteur d’un seul livre, le reste de ses œuvres étant fort mince et de peu d’intérêt autre qu’historique. Les Caractères, ou les Mœurs de ce Siècle, publié pour la première fois en 1687, est resté immortel. Le duc de Saint-Simon le décrit comme « un homme illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des hommes ».
Réédité continûment jusqu’en 1696 du vivant de l’auteur, celui-ci l’a enrichi et complété jusqu’à sa mort. Son livre résume une vie ; il expose sous forme archétypale les types humains et les relations sociales de la Cour de son roi, Louis XIV. Né quelques années après lui, Jean de La Bruyère est parti avant lui, en 1696, d’une attaque d’apoplexie à 51 ans. Ami de Bossuet, qui le recommandera auprès des Condé pour qu’il éduque le dernier de la lignée, il entrera, après parution des Caractères à l’Académie Française en 1693. Son élève, le duc de Bourbon, avait 16 ans lorsqu’il le prit en main pour lui enseigner l’histoire, la géographie, les institutions de la France et les dynasties royales. Le garçon, très petit de taille et plus féru de chasse et de danse que de livres, avait cependant de la curiosité pour les causes des décisions royales et pour les logiques des batailles. Il épousera la fille de Louis XIV et de Madame de Montespan un an plus tard, suivant les leçons de son mentor une année de plus.

« Je rends au public ce qu’il m’a prêté ; j’ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage », commence La Bruyère. Il veut son livre édifiant sur les mœurs du temps, avec la vague idée de participer à leur réforme par ce simple miroir. Bien que construit a posteriori, son plan va de l’individu (‘Des ouvrages de l’esprit’, ‘Des mérites personnels’) à la religion dernière (‘De la Chair’, ‘Des esprits forts’), en passant par toute la société (‘Des femmes’, ‘Du cœur’, ‘Des biens’, ‘De la ville’, ‘De la Cour’, ‘Des Grands’, …). En 16 chapitres, il conduit de la personne à Dieu – ainsi le dit-il.
Mais ce n’est pas cette édification, bâtie sur la philosophie catholique de l’homme dont la nature est le vice s’il n’est touché par la grâce, qui nous plaît aujourd’hui. Ni le succès de scandale en son temps, ni sa participation aux débats moraux qui le font discuter Descartes, Pascal ou Bossuet, et contester Corneille, jugeant Racine bien plus fin. Ce qui reste, de nos jours, est le beau langage et le style.
Sa phrase court par périodes, rythmée par les virgules ou les subordonnées comme dans la conversation. On sent l’influence de la rhétorique latine comme l’usage permanent des alexandrins en poésie ou tragédie. L’époque est élitiste, hiérarchique, centrée sur la Cour, et ce microcosme se regarde, se parle et se jauge. Comme en toute société resserrée, la parole et la civilité prennent une importance cruciale dans le « rang » que l’on acquiert à l’ombre de la faveur.

La Bruyère invente donc en littérature le style français. Il est caractérisé à notre sens par trois dispositions : la maxime, le bon mot et le trait.
- La maxime se veut édifiante parce qu’elle élève le cas particulier au cas général, dans la lignée des philosophes antiques.
- Le bon mot est la façon de faire passer ses avis dans une société encombrée où chacun veut la parole et ne retient que ce qu’il peut répéter. Les Anglais avec plus d’affectif en feront l’humour, les Français le réduiront aux « petites phrases » ironiques et mordantes, dont les media de nos jours raffolent.
- Le meilleur du style français est cependant le « trait ». Ce terme foisonnant évoque à la fois le dard de l’épigramme, le crayon acéré du peintre et la traction qui enlève. Il exige maîtrise des mots et virtuosité de la langue. Il est rapide, marque une action et distingue impitoyablement.

C’était le propre de l’intelligence de Cour que d’être très rapide. La Bruyère le note même : « Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce serait encore trop que les termes pour exprimer les sentiments : il faudrait leur parler par signes, ou sans parler se faire entendre » (Des ouvrages, 29). Lui n’a pas cette ambition, en adulte réaliste qui écrit par plaisir : « Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments ; c’est trop grande entreprise » (Des ouvrages, 2). « Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule ; s’il donne quelque tour à ses pensées, c’est moins par une vanité d’auteur, que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout le jour nécessaire pour faire l’impression qui doit servir à son dessein » (Des ouvrages, 34). L’impression compte plus que la vérité, déjà les bases de la com’ sont lancées…
Son observation des hommes, des vanités et des envies, de l’esprit et de la générosité, de l’être et du paraître, du « tels qu’ils sont » et du « tels qu’ils devraient être » (sur Racine et Corneille, ‘Des ouvrages, 54) – reste d’une actualité mordante. La France est encore aujourd’hui une société de cour, hiérarchique, organisée spontanément en castes et coteries, envieuse et prête à tout pour se faire valoir et obtenir la faveur. Qu’on en juge par les quelques exemples ci-après.
Nombre de commentateurs de blogs : « Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point ; les esprits médiocres croient l’entendre parfaitement ; les grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout entier : ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair ; les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce qui est fort intelligible » (Des ouvrages, 35). Entre les médiocres et les grands, les « beaux » se font valoir, tout dans l’apparence, théâtreux plus qu’intelligents.
Les intellos-médiatiques : « De bien des gens il n’y a que le nom qui vaille quelque chose. Quand vous les voyez de fort près, c’est moins que rien ; de loin ils imposent » (Du mérite, 2).
La StarAc, les concours de Miss : « J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille, depuis treize ans jusques à vingt-deux ; et après cet âge, de devenir un homme » (Des femmes, 3)
La redistribution administrative ‘de gauche’ : « La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner à propos » (Du cœur, 47). Équité plutôt qu’égalité, ce que la plèbe va pourtant imposer depuis deux siècles, la gauche poussant toujours plus dans l’égalitarisme forcené, jamais assez égal pour l’idéal.
Des hommes populaires : « Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions nobles et élevées, que nous devons moins à la force de notre esprit qu’à la bonté de notre naturel » (Du cœur, 79). Le cœur a sa raison… pas toujours raisonnable, et l’esprit ne l’emporte pas toujours.
Les bobos intellos : « Il faut donc s’accommoder à tous les esprits, permettre comme un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou sur l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les mêmes » (De la société, 5). De toutes façons, on ne les changera pas, ces paons de cour qui veulent se faire mousser et se donner bonne conscience.
Les énarques : « Les hommes n’aiment point à vous admirer, ils veulent plaire ; ils cherchent moins à être instruits, et même réjouis, qu’à être goûtés et applaudis ; et le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui » (De la société, 16). La langue de bois des euphémismes administratifs ne froisse personne, tout en diluant le sens pour tous.
Les patrons : « N’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses ; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderait point : ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir ; cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner à un tel marché » (Des biens, 13).
La banlieue : « L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet de plusieurs vices : de la sotte vanité, de l’ignorance de ses devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie » (De l’homme, 8).
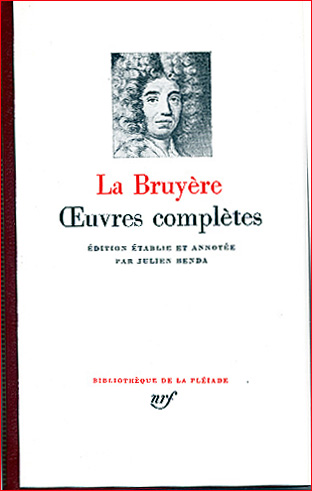
L’arrogance française : « La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la nation, nous fait oublier que la raison est de tous les climats, et que l’on pense juste partout où il y a des hommes : nous n’aimerions pas à être traités ainsi de ceux que nous appelons barbares ; et s’il y a en nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés de voir d’autres peuples raisonner comme nous » (Des jugements, 22). Non, nous ne sommes pas « une exception française », nous sommes comme tout le monde – encore faut-il aller y voir.
L’investisseur avisé : « Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile, ne font pas le hasard ; mais ils le préparent, ils l’attirent, et semblent presque le déterminer : non seulement ils savent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire se servir du hasard quand il arrive ; ils savent même profiter par leurs précautions et leurs mesures d’un tel ou tel hasard, ou de plusieurs tout à la fois : si ce point arrive, ils gagnent ; si c’est cet autre, ils gagnent encore ; un même point souvent les fait gagner de plusieurs manières ; ces hommes sages peuvent être loués de leur bonne fortune comme de leur bonne conduite, et le hasard doit être récompensé en eux comme la vertu » (Des jugements, 74). Ce n’est pas « par hasard » si la France a le plus fort taux de chômage, d’impôts et de taxes, de fonctionnaires par habitant, de pessimisme sur l’avenir et de politiciens… « Précautions » et « mesures » ne sont pas prises car nos politiciens, depuis des décennies, ne sont point « sages ».
Le Parti Socialiste ou tout parti idéologique : « Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire, ils l’altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particuliers, ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes et inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée » (Des esprits forts, 25).
Jean de La Bruyère, Les Caractères ou Les mœurs de ce siècle, 1688, Livre de poche 1976, 633 pages, €5.60
e-book format Kindle, €1.99
Jean de La Bruyère, Œuvres complètes, Gallimard Pléiade 1935 toujours réédité, 739 pages, €40.10





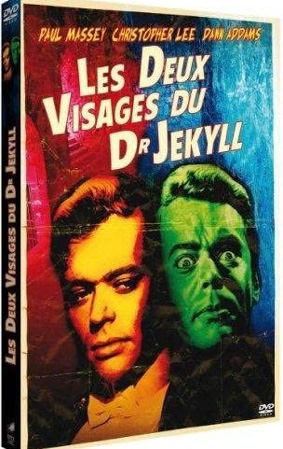






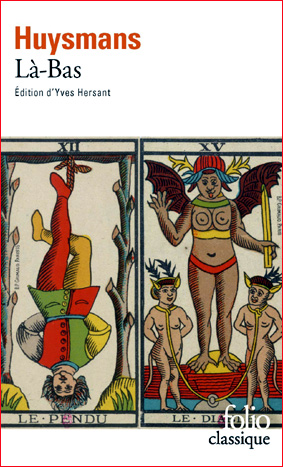








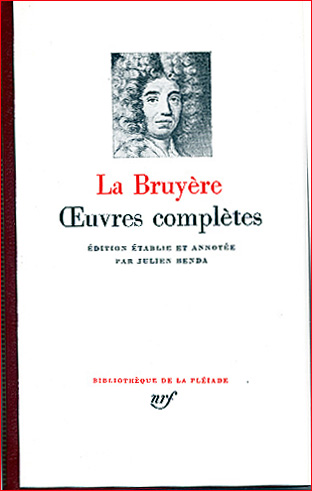


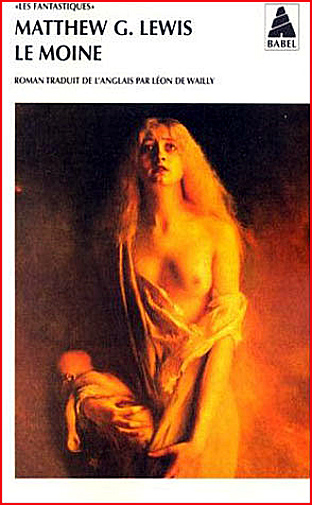
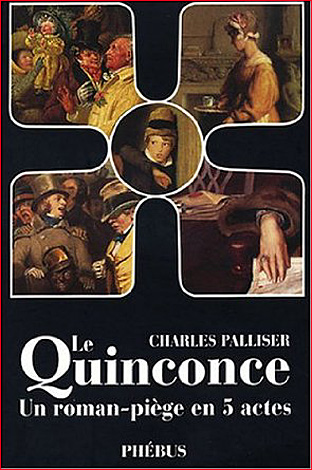

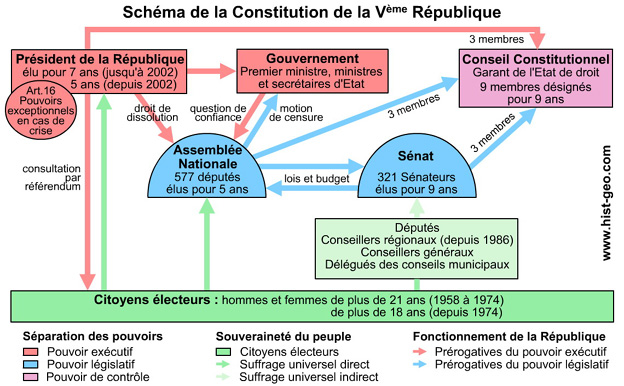
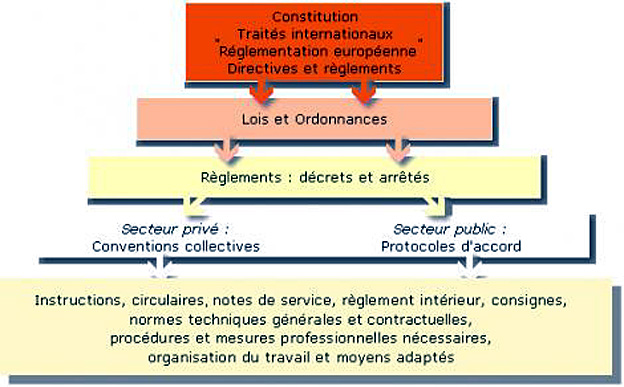
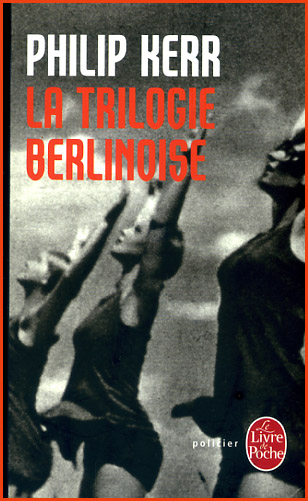



Commentaires récents